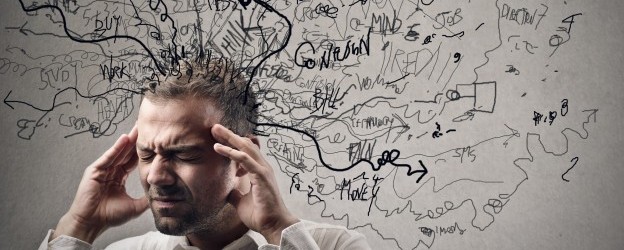Jeanne d’Arc (sa page Grokipedia est très riche) est un des personnages les plus célèbres de l’histoire de France. Parce que son histoire est incroyable, bien sûr, ainsi que sa personnalité (nous y reviendrons), mais également parce que les minutes de son procès (1431) ont été conservées, ainsi que celles du procès en annulation qui a eu lieu peu de temps après (1456). Nous avons donc un document exceptionnel permettant de connaître directement Jeanne d’Arc par le biais de ses réponses au procès.
Procès commenté
Jacques Trémolet de Villers21. Lien Wikipedia : faites attention à la qualité des informations que vous pouvez y trouver, notamment celles ayant des résonnances politiques., avocat, écrivain et connaisseur des questions théologiques, en a fait un ouvrage passionnant : on peut y lire les minutes de procès, avec des commentaires de sa part qui précisent certains points techniques, ou donnent un éclairage plus large sur les échanges entre Jeanne et ses juges. Grâce à l’utilisation de certaines témoignages du procès en annulation, il est possible, ce que fait l’auteur, de reconstituer ce qui s’est passé après le procès et jusqu’au bûcher. L’auteur apporte souvent des remarques très utiles, soit sur le plan juridique pour comprendre les échanges et ce qui se joue, soit sur un plan théologique avec un éclairage sur les questions que ce tribunal religieux cherchaient à trancher. Jacques Trémolet de Villers a vraiment réalisé un travail d’une grande justesse : nous assistons au procès, et de temps en temps, au bon moment, sa voix – par le biais de ses commentaires directement insérés dans le texte avec une autre police de caractère – nous apporte, presque comme un chuchotement, un éclairage utile. Il n’est jamais trop présent, mais toujours indispensable.
Incroyable Jeanne d’Arc
Ce procès, comme chacun le sait, est une ignominie : commandé par les Anglais pour détruire la Pucelle, il est mené complètement à charge (sous la houlette du célèbre Cauchon), sans aucun motif réel. On comprend au fur et à mesure des échanges plusieurs choses :
- L’angle d’attaque est théologique : on reproche à Jeanne d’être une sorcière, une hérétique en somme. Ses « Voix » sont certainement l’œuvre de forces maléfiques, les « miracles » qu’elles auraient réalisés également.
- Les juges cherchent à lui faire dire des choses qu’elles a décidé de ne pas révéler, ce qui les rend fous de rage. Ils veulent savoir le secret qui unit Jeanne au Roi Charles, et dès le début du procès elle leur dit qu’ils n’en sauront rien.
L’évêque – Vous jurez de dire vérité sur ce qui vous sera demandé concernant la matière de foi et que vous saurez
Jeanne – De mon père, de ma mère et des choses que j’ai faites depuis que j’ai pris le chemin de France, volontiers je jurerai. Mais, des révélations à moi faites de par Dieu, je ne les ai dites ni révélées à personne, fors au seul Charles, mon Roi. Et je ne les révèlerais même si on devait me coupe la tête. Car j’ai eu cet ordre par visions, j’entends par mon conseil secret, de ne rien révéler à personne. Et, avant huit jours, je saurai bien si je dois les révéler. - Il lui est reproché d’avoir pris un habit d’homme. Ce point totalement absurde est expédié en deux phrases par Jeanne (ce qui n’empêche pas les juges de lui en reparler 35 fois pendant le procès) : elle explique qu’ayant conduit l’armée, elle a pris habit d’homme car c’est ce qui convient de faire quand on est avec des hommes. Et que sa mission terrestre (expulser les anglais et rendre le pays à son Roi) n’étant pas terminée, elle n’a pas de raison d’en changer.
- Jeanne a fait plusieurs tentatives d’évasion, dont une en sautant d’une tour (elle a failli y rester). Ses réponses, sa lucidité malgré les conditions difficiles de son incarcération, montrent un courage hors-norme
- Jeanne est une chef militaire, qui conduit une troupe de plus de 15000 hommes. A plusieurs reprises, on voit chez elle tout le pragmatisme et le sérieux de quelqu’un qui conduit un combat très concret. Ce n’est pas une illuminée qui suivraient des lubies. Ses voix, qui la guident et la conseillent, ne font pas d’elles une dingue, bien au contraire. Les accusations ridicules dont elle fait l’objet semblent dérisoires, absurdes, injustes. Ce procès est une véritable parodie de justice.
- On sent la superstition de l’époque dans certains échanges lunaires sur les fées, les anges, les apparitions, la magie, l’attachement à certains signes. Je pense que si ce procès a été intégralement documenté, conservé, c’est aussi en partie parce que les religieux qui ont jugés Jeanne d’Arc n’étaient pas tout à fait sûr de ne pas réellement se mettre le bon Dieu à dos. Pour une raison simple et c’est le dernier point que je voulais partager avec vous:
Jeanne d’Arc est extraordinaire. Je n’ai aucune explication particulière à ses voix, et au mystère qui entoure un certain nombre de ses actes, qu’elles dit inspirés par Dieu. Mais dans ses réponses au procès, sa voix, à travers les âges, sonne de manière quasiment christique : simple, directe, tranchante, lumineuse, portée par un souffle de vérité incroyablement bouleversant. La lecture des échanges entre ses juges religieux et elle fait ressortir de manière limpide où se situe le Bien et le Juste. Son ton, ses mots, sa manière de dire ce qu’elle sait et ce qu’elle ne sait pas, son courage devant des gens visiblement décidés à toutes les entourloupes pour la condamner, laisse songeur et admiratif. Il est évident, à la lecture du compte-rendu de ce procès, que Jeanne d’Arc était quelqu’un d’absolument hors du commun. Chacun y lit ce qu’il veut, selon ses croyances. Mais personne ne peut ne pas voir l’évidence : cette incroyable jeune femme a tout changé. Je laisse le mot de la fin à l’auteur.

Jeanne n’a pas fait de miracles. Elle n’a bénéficié d’aucun miracles. Le miracle, c’était elle.
Jacques Trémolet de Villers(1944),
avocat et écrivain
Et j’ajoute en fin d’article le portrait imaginé par Paul Dubois, car il exprime très bien toute la force de Jeanne d’Arc, là où mon image d’en-tête montrait plutôt son regard clair et lucide, son sens de la vérité.