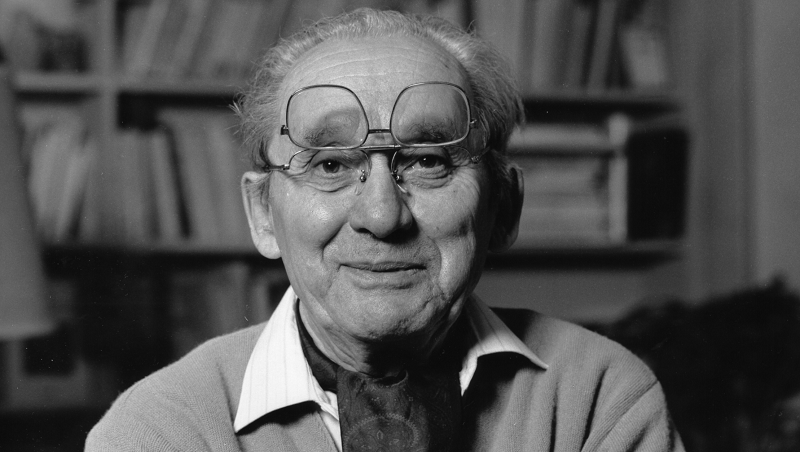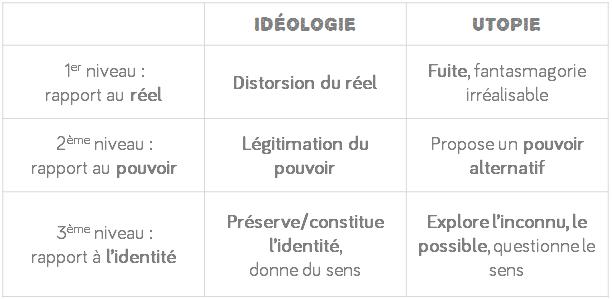J’aime bien Paul Ricoeur. J’ai lu, de cet auteur, « Idéologie et utopie » et « Soi-même comme un autre ». Ce petit texte, « Réflexion faite », sous-titré Autobiographie intellectuelle, est un ouvrage à part. Son titre dit bien le projet : ni une autobiographie personnelle, ni un livre de bilan (il s’appelle « réflexion faite » et non « tout compte fait, comme le précise avec justesse Olivier Mongin dans la préface) ; une autobiographie Intellectuelle.
Retour sur les grands temps de l’évolution de sa pensée
Ricoeur se livre à un exercice ambitieux dans ce volume (une centaine de page) : revenir sur les grandes étapes de sa pensée, de son évolution, en s’appuyant sur ses ouvrages (presque pas sur ses conférences, cours, articles et autres supports). Sans rentrer dans le détail, qu’il me serait impossible de résumer tant le texte est dense, on peut dire que Ricoeur, par son parcours, a tenté une forme de philosophie particulière, mariant phénoménologie (il vient de là), sémiotique, psychanalyse, mais aussi, grâce à son parcours aux Etats-Unis, philosophie analytique11. Cela rejoint de manière surprenante toute l’introduction du livre de Larmore, Modernité et morale, et dont le thème central, à mes yeux, est le sujet, et l’identité. Et aussi la narration et la place du temps dans la construction du sujet. Passionnantes thématiques, et ouvrage très très dense. Deux points m’étonnent dans sa pensée et dans son parcours.
Ligne de front
D’une part, sa farouche volonté de séparer sa pensée philosophique et sa pensée spirituelle (il a été aussi un auteur prolifique sur la foi, l’herméneutique biblique). Quelle drôle d’idée de penser que c’est possible ! Cette volonté de distinction l’honore, mais nous fait perdre le fruit d’une tentative d’articulation… Comme le dit Mongin dans la préface en le citant, Ricoeur, dès ses années d’apprentissage, apprend à « mener, d’armistice en armistice, une guerre intestine entre la foi et la raison. » La conclusion de « Soi-même comme un autre » signalait également « le rapport conflictuel-consensuel entre sa philosophie sans absolu et sa foi biblique plus nourrie d’exégèse que de théologie ». Bien sûr, l’une et l’autre se sont nourrie, mais il aurait été, en tant que lecteur, plus intéressant d’avoir une autobiographie mêlant les deux.
Je me dis que je dois aller lire, dans ma bibliothèque, « La métaphore vive » que je n’ai jamais ouvert, et je suis d’ores et déjà en train de relire quelques textes de Benoît XVI, notamment le magnifique « Discours de Ratisbonne », où il est question de l’articulation entre la foi et la raison.
Pudeur
A nouveau, cela force l’admiration, mais peut être un peu frustrant. Orphelin de mère et de père, le parcours personnel de Ricoeur, assorti par ailleurs du suicide de son dernier fils, n’est qu’à peine évoqué. Il a l’honnêteté de reconnaître qu’il ne peut faire une autobiographie intellectuelle sans au minimum évoquer la « catastrophe », mais c’est en restant sur une ligne crête philosophique et jamais personnelle : un peu paradoxal pour quelqu’un dont toute la pensée est centrée sur la narration et le sujet, la phénoménologie, le récit, et la quête de sens.