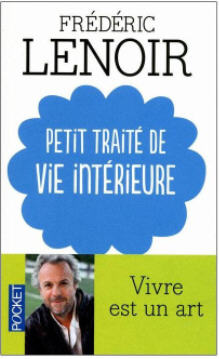 La spiritualité n’est pas un gros mot. Cela parait évident, et pourtant il est rare de pouvoir accéder à une intimité suffisamment grande avec quelqu’un pour parler « spiritualité ». Frédéric Lenoir offre dans ce petit livre facile à lire un condensé de notions, d’expériences, qu’il a trouvé utile pour vivre mieux. C’est un remarquable petit livre, plaisant, drôle parfois, très personnel, et qui revient de manière directe et humble sur un certain nombre de notions centrales pour bien « penser sa vie, et vivre sa pensée ». Jetez-vous dessus !
La spiritualité n’est pas un gros mot. Cela parait évident, et pourtant il est rare de pouvoir accéder à une intimité suffisamment grande avec quelqu’un pour parler « spiritualité ». Frédéric Lenoir offre dans ce petit livre facile à lire un condensé de notions, d’expériences, qu’il a trouvé utile pour vivre mieux. C’est un remarquable petit livre, plaisant, drôle parfois, très personnel, et qui revient de manière directe et humble sur un certain nombre de notions centrales pour bien « penser sa vie, et vivre sa pensée ». Jetez-vous dessus !
Catégorie : 📚 Livres
-

Petit traité de vie intérieure
-

Les employés d’abord
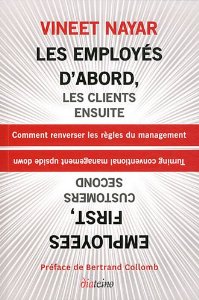 Par un hasard complet, je me suis retrouvé avec le livre de Vineet Nayar – « Les employés d’abord, les clients ensuite » – dans les mains. Je l’ai dévoré en un trajet de train. C’est un remarquable petit livre, à la première personne, sincère, humble et ambitieux à la fois. Très bien structuré et simple à lire, c’est un vrai régal par l’aventure formidable qu’il nous permet de suivre presque pas-à -pas. Cette aventure : celle du redressement d’une grosse entreprise de services IT indienne (HCTL), par Vineet Nayar, entre 2005 et 2010. Un redressement sans licenciement massif, sans crise interne majeure. En douceur, mais avec la fermeté de la vérité partagée. Pas de blabla dans ce livre.
Par un hasard complet, je me suis retrouvé avec le livre de Vineet Nayar – « Les employés d’abord, les clients ensuite » – dans les mains. Je l’ai dévoré en un trajet de train. C’est un remarquable petit livre, à la première personne, sincère, humble et ambitieux à la fois. Très bien structuré et simple à lire, c’est un vrai régal par l’aventure formidable qu’il nous permet de suivre presque pas-à -pas. Cette aventure : celle du redressement d’une grosse entreprise de services IT indienne (HCTL), par Vineet Nayar, entre 2005 et 2010. Un redressement sans licenciement massif, sans crise interne majeure. En douceur, mais avec la fermeté de la vérité partagée. Pas de blabla dans ce livre.Les salariés, ou les clients d’abord ?
Le titre provoquant n’écarte pas les clients, au contraire : ils sont au coeur de la réflexion. Quels employés sont au coeur de la zone de création de valeur pour les clients ? Comment faire en sorte que l’organisation les aide dans cette création de valeur ? Comment redonner un sens à l’action collective dans une entreprise essoufflée ? Voilà enfin un chef d’entreprise qui ne se contente pas de dire que la première valeur d’une entreprise, c’est la capital humain : Il l’a traduit dans les actes, dans l’organisation, à tous les niveaux.
L’accent est mis sur le chemin pris par Nayar pour restructurer en douceur mais rapidement la culture de l’entreprise HCTL. Voici les 4 points essentiels du chemin (c’est très caricatural, vraiment courez sur ce livre si vous ne l’avez pas lu, il est puissant et simple). Le chemin a pris le nom de EFCS (Employees firt, customers second).
Miroir, mon beau miroir
Impossible d’emmener les gens d’un point A à un point B, si on n’est pas capable de partager la vision du point de départ. Faire l’autocritique collective, constructive, transparente, voilà la première étape. Se dire la vérité, avec honnêteté et précision.
La confiance à travers la transparence
Pour instaurer la confiance, Vineet Nayar a forcé son entreprise a pratiquer la transparence à tous les niveaux de l’organisation. La transparence comme catalyseur de la confiance. Un exemple concret : le système U&I mis en place permet à n’importe qui dans l’organisation de remonter des problèmes, qui remontent les échelons hiérarchiques si personne ne sait y répondre. Le tout de manière visible et transparente sur l’intranet. Cela permet de partager les problèmes, bien sûr, mais aussi met chaque employé dans la dynamique de potentiellement y répondre. Un début de responsabilité partagée, aussi, donc.
Inverser la pyramide organisationnelle
Si l’organisation est archaïque, elle ne permettra jamais de résoudre les nouveaux problèmes qui se posent pour répondre aux clients. Où se situe la zone de création de valeur dans l’entreprise ? Comment changer les jeux de pouvoirs pour que les acteurs qui créent de la valeur pour les clients soient mis en confiance, soient encouragés pour proposer des solutions innovantes, sans forcément demander l’autorisation ou le visa du PDG ? Le constat de Vineet Nayar était que son entreprise était encore structurée en mode « Command & Control », alors que la société avait considérablement évoluée, qu’elle s’était « horizontalisée » si l’on peut dire. Changement de la structure de pouvoir, changement des répartitions de responsabilités. Il explique que souvent les directeurs ou les PDG sont les moins bien placés pour répondre aux problèmes qui se posent, parce qu’ils sont trop loin de la zone de création de valeur. Inverser la pyramide, c’est simplement (quelle révolution!) faire en sorte que les postes fonctionnels rendent des comptes à ceux qui travaillent en front office dans la zone de création de valeur. Une manière de le faire a été d’ouvrir les 360° feedback (des évaluations par les pairs pratiquées en entreprise comme outil de feedback) – base plus large d’évaluateurs et d’évalués pour chacun – et de les rendre transparents. A commencer par celui du PDG.
Redéfinir le rôle du PDG
En gros, transférer la responsabilité du PDG, autant que possible, aux employés eux-mêmes. Y compris la définition de la stratégie. Les 300 cadres dirigeants se sont pliés à un exercice d’exposition de leur stratégie de manière transparente sur l’intranet, consultable par l’ensemble des collaborateurs. Cela a servi comme catalyseur pour des échanges très riches, très denses dans toute l’entreprise, et par une implication collective majeure dans l’alignement stratégique (si important dans une grosse structure).
Vraiment, foncez ! Ce livre est touchant. Et surprenant : tant de bon sens et de courage, mêlée à la simplicité du propos, c’est vraiment rare ! On peut lire en filigrane la personnalité de l’auteur : prêt à partager ses doutes, humble, convaincu de la valeur de chaque individu. Humaniste et visionnaire. Du baume au coeur !
-
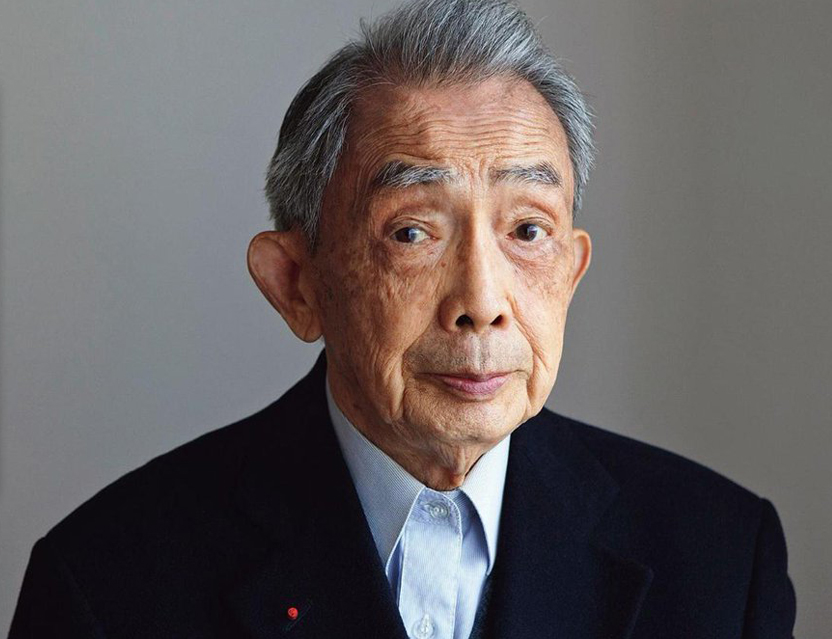
Hasard insensé ?
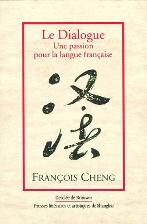 L’autre jour, je regardais la bibliothèque chez mes beaux-parents. Je parcourais les tranches de livres en me demandant si je pourrais trouver là un roman qui me tenterait (je ne lis presque plus jamais de romans). J’ai été attiré par un tout petit livre (« Le dialogue »), d’une belle couleur ocre clair. Je l’ai sorti, et je l’ai ouvert. J’ai eu la grande surprise de trouver en dédicace, par l’auteur François Cheng, ce petit texte qui résonne étonnamment avec mes réflexions du moment (je songe à écrire un essai sur le sens, pris dans toutes ses composantes) :
L’autre jour, je regardais la bibliothèque chez mes beaux-parents. Je parcourais les tranches de livres en me demandant si je pourrais trouver là un roman qui me tenterait (je ne lis presque plus jamais de romans). J’ai été attiré par un tout petit livre (« Le dialogue »), d’une belle couleur ocre clair. Je l’ai sorti, et je l’ai ouvert. J’ai eu la grande surprise de trouver en dédicace, par l’auteur François Cheng, ce petit texte qui résonne étonnamment avec mes réflexions du moment (je songe à écrire un essai sur le sens, pris dans toutes ses composantes) :
Le diamant du lexique français, pour moi, c’est le substantif « sens ». Condensé en une monosyllabe – sensible donc à l’oreille d’un Chinois – qui évoque un surgissement, un avancement, ce mot polysémique cristallise en quelque sorte les trois niveaux essentiels de notre existence au sein de l’univers vivant : sensation, direction, signification. Entre ciel et terre, l’homme éprouve par tous ses sens le monde qui s’offre. Attiré par ce qui se manifeste de plus éclatant, il avance. C’est le début de sa prise de conscience de la Voie. Dans celle-ci, toutes les choses vivantes qui poussent irrémédiablement dans un sens, depuis les racines vers la forme de plus grand épanouissement, celle même de la Création. D’où le lancinant attrait de l’homme pour la signification qui est le sens de sa propre création, qui est de fait la vraie « joui-sens ».Le sens de la vie ?
Vous dire que j’aurais pu signer ce texte serait exagéré : le deuxième paragraphe est plus intriguant qu’éclairant pour moi, même s’il propose une piste très intéressante pour la signification. Mais le premier paragraphe est exactement le point de départ de ma réflexion. Le sens pris comme triple filtre pour notre interaction avec nous-mêmes et le monde. J’aimerais notamment explorer les rapports entre les différents niveaux du sens. Le sens de la vie, question éternelle, et à travailler pour quiconque souhaite avancer spirituellement.
Quel hasard, tout de même, que je pioche ce petit livre parmi tous les autres, et que j’y découvre quelque chose d’aussi proche de moi. Surprenant.
Le livre est facile à lire et très intime : François Cheng y explique comment sa langue maternelle (le chinois) et sa langue d’adoption (le français) ont enrichi sa vie spirituelle, son oeuvre poétique, par un dialogue profond. Je vous recommande ce livre d’un amoureux de la langue française, pour qui elle n’a pas été une donnée de départ, mais un chemin, une transformation, un choix. Il y a au début quelques pages admirables sur le langage (au sens large) qui est notre moyen d’exprimer et de construire ce que nous sommes.Vive le hasard !
-
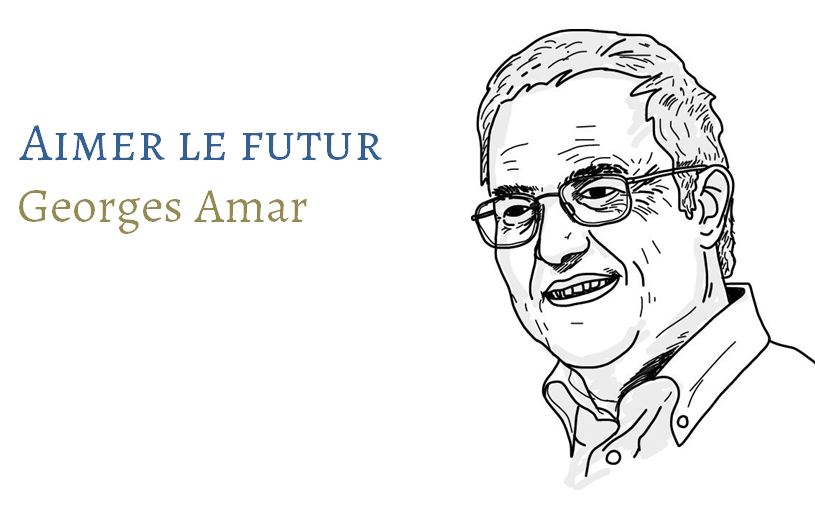
Aimer le futur
Georges Amar a longtemps dirigé les activités de recherche et d’innovation de la RATP (en savoir un peu plus). Il y est devenu prospectiviste. J’ai la chance de pouvoir le côtoyer dans le cadre de la Communauté d’Innovation. C’est quelqu’un d’excessivement gentil et abordable, tout en étant impressionnant de culture et de profondeur de réflexion. Il vient de publier un remarquable essai sur le futur, et sur l’activité de prospective. J’ai adoré l’approche de Georges Amar : ce qui l’intéresse dans le futur, ce n’est pas la partie prévisible, mais la partie nouvelle, radicalement neuve. La prospective n’en donc pas un travail d’aide à la gouvernance (« gouverner, c’est prévoir). Pour autant, Georges Amar n’est pas non plus dans une posture de stricte construction (« le futur étant essentiellement imprévisible, construisons-le »). Georges Amar est un amoureux de la langue, et il l’utilise comme un moyen de dire le futur : le futur ne se prédit pas, il se dit. Il ne se prévoit pas, il se lit.
Lecture du présent
Il y a une parenté avec Michel Serres dans l’approche poétique de Georges Amar. Prendre les mots au pied de la lettre, mais aussi dans toute leur profondeur sémantique, étymologique, fait partie d’un jeu que j’aime beaucoup suivre, et qui me parle. Une sorte d’interprétation du futur, par le langage. La prospective comme herméneutique du présent ? L’exercice de paléo-rétro-prospective sur la domestication du feu est un régal, et très éclairant sur la méthode de prospective de Georges Amar.
Il s’agit donc de dire l’inconnu. En cela, la prospective n’est pas une science, même si elle s’appuie sur les savoirs disponibles. En effet, la science transforme l’inconnu en connu, et l’enjeu éthique majeur pour Georges Amar est de dire un futur, d’appréhender l’inconnu, d’une manière qui permette de léguer aux suivant un futur qui ne soit pas préempté par nous. Un futur ouvert. Aller à la rencontre de l’inconnu, sans le figer, sans le faire coller avec notre vision. C’est bien ce que nous apprend ce merveilleux petit essai : il nous montre un chemin, une posture permettant de dire le futur sans le figer, à explorer l’inconnu sans être aveugle. Il nous sert à ne pas oublier de dialoguer avec le futur, à le questionner.
Aimer le futur : Georges Amar met dans le mot aimer un « mode de connaissance qui ne sépare pas le sujet de l’objet, le concept de l’affect, qui ne dissocie pas connaissance et création ».
-
La complexité de l’humain comme fil conducteur
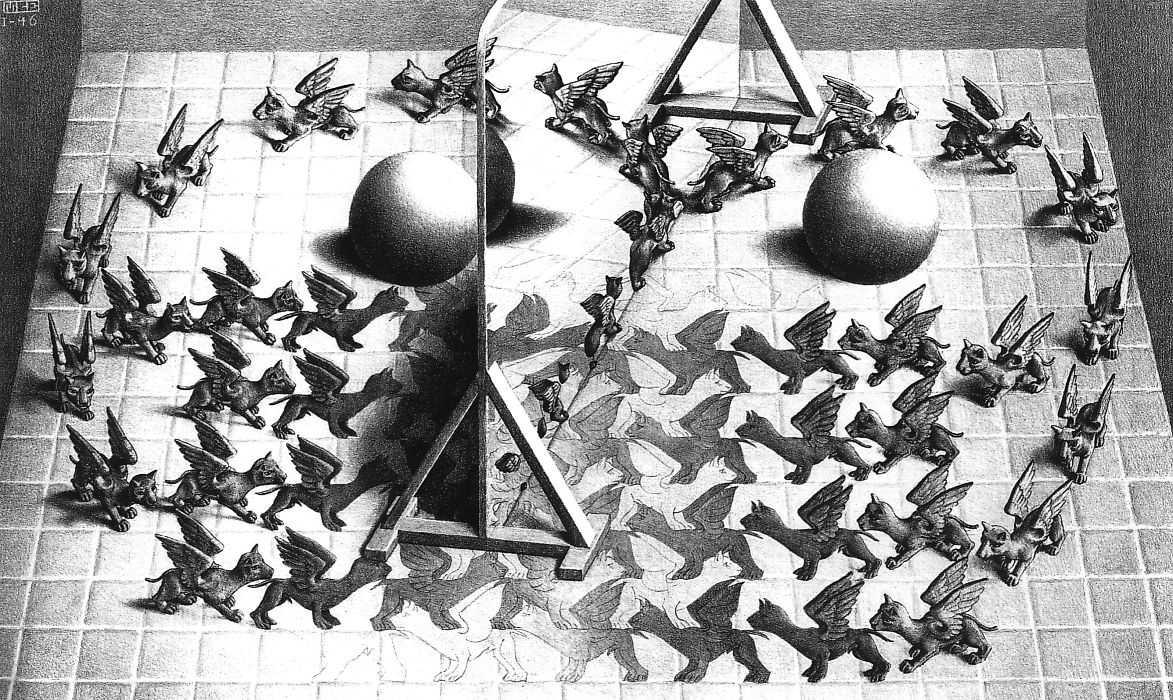 Dans le cadre de mon travail, je fais partie d’une communauté d’innovation regroupant des chercheurs et des industriels, des philosophes et des start-ups. C’est d’une grande richesse, intellectuelle, humaine. Je me sens très humble dans ce cadre, car conscient des gens de grande valeur que j’ai la chance d’y côtoyer. Je ressors toujours de ces rencontres stimulé, excité, et à la fois conscient de l’ampleur du travail à accomplir pour se hisser à un tel niveau. Passons ; comme le disait Voltaire « Il faut cultiver notre jardin ».
Dans le cadre de mon travail, je fais partie d’une communauté d’innovation regroupant des chercheurs et des industriels, des philosophes et des start-ups. C’est d’une grande richesse, intellectuelle, humaine. Je me sens très humble dans ce cadre, car conscient des gens de grande valeur que j’ai la chance d’y côtoyer. Je ressors toujours de ces rencontres stimulé, excité, et à la fois conscient de l’ampleur du travail à accomplir pour se hisser à un tel niveau. Passons ; comme le disait Voltaire « Il faut cultiver notre jardin ». J’ai donc la chance de croiser et d’échanger avec Dominique Christian, et de profiter d’ateliers philosophiques qu’il nous concocte. Dans le cadre de la communauté d’innovation, il a écrit un ensemble de textes dédié à la mobilité (qui devraient être publiés sous forme d’un livre très prochainement), éclairé par une démarche philosophique et par des focus historiques et thématiques particuliers (la mobilité corsaire, la mobilité grecque autour d’Hermès et Hestia, la mobilité homérique, celle de Pinocchio, etc…). C’est un travail admirable, passionnant et incroyablement structurant.
Dominique est un homme charmant, lucide, plein d’humour, piquant parfois, ayant toujours à coeur d’être dans le vrai et la complexité de la réalité. Il est par ailleurs peintre, immergé dans la culture chinoise. Il a passé sa vie à accompagner les entreprises, après avoir accompagné les drogués. C’est un grand connaisseur de l’être humain, des organisations, des jeux entre l’individuel et le collectif.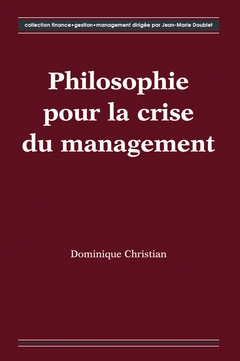 Je viens de terminer le livre de Dominique Christian « Philosophie pour la crise du management ». C’est un livre passionnant, construit d’une étrange manière : chaque chapitre intègre un certain nombre de citations d’un auteur différent (elles sont un peu cachées au milieu du texte de Dominique Christian). Cela fait un étrange mélange de voix ; une multiplicité d’interlocuteurs pendant la lecture. Cela donne la sensation à la fois étrange, déstabilisante, d’écouter une personne aux visages multiples nous parler, et en même temps l’agréable impression d’un auteur qui a la courtoisie, ou la rigueur, de mettre sa propre personne un peu en retrait.
Je viens de terminer le livre de Dominique Christian « Philosophie pour la crise du management ». C’est un livre passionnant, construit d’une étrange manière : chaque chapitre intègre un certain nombre de citations d’un auteur différent (elles sont un peu cachées au milieu du texte de Dominique Christian). Cela fait un étrange mélange de voix ; une multiplicité d’interlocuteurs pendant la lecture. Cela donne la sensation à la fois étrange, déstabilisante, d’écouter une personne aux visages multiples nous parler, et en même temps l’agréable impression d’un auteur qui a la courtoisie, ou la rigueur, de mettre sa propre personne un peu en retrait.
Sur le fond, c’est une plongée vraiment superbe dans une multitude d’outils de pensées, utiles pour réfléchir sur la personne, l’individu, son histoire, et l’articulation de cette individualité avec le groupe, le collectif, le monde, avec en filigrane bien sûr le fonctionnement des entreprises, notamment la manière dont se passent leur mutation permanente. Je retournerai souvent dans ce livre pour y piocher des choses, c’est une vraie boite à outils, dans le sens positif du terme. Dominique Christian, philosophe bricoleur ?J’ai fait part à Dominique Christian de remarques à la fois positives et critiques dans une correspondance privée. Une question pourrait lui être posée de manière publique, et je le fais donc. Puisque Montaigne (un de mes auteurs de chevet aussi) est invité parmi les contributeurs du livre, se pose l’articulation entre l’auteur et son oeuvre. Montaigne, dans ses Essais, est parti d’une réflexion sur le monde, pour peu à peu se dévoiler, se livrer en tant que personne. J’ai eu l’impression en tant que lecteur de côtoyer Montaigne, d’apprendre à le connaitre en lisant les Essais. Même si Montaigne souligne le caractère changeant, « ondoyant » de l’homme, il se livre dans ses Essais comme peu d’auteurs l’ont fait. Dans le livre de Dominique Christian, j’ai le sentiment d’être tenu à l’écart de Dominique Christian, qu’il m’échappe. D’où la question : n’est-il pas temps de « ré-emboiter » un peu ? N’est-ce pas un des efforts que nous impose le « désemboitement » des identités souligné dans le livre ? N’est-ce pas un des enjeux majeurs pour le monde Occidental ? En refusant — à juste titre souvent – les simplifications, ne peut-on se perdre soi ? Est-ce qu’on ne se construit pas aussi, dans sa personne, dans son rapport avec les autres, par la simplification ? L’élagage peut-il être un art utile pour la construction de soi ?
Pour finir, un avis personnel. Si chaque manager avait lu Dominique Christian, les entreprises tourneraient certainement un peu différemment. Son livre est un appel lucide et utile pour échapper aux croyances, aux dogmes, à tout ce qui peut réduire l’homme à une seule de ses facettes. L’humain dans toute sa complexité et sa richesse au centre des choses, c’est ce qui ressort du livre. Et qui rend la question ouverte encore plus criante… -

Habiter
Je viens de terminer coup sur coup deux livres de Michel Serres. L’un (« Eclaircissements », entretiens avec Bruno Latour) montrant un peu qui est Michel Serres, quelle est son histoire et comment s’est construit sa pensée, et l’autre – « Habiter » – qui montre très bien ce dont il est capable.
« Habiter » est un livre dont le format surprend : du texte en format presque poche, et des photos très belles en grand format. Il déroute, même, et pour ma part j’aurais préféré un livre « classique ». Mais c’est surtout un livre magnifique, par le style, par l’ampleur du propos en même temps que par son humilité. C’est Michel Serres que l’on découvre en filigrane, avec ses thématiques, avec sa manière de dire les choses, et de tout connecter à tout, dans une gymnastique infiniment séduisante et stimulante.
Le mot « Habiter », sous la plume et avec l’esprit de Michel Serres, devient un fil tiré sur l’ensemble du temps, et pour parler d’à peu près tout ce qui concerne l’humain. Dense, profond, émouvant parfois, je ne peux que vous recommander la lecture de ce livre admirable. Je laisse le mot de la fin à Michel Serres qui présente très brièvement son ouvrage :