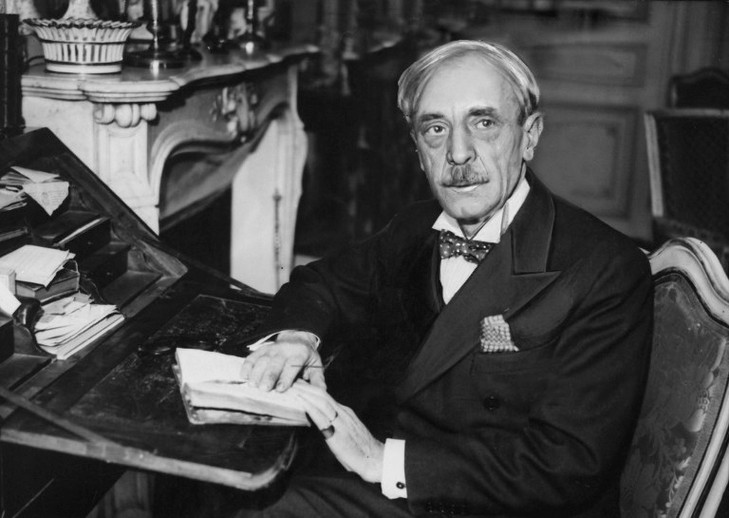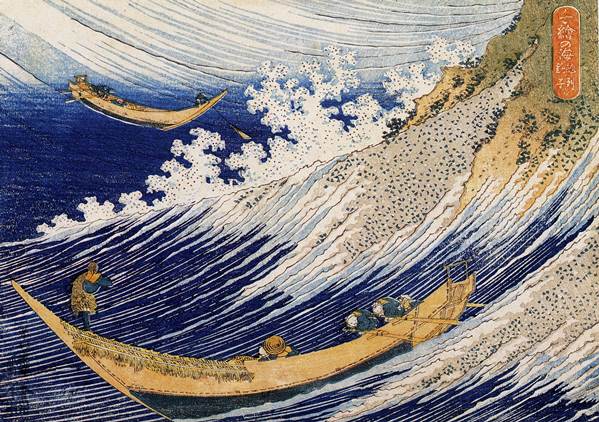J’ai découvert il y a peu que nous vivions, selon certains du moins, dans une époque post-moderne. Du nom du post-modernisme philosophique, qui est une philosophie critique, qui a déconstruit, et rejeté une forme d’occidentalisme des Lumières basé sur la raison et la technique. Fort bien.
Se débarrasse-t-on facilement du progrès ?
Mais cette manière de penser a contribué à faire jeter à une partie de la population le bébé avec l’eau du bain. L’eau du bain, c’est le dogmatisme, les superstitions, les modèles simplistes de l’humain et de la société. Mais le bébé, c’est la raison comme outil de la pensée, le progrès comme valeur collective donnant du sens, et la place de la vérité. Par ailleurs, personne ne peut me forcer à me positionner sur cette question selon ces termes. Le choix devant lequel nous sommes placés n’est pas nécessairement entre une croyance béate et naïve dans un Progrès mythique d’une part, et d’autre part un monde désenchanté, vide de sens rationnel et de toute représentation objective. Le choix n’est pas entre la foi, et le désespoir. Entre la croyance et la raison. Nous y reviendrons.
Rejet du progrès, problème d’identité
Il y d’abord un paradoxe : en rejetant en partie la raison pour faire réapparaitre l’irrationnel comme élément constitutif du réel (fort bien), les post-modernes ont rejeté aussi cette foi dans le progrès qui est une des marques idéologique de l’occident judéo-chrétien. En pointant du doigt un excès de rationalité, ces auteurs en sont venus à détruire et à casser une valeur assez irrationnelle, et importante. Il y a là des pensées problématique sur le plan de l’identité. Peut-on déconstruire sans cesser de croire ? Peut-on croire de manière raisonnable ? Déconstruire c’est bien, mais cela ne doit pas conduire à oublier ce que le temps et les hommes ont assemblé. La notion de progrès (si l’on en exclue une composante naïve ou dogmatique) reste une valeur centrale en occident. Une valeur qui soude et qui unit. Qui transcende les différences. Qui donne du sens au niveau individuel comme collectif.
Je regarde donc avec une certaine méfiance tout ce qui se revendique « post-moderne ». En général, cette posture consistant à dénigrer la croyance dans un progrès possible n’est pas uniquement destructrice ou critique, elle masque souvent une croyance positive — elle — dans un autre ordre des choses, et donc un rejet du réel. Les critiques du progrès en tant qu’idéologie sont en général des gens qui pensent que le monde devrait être autrement que ce qu’il est. Ou des polylogistes qui s’ignorent. Cette tension vers un changement est partagée par les partisans du progrès, ce n’est donc pas cela qui est en cause. C’est bien le refus du réel qui est central. Le progressiste ou mélioriste pense qu’il faut travailler AVEC le monde tel qu’il est.
Il faut construire aussi
Je me place dans une logique où il est au moins aussi important, dans le domaine de la pensée, de déconstruire que de construire. Je crois, d’une manière ou d’une autre, au progrès, à l’amélioration possible du monde par l’être humain. Il me semble que c’est une croyance pacifique et humaniste, et je pense qu’elle ne doit pas être présentée comme une foi naïve ou ridicule. Pas plus, pas moins, que toute autre croyance en un quelconque Dieu, ou dans autre chose. Comme toutes les croyances, elle présente des limites. Comme toute croyance, elle donne de la force d’action. Si la question doit être entre la foi et le nihilisme, alors j’ai choisi mon camp et les post-modernes ont tort.
La réponse est oui. Mais quelle était la question ? [Woddy Allen]
Mais ce serait restreindre le champ de la pensée que de devoir faire un choix. Ce serait accepter la logique de conflit et de rejet que l’on peut lire dans ces controverses philosophiques. Elles mettent à nu une incapacité à embrasser en même temps des points de vue contraire, des positions différentes.
Construire est une activité naturelle de l’esprit humain : toutes nos représentations sont des constructions, d’une manière ou d’une autre. Elles donnent une capacité d’action, et présentent le risque de masquer le réel. Tout modèle, toute représentation, est une simplification du réel et présente ce risque, et cet avantage : faciliter l’action, manquer en partie le réel – mais peut-on penser le réel sans utiliser de représentation, et donc sans le simplifier ?
Marier sens du progrès et transmission
C’est aussi pour cela que la déconstruction est indispensable : fruit du doute et de l’esprit critique, la déconstruction détricote nos représentations, les questionne, et nous force à nous confronter au réel, à la réalité des choses factuelles, sans le filtre de nos constructions, ou en proposant des pistes de représentations différentes. Outil indispensable pour rester proche de la réalité, et pour faire évoluer les représentations. Le risque lié à la déconstruction est de rester dans cette posture et de ne plus construire, de ne plus assembler. Or, il est important de savoir retisser si l’on veut avancer, individuellement comme collectivement. Par ailleurs, ce que l’on a déconstruit a été tissé par d’autres, pour des raisons qu’il convient au moins de comprendre, à défaut de les partager toutes. Assumer un héritage, des croyances partagées, me semble être une forme d’humilité intellectuelle. C’est assez facile de casser, de manière radicale, toutes les représentations. Mais il faut encore en proposer d’autres à la place : elles seront nécessairement le prolongement de représentations existantes. L’humilité est donc de rigueur.
Croire au progrès, cela ne signifie pas croire qu’un progrès a déjà eu lieu. Sinon ce ne serait pas une croyance. [Franz Kafka]
Bref : repenser le sens du progrès, individuel comme collectif, me parait être une tâche importante de la pensée occidentale. Il nous faut, je pense, adopter une pensée évolutionniste qui permet d’éviter les deux écueils : le radicalisme de la table rase, et le conservatisme figé. Connaissez-vous des auteurs qui ont pensé ce thème et qui ont essayé de l’actualiser ?