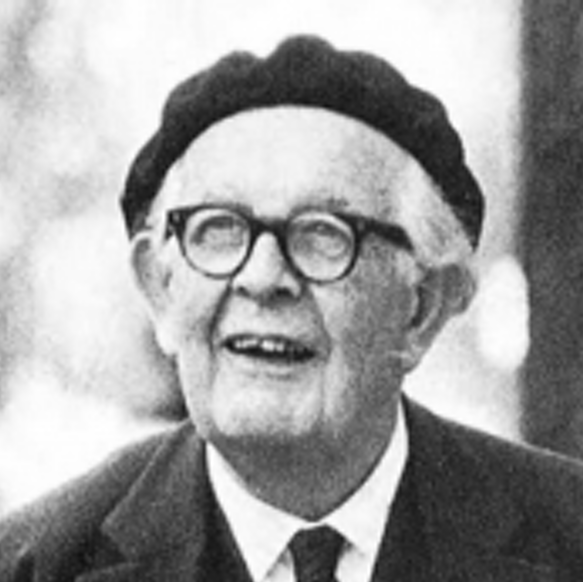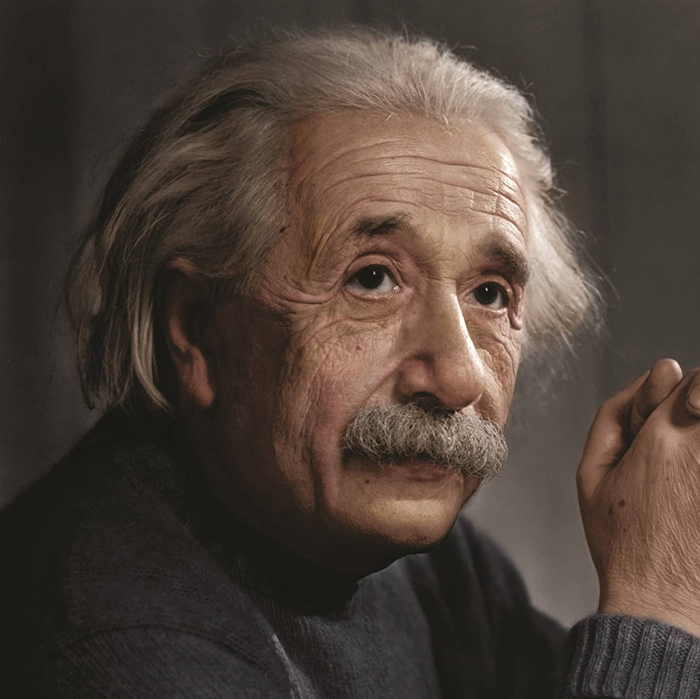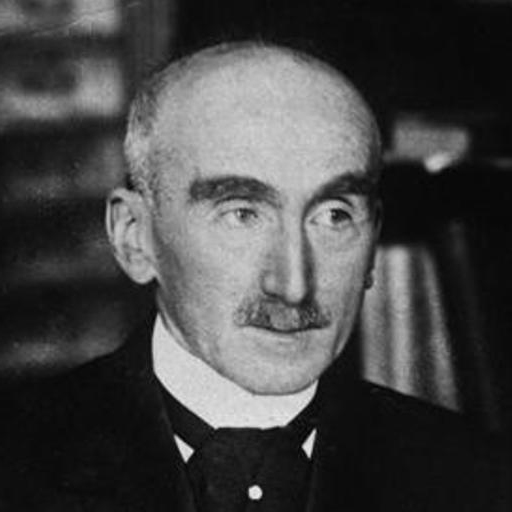Comment éviter le pire ?
La montée en puissance de l’islam, comme l’indolence résignée des nihilistes, ne présagent rien de bon pour l’avenir de l’humanité. Pour qui est attaché à la raison et au doute, pour qui a peur de l’aveuglement des convictions et des croyances, et de la violence qui en résulte, cette situation est difficilement tenable. S’il n’y avait pas le danger, je pourrais me contenter du doute. Je vis assez bien avec. On peut facilement douter de tout, mais difficilement croire en n’importe quoi.
Mais la force est du côté de ceux qui croient. La force est du côté de celui qui s’abîme dans l’absolu. Celui qui se perd et s’oublie, est capable de tout. Du pire bien souvent. Comment éviter le pire ?
Doute et Foi
Le doute est le point de départ de la philosophie : la réflexion commence avec la mise en question. La croyance est le point de départ de la foi : l’abandon dans quelque chose de plus grand que nous, la confiance absolue dans la vérité d’un objet inconnu. Comment marier le doute — indispensable pour qui aime la vérité — avec les croyances — indispensables pour qui veut espérer, aimer et vivre ? Comment croire sans abandonner la vérité, comment penser sans perdre espoir ? Comment, pour celui qui pratique le doute, prendre exemple sur ceux qui croient et prendre cette force ?
Acte de croyance et objets de croyances
Le seul moyen de ne pas abandonner la vérité, c’est de conserver le doute sur ce qui est incertain, et d’admettre ce qui est sûr. En se laissant la marge de manoeuvre pour en douter, au besoin. Le doute aura toujours la raison pour lui.
Croire en quelque chose. Il y a là un acte (croire), et un objet (quelque chose). La force du croyant, c’est dans l’acte de croire qu’il la puise, pas dans l’objet de la croyance, ni dans la véracité de cet objet. Il faut donc garder ce qui donne la force (l’acte), et forger des objets de croyances moins excessifs que ceux qui ne croient en rien, ou en Dieu.
Nihilistes et Religieux
Ceux qui pensent ne croire en rien se mentent à eux-mêmes et affichent seulement un manque de lucidité sur leur fonctionnement. C’est un « non » lancé à la cantonade, de même que la Foi est un « oui » lancé au monde. Quoi qu’il en soit, « Rien » (pour les nihilistes) ou « Tout/Dieu » (pour les religieux) sont des objets de croyances hors de la portée de la raison. Proposons donc cet exercice à la raison : identifier ses croyances, les expliciter pour les forger et les partager, et garder l’acte de croire pour celles que la raison aura validées. Nous pourrons alors — avec un risque moindre — nous abandonner raisonnablement dans une croyance, non nocive. Les grands thèmes de la philosophie sont d’ailleurs résumés à cela : les concepts pour lesquels l’éclairage de la science n’a pas suffit à tout résoudre, et qui impliquent toujours, pour avancer, un mariage de raison et de croyance.
Mes croyances
Je propose ici quatre croyances que j’ai, et dans lesquels je peux puiser une certaine force, quand le doute se calme. Ce n’est pas exhaustif, c’est valable maintenant et pour moi, et discutable, bien sûr (doute oblige).
Deux croyances individuelles, et deux croyances collectives.
Amour et Liberté
Au niveau individuel, je crois à l’existence de l’amour et de la liberté. Ce sont deux choses dont l’existence même peut être mise en doute, mais dans lesquelles je crois, et qui me sont indispensables. Je pense que l’amour vécu et partagé peut apporter du bonheur. L’acte d’aimer est la quintessence de la croyance. Dieu est amour, parait-il. L’amour c’est le don et la confiance, aussi.
Je pense que la liberté individuelle, vécue et assumée, peut apporter du bonheur. Toujours accorder à l’autre une part de liberté n’est pas si facile, mais tellement profitable pour tout le monde quand on le pratique. Tellement indispensable, que ce soit en pensée ou en acte. C’est garder à chaque être humain sa dignité. Il est important de savoir ce que l’on aime, qui l’on aime, et où notre liberté nous porte.
Progrès et Vérité
Au niveau collectif, je crois à l’existence du progrès et de la vérité. Ce sont deux choses dont l’existence même peut être mise en doute, mais dans lesquelles je crois, et qui me sont indispensables. La vérité est le lieu d’échange de l’intellect (comme les sens sont les lieux d’échanges des corps), et le progrès est ce but commun regroupant tous les humains de bonne volonté. La croyance dans le progrès est la croyance dans la possibilité d’un progrès : non pas que tout ira forcément mieux demain qu’aujourd’hui, mais qu’avec beaucoup d’efforts, de chance et de bonne volonté, les choses peuvent aller mieux demain qu’aujourd’hui, que le pire n’est jamais sûr. Toujours identifier ce qui fait régresser ou progresser l’humanité, et choisir le progrès à long terme est souvent une bonne politique. En tout cas, refuser ce qui fait clairement régresser.
Suite …
Bien d’autres croyances existent, dans ma tête comme dans la vôtre. Je disais plus haut que tout cela était discutable, et heureusement : on en discute ?