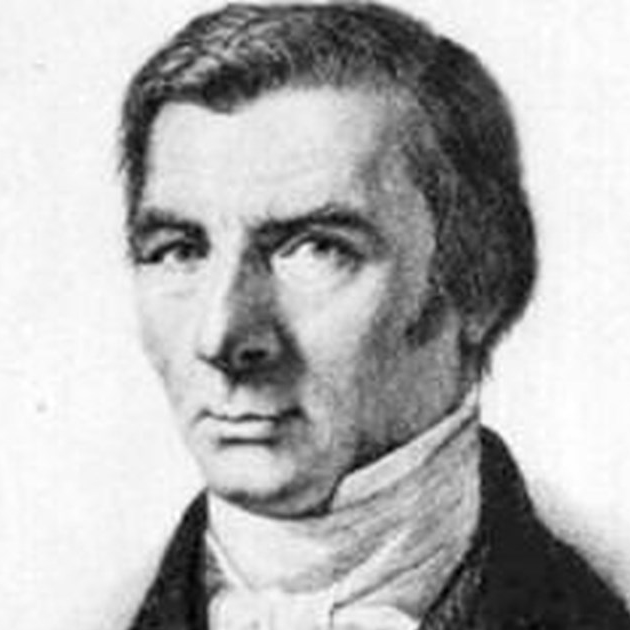Plus j’étudie le Bitcoin, et plus je suis les actualités concernant cette révolution pacifique, et plus je constate l’existence d’un éléphant au milieu de la pièce, soigneusement laissé de côté par les politiciens (presque tous) et une partie des médias. Cette petite clique fait mine de s’affairer autour du budget, et d’obscures « économies » de 40 milliards. Quand la dette du pays est estimée à 3420 milliards. On a passé des mois à commenter des choses qui sont de l’ordre de 1% du sujet. Bref : du théâtre.
Ce qui bouge aux USA
En suivant un peu les actualités, et ce que met en place l’administration Trump, on voit qu’une dévaluation du Dollar arrive (ainsi qu’une utilisation massive des StableCoins et du Bitcoin comme réserves de valeur). C’est un sujet massif, qui va déstabiliser, ou en tout cas modifier, les équilibres mondiaux sur le commerce et la finance. Voyez par exemple l’analyse de l’excellent Yves Choueifaty (@YChoueifaty), qui fait bien de rappeler les fondamentaux de l’Ecole Autrichienne sur la Valeur (subjective comme l’avait déjà expliqué Bastiat, Harmonies Economiques, chapitre V). Donc pendant que nous parlons du 1% de notre dette, les USA préparent un ré-ancrage monétaire massif de leur système financier sur le Bitcoin avec une dévaluation de la monnaie. On rigole.
L’éléphant
Alors quel est cet éléphant ? L’éléphant au milieu de la pièce, c’est le fait que la main mise des Gouvernements et des Etats sur les monnaies conduit à un appauvrissement permanent de la population. Nous sommes contraints, comme le rappelaient Pascal Salin, Jon Black (@JonBlackFR), Saifedean Ammous (@saifedean) ou encore Ludovic Lars (@lugaxker), d’utiliser les monnaies fiat, qui sont de très mauvaise qualité. Pourquoi ? Parce qu’elles sont dans les mains discrétionnaires des « dirigeants », qui se servent bien entendu de la possibilité d’en « créer » régulièrement de nouvelles quantités pour financer leurs dépenses folles. Bien sûr à l’ère du digital, ils n’impriment ou ne créent rien : ils jouent sur les taux directeurs des Banques Centrales, et autorisent les banques à mettre en circulation de nouvelles quantités de monnaies, sans adosser cela à aucune réserve de quoi que ce soit. La valeur de nos euros est donc dans leur main, à leur bonne volonté. C’est cela l’éléphant. Il est aisé de voir le phénomène si on regarde le temps long : la création monétaire est permanente, et ce ne sont pas les prix des choses qui montent intrinsèquement, c’est leur valeur mesurée dans une monnaie sans cesse dévaluée par l’inflation monétaire. Allez voir chez Jon, par exemple. Ce fonctionnement est hautement spoliateur car bien sûr tout le monde n’est pas à la même distance de la « planche à billet ». Ceux qui en bénéficient en premier profitent d’un enrichissement relatif (afflux de fonds avant l’augmentation des prix), et les derniers se font avoir (augmentation des prix sans afflux de fonds). L’L’effet Cantillon est le nom de ce différentiel d’enrichissement. Ce n’est pas un petit phénomène; c’est massif, comme un gros éléphant. Le dollar a perdu depuis les années 1900 plus de 90% de sa valeur – 1$ vous permettait d’acheter 150 gr d’or en 1900, et seulement 2 gr en 2010(source Les Crises).
Le cul de l’éléphant
Très bien, donc les « dirigeants » pillent l’épargne via de la création monétaire non contrôlée. Mais si on fait le tour de la pièce, on se retrouve au cul de l’éléphant. Et ce n’est pas beau à voir. Je crois que c’est grâce à une vidéo de la chaine HowToBitcoin (@howtobitcoin_fr) : puisqu’ils peuvent créer de la monnaie à partir de rien, pourquoi est-ce que l’on continue à payer des impôts ? C’est vrai : faire rentrer 500 milliards dans les caisses de l’Etat en bloquant la prospérité et l’incitation à créer de la richesse, c’est idiot. Pourquoi ne pas supprimer les impôts et financer le fonctionnement de l’Etat par la dette ? Pour une raison simple : l’Etat français ne peut emprunter sur les marchés financiers que parce qu’il considéré comme solvable, et la seule manière de l’être c’est de montrer qu’on peut aller prélever de l’impôt avec un bon taux de recouvrement. Vu comme cela, l’impôt est donc le moyen d’asservissement, par la spoliation, des populations, afin de pouvoir continuer à cramer la richesse des générations futures. Immoral, vous avez dit ?