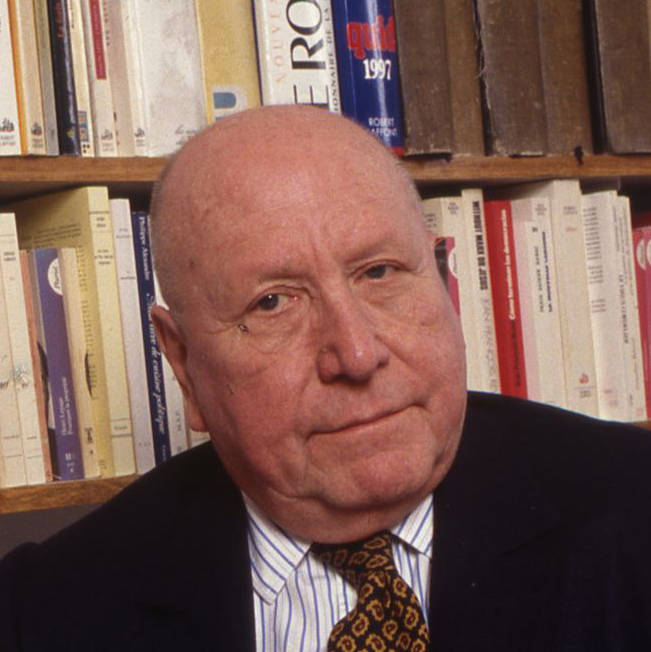Dans les grands débats du mardi, sur BFM, Philippe Manière envisageait les réformes de la fonction publique accomplies dans les pays scandinaves, et notamment en Suède, et que Nicolas Sarkozy pourrait appliquer en France pour réduire les budgets de fonctionnement de l’Etat. Le débat était assez dépassionné, et pour cause les interlocuteurs n’étaient pas vraiment partie prenante, mais plutôt des analystes et des observateurs, suédois ou non. Il y avait dans cette discussion :
- Nicolas Lecaussin, Directeur de l’Institut Français pour la recherche sur les Administrations Publiques (Ifrap), Auteur de « Cet Etat qui tue la France » aux éditions du Plon, Rédacteur en chef de la revue Société civile.
- Marie-Laure Le Foulon, Correspondante du quotidien Le Figaro pour la Scandinavie, Auteur du livre « Le rebond du modèle scandinave » aux éditions Lignes de repère.
- Magnus Falkehed, Journaliste suédois indépendant, Auteur du livre « Le Modèle suédois : santé, services publics, environnement, ce qui attend les Français » aux éditions Payot.
Un relatif consensus s’est établi assez rapidement sur deux points :
- la nécessité d’une grande transparence dans les finances de la fonction publique, préalable indispensable à toute réforme juste, et appliquée de manière pédagogique
- la nécessité de modifier le statut des fonctionnaires pour assouplir le fonctionnement et la qualité du service public, dans le souci de plus de justice (comment justifier que certains citoyens soient complètement protégés des contraintes économiques et d’efficacité responsable, tandis que d’autres les supportent quotidiennement?)
Il y a avait un contraste assez frappant entre le ton assez tranquille avec lequel les invités tombaient d’accord sur ces sujets, alors même qu’ils sont (étaient?) systématiquement évités comme des tabous dans les médias français : les langues commencent à se délier…!
Pour preuve, lorsque le présentateur demande à Falkehed de conclure en disant ce que selon lui Sarkozy peut faire pour mener à bien ces réformes, la réponse tombe :
N. Sarkozy devrait envoyer Philippe Séguin [Premier Président de la Cour des Comptes] faire les comptes des centrales syndicales, qui n’auraient plus qu’à se taire, et les réformes passeraient en douceur !
Le moins qu’on puisse dire, c’est que ce n’est pas de la langue de bois !