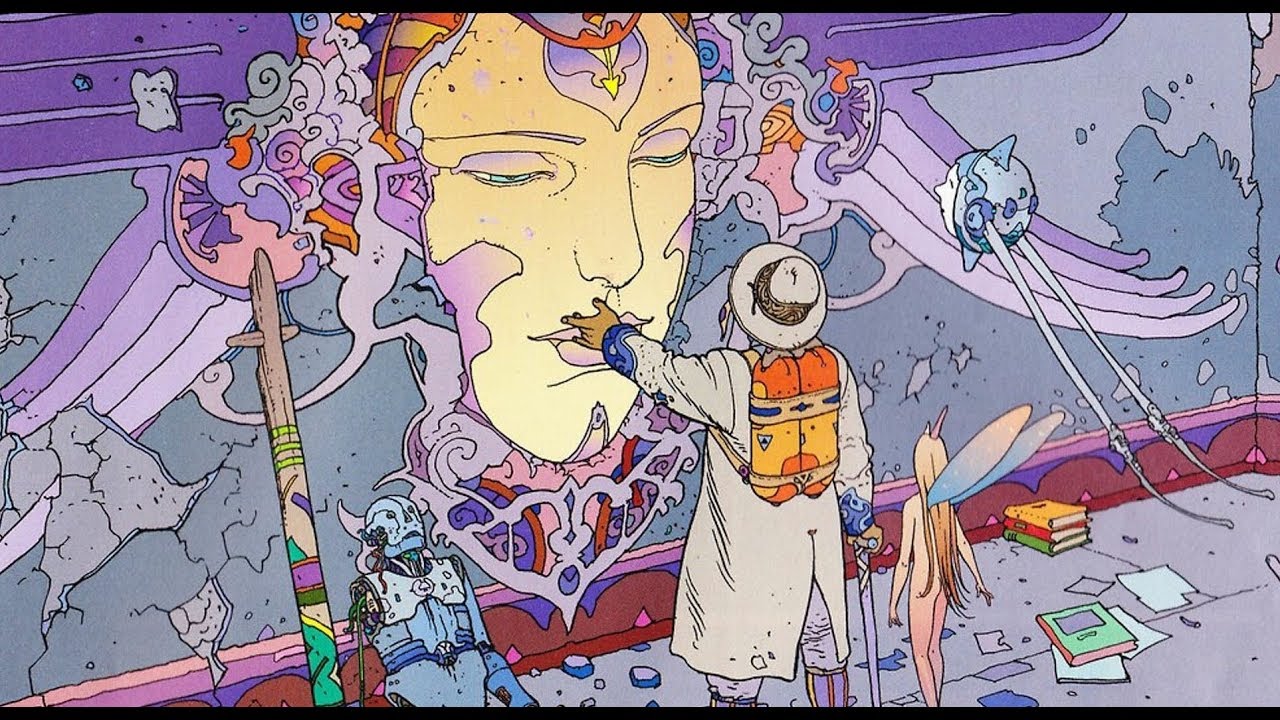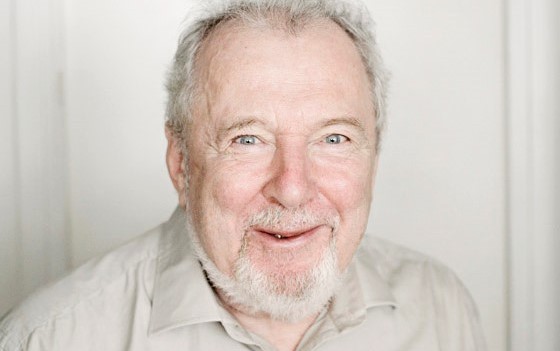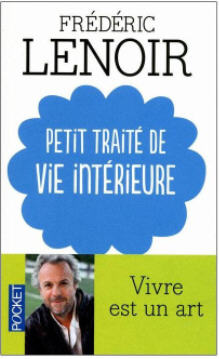Je viens de terminer le formidable livre de Clément Rosset « Le réel« , sous titré « Traité de l’idiotie ». Il y parle du réel, de la réalité.
Remettant en question la quête obstinée de la philosophie à vouloir percer le sens et la raison du devenir et de l’histoire, Clément Rosset entend rendre le réel à lui-même, à l’insignifiance. Il ne s’agit pas pour lui de décrire la réalité comme absurde ou inintéressante, mais à dissiper les faux sens qui l’entoure : il n’y a pas de mystères dans les choses, il y a un mystère des choses. Inutile de creuser les choses pour leur arracher un secret qui n’existe pas, c’est dans leur existence que les choses sont incompréhensibles.
Articulation entre représentations et réel
J’ai trouvé ce livre vraiment jouissif à lire, profond et sans concession. Il alimente et questionne mes réflexions sur le sens. Un renversement de perspective me paraitrait intéressant, puisque la problématique est tout de même bien, pour nous autres pauvres humains, celle de l’articulation entre les représentations et le réel (Rosset finit son essai par une réflexion sur le langage qui manque toujours le réel). Rosset me donne l’impression qu’il pense le réel comme « le monde sans l’humain » ? De mon point de vue, les représentations du réel font partie du réel. Car le réel est pour moi tout ce qui existe, et je trouve pour cela le découpage de Popper utile et intéressant. Bien sûr, nos représentations manquent toujours la coïncidence exacte avec le réel (c’est presque un truisme) ; mais nos représentations font partie du réel (elles existent), et leur seul attribut, ou fonction, n’est pas cette coïncidence avec leur objet. Car restreindre la valeur des représentations au fait qu’elles coïncident avec le réel, c’est les condamner d’emblée. Nos représentations surchargent le réel de sens, certes. Sens qui n’est pas dans le réel, mais bien contenu dans nos représentations. Je pense pour ma part, et c’est le sens de l’essai que je travaille, que ces représentations et ce sens sont une fonction des humains. Quelles interactions entre nos représentations et le réel ? A quoi cela peut-il servir de générer du sens en permanence dans un monde qui en est, à l’évidence, dénué ? Voilà les questions qui me viennent naturellement en rebond et dans le prolongement de ce livre incontournable.