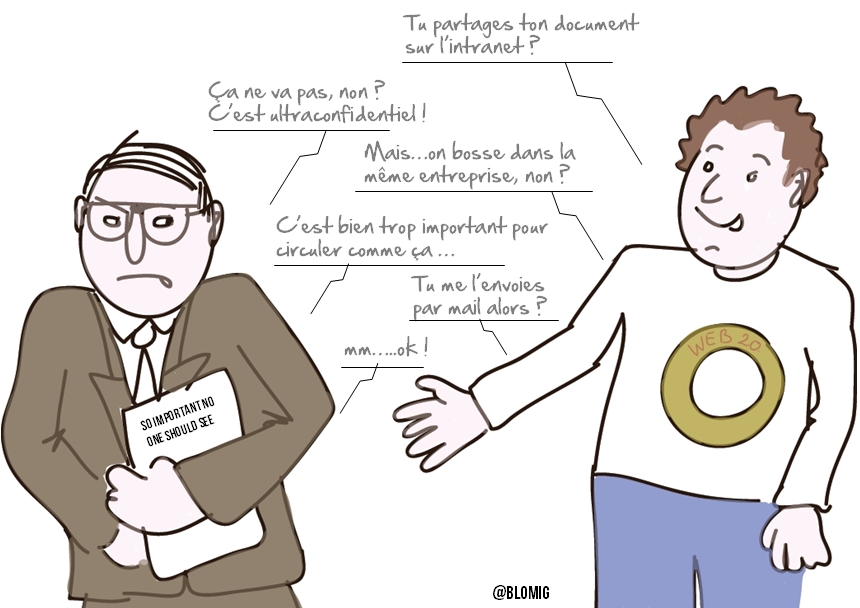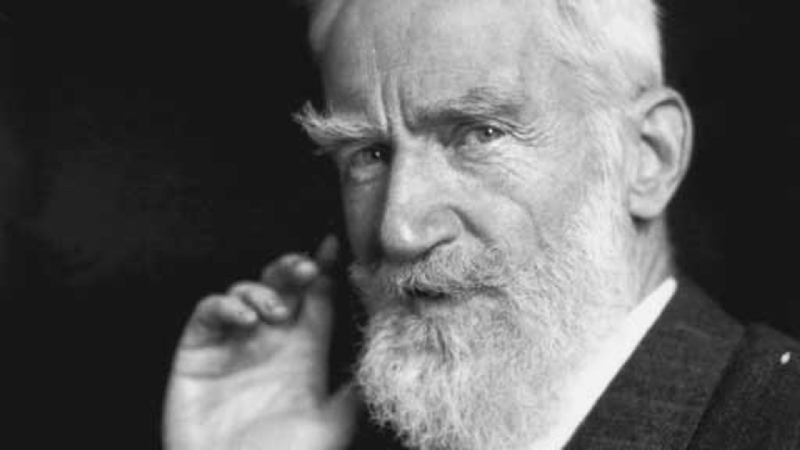J’ai eu la chance de pouvoir suivre une semaine de formation à Mines ParisTech. L’intitulé était clair : « Conception de produits et innovation, raisonnements de conception et organisation de la firme innovante« . C’était tout simplement génial : passionnant, riche d’exemples historiques ou actuels / vécus (par le biais de conférences). Cela m’a permis de mieux comprendre mon travail, l’articulation entre l’amont et l’aval, et j’ai trouvé utile de partager. Voici donc quelques éléments qui structurent cette semaine de cours. J’ai écrit plus récemment un article pour redonner les grandes lignes de qui me sert au quotidien.
Régimes de conception
La formation commence par donner un cadre général, historique, à l’activité de conception, en rappelant le paradoxe bien connu de l’innovation : il ne suffit pas d’injecter plus d’argent dans la R&D pour que l’innovation fonctionne bien (voir le rapport Booz). Pour avancer dans la compréhension de ce paradoxe, il faut décrire deux régimes de conception différents : le régime de conception réglée, et le régime de conception innovante. Qu’est-ce qu’un régime de conception ? Un régime de conception est une forme de conception industrielle caractérisée par sa viabilité, et la conception industrielle est une forme d’action collective caractérisée par :
- des raisonnements de conception
- une forme d’organisation collective
- une logique de performance
Pour décrire les deux régimes assez différents de « conception réglée » et « conception innovante », il faudra donc décrire, pour chaque régime, chacune de ces 3 dimensions (raisonnements, organisation, performance).
Conception réglée
La conception réglée est ce que nous connaissons au quotidien, dans la plupart des secteurs de l’ingénierie tout au moins. C’est le coeur de métier : être capable de passer d’une lettre d’intention produit à un produit physique est un exploit industriel réel. Et ce régime de conception réglée peut être décrit comme suit :
- Le raisonnement : les raisonnement de la conception réglée sont exprimés dans des langages, qui sont les suivants :
- Design fonctionnel : clarification du produit & spécification
- Design conceptuel : Espace des fonctions et des sous-fonctions, mobilisation de modèles conceptuels (sélection et évaluation)
- Embodiment design : conception physico-morphologique – « mise en organisme »
- Design détaillé
- Performance : le QCD est l’outil d’évaluation de la performance du régime de conception réglée. Qualité, Coût, Délai : on mesure la dérive par rapport à l’objectif initial sur ces trois éléments fondamentaux, et c’est ce qui permet de piloter le projet, et de gérer les risques.
- Organisation : l’organisation du régime de conception réglée est notre quotidien, et Renault est une firme experte en la matière. L’organisation en projet est le coeur de la conception réglée, avec tous les outils de gestion de projets.
La conception systématique est donc convergente et réutilise au maximum les connaissances acquises sur les projets précédents. La place y est donc restreinte pour les ruptures : celles-ci viennent mettre en péril le QCD, en tout cas augmenter le niveau d’incertitude. Et c’est justement tout l’intérêt de la conception réglée que d’être capable de tenir ce QCD pour mettre en oeuvre des projets importants.
Conception innovante
Un objet ou un service innovant introduit une rupture dans l’identité : l’identité même de l’objet est revisitée. Un Iphone revisite l’identité du téléphone. Twizy revisite l’identité de l’automobile, etc…Si l’identité de l’objet est modifiée dans l’innovation, c’est donc qu’elle est, au moment de la conception, incertaine. Cette incertitude se traduit par une incertitude sur l’un des quatre langages de la conception systématique. Et la conséquence directe est que la conception systématique ne permet pas de concevoir l’identité des objets innovants. Comment concevoir ces objets à l’identité instable ? C’est ce que remplit comme fonction le régime de conception innovante. Passons en revue ses caractéristiques, comme nous venons de le faire pour le régime de conception réglée :
- Raisonnement : la théorie de la conception innovante C-K a été inventée et travaillée à l’Ecole des mines, et il est logique qu’elle soit enseignée dans le cadre de cette formation. C’est une théorie qui permet de rendre compte de la mobilisation des connaissances existantes, de la création de connaissances nouvelles, des alternatives, des « surprises ». Ce type de raisonnement doit permettre de revisiter l’identité des objets / produits / prestations. Dans la pratique, elle est basée sur une distinction importante entre ce qui est de l’ordre des connaissances (Knowledge), c’est-à -dire ce qui a un statut logique défini, et ce qui est de l’ordre des Concepts (ce qui n’a pas un statut logique défini). Je referai un billet pour décrire plus en détail la méthode C-K.
- Organisation : le régime de conception innovante prend plusieurs formes, selon les firmes. Nous avons traité en détail le cas de Tefal. Réutilisation maximale de la connaissance produite, lignées de produits, prototypage rapide, CdC implicite. D’autres exemples sont intéressants comme 3M, Pixar ou Google. Chaque entreprise construit son régime de conception innovante à partir de sa culture, de son passé et de son activité. Il faut garder à l’esprit que tout cela doit être piloté par la valeur
- Performance : comment évaluer la performance de l’activité de conception innovante ? Quatre items sont importants : Valeur de solutions imaginées, Variété des concepts explorés, Originalité des partitions réalisées dans l’espace des concepts, et Robustesse (Risques) des solutions. Ces items sont regroupés en V²OR.
RID : Recherche – Innovation – Développement
Pour finir, je voudrais revenir sur une proposition intéressante de l’Ecole des Mines. Ils reviennent sur le dialogue habituel entre R (Recherche) et D (Développement), et ils y introduisent le I de l’Innovation, pour former un système « RID ». Quelques définitions utiles :
- La Recherche est un processus contrôlé de production de connaissance
- le Développement est un processus contrôlé, activant les compétences existantes pour spécifier un système en accord avec le cahier des charges prédéfini
- L’Innovation définit la valeur, et est un processus de construction des compétences
Ces définitions permettent de construire le tableau suivant, utile pour bien cerner les différents champs d’activité, tous utiles et complémentaires, mais dont l’articulation n’est pas simple.
| « ‹ | Recherche (R) »‹ | « ‹Conception Innovante (I) | Conception Réglée (D) »‹ |
|---|---|---|---|
| Mission »‹ | « ‹Répondre à des questions indépendantes de la science | Investiguer des champs d’innovation | Répondre aux « ‹spécifications du client |
| « ‹Buts | « ‹Connaissances validées | « ‹Stratégies de conception (plateformes, lignées de produits, etc…) | « ‹Accomplir des projets |
| « ‹Ressources / moyens | « ‹Laboratoires, groupes de compétences, universités, littérature, … | « ‹Groupes coordonnés d’exploration et de gestion de la valeur | « ‹Equipes projet, tâches |
| « ‹Horizon | « ‹Dépend des techniques d’investigation | « ‹Contingent & stratégique (jalons stratégiques) | Fin du projet, jalons projet |
| « ‹Valeur économique | « ‹Valeur de la question initiale | « ‹Gestion des risques, stratégies alternatives et utilisation maximale de la connaissance | « ‹Valeur du projet |
Qu’en pensez-vous ? N’hésitez pas à rebondir ou à éclairer ce billet par votre expérience, pour amorcer la discussion !
Deux liens pour aller plus loin :