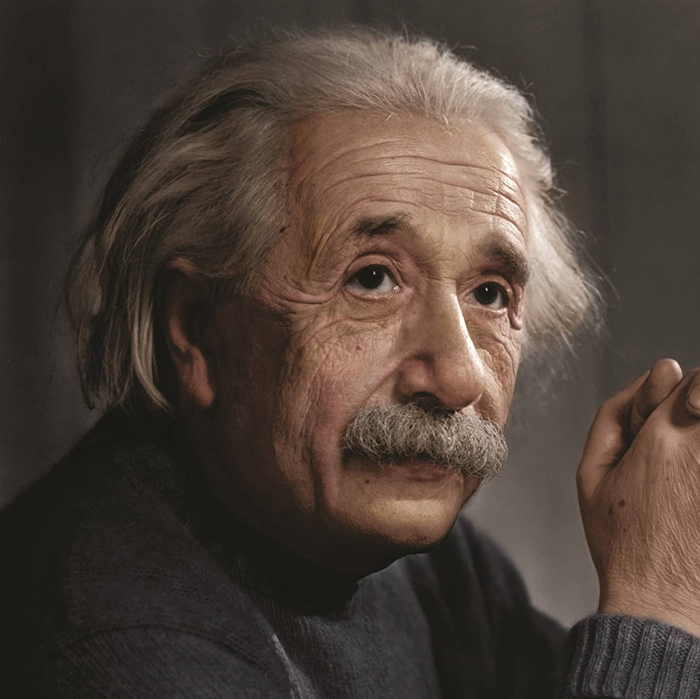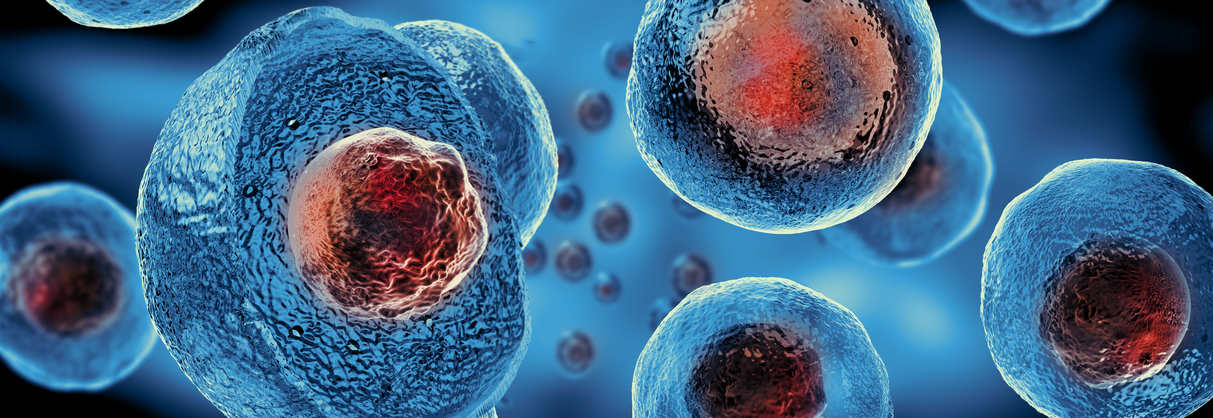J’ai regardé hier soir, sur Presentation Zen, une excellente conférence du Dr. Stuart Brown. Il y est question du jeu, et de son importance dans le développement des animaux en général, et des humains en particulier. Différents types de jeux sont présentés : le jeu avec le corps, le jeu avec les objets, le jeu de groupe, le jeu solitaire.
Les études scientifiques montrent que c’est l’aptitude au jeu qui explique en partie notre faculté d’adaptation. Le jeu a une place biologique, une fonction, comme le sommeil et les rêves. On y parle un peu aussi de motivations internes, car bien évidemment le fait qu’il y ait une part de jeu dans nos activités nous motive grandement pour les réaliser avec passion et énergie.
Et puis dans la présentation, le Dr Stuart Brown parle d’une expérience avec des souris, pour illustrer son propos. Comme j’avais été sensible aux expériences citées par Laborit, j’ai été aussi intéressé par celle-ci.
Deux groupes de souris sont utilisés : l’un peut jouer, et l’autre ne peut plus jouer (les expérimentateurs les empêchent de développer l’aptitude au jeu). On place ensuite le groupe dans un endroit où il y a une odeur très marquée de chat, et une porte de sortie vers un trou protecteur. Tous les rats fuient bien sûr, pour se sauver. Et on observe ensuite deux comportements différents : les rats qui n’ont pas développés l’aptitude au jeu ne ressortent jamais du trou où ils se sont cachés. Ils meurent. L’autre groupe, celui des chanceux que l’on a laissé vivre normalement, avec le jeu, est plus adapté : les rats finissent par explorer, chercher à sortir, regarder ce qui se passe. On mesure là toute l’importance du jeu dans la construction cognitive. Mais assez parlé : l’original est bien mieux. Bon visionnage (pour les nuls en anglais comme moi, n’oubliez pas d’activer les sous-titres, ils ne sont qu’en anglais, mais ça aide quand même) !