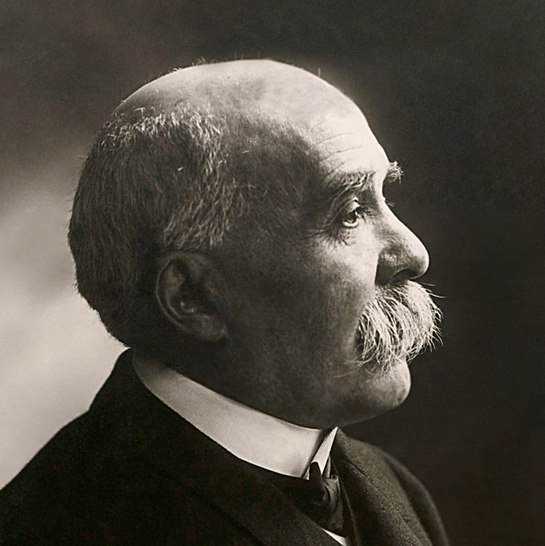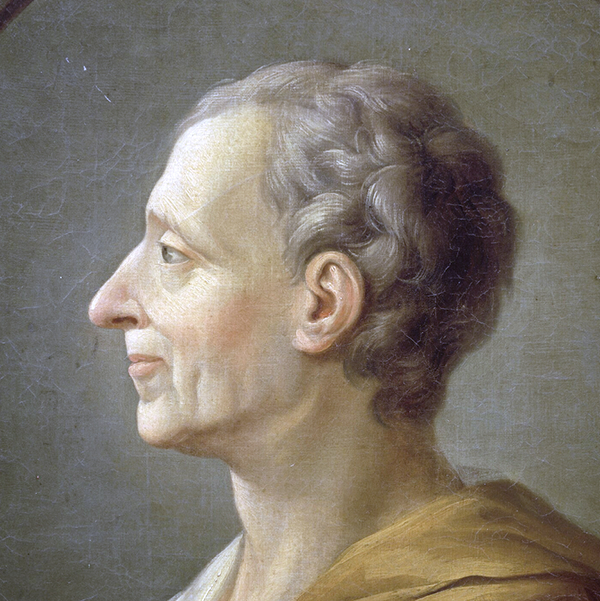Il y a un mois, un gars dans une formation a évoqué – pour illustrer son propos – les 4 vertus cardinales. Comme je n’aime pas trop rester dans l’ignorance, je suis allé chercher ce que c’est, et je vous livre le résultat de mes recherches.
Tout d’abord, qu’est-ce qu’une vertu ?
Vertu : Disposition habituelle, comportement permanent, force avec laquelle l’individu se porte volontairement vers le bien, vers son devoir, se conforme à un idéal moral, religieux, en dépit des obstacles qu’il rencontre.
Beau programme, n’est-ce pas ? Cela donne envie d’être vertueux…
Les quatre vertus cardinales sont les suivantes : Prudence, tempérance, force et justice. Le christianisme considère qu’elles jouent un rôle central (cardinale vient de « cardo », qui signifie = charnière, pivot) dans l’action humaine, et pour le comportement des hommes entre eux. Elles sont issues de l’antiquité (Platon, Aristote, philosophes stoïciens). Voilà les définitions que l’on peut trouver sur Wikipédia et Lexilogos, assorties de quelques citations piochées sur Evene. Je ne suis l’auteur de rien dans cet article, ce ne sont que des copiés-collés, mais ces définitions donnent à réfléchir, je trouve. Et permettent de se poser les questions : suis-je vertueux ? La vertu est-elle un idéal à viser ou non ?
Prudence
La prudence dispose la raison pratique à discerner en toute circonstance le véritable bien et à choisir les justes moyens de l’accomplir.
Définitions :
- Première vertu cardinale, celle qui allie force d’esprit, faculté de discernement, connaissance de la vérité dans la conduite de la vie.
- Qualité, attitude d’esprit de celui qui prévoit, calcule les conséquences d’une situation, d’une action qui pourraient être fâcheuses ou dangereuses moralement ou matériellement, et qui règle sa conduite de façon à les éviter
La prudence ne prévient pas tous les malheurs, mais le défaut de prudence ne manque jamais de les attirer.
[Proverbe espagnol]
Tempérance
La tempérance assure la maîtrise de la volonté sur les instincts et maintient les désirs dans les limites de l’honnêteté, procurant l’équilibre dans l’usage des biens.
Définition :
Modération, sobritété, retenue, mesure
La tempérance est un arbre qui a pour racine le contentement de peu, et pour fruits le calme et la paix.
[Ferdinand Denis]
Force
La force, c’est-à -dire le courage, assure dans les difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite du bien, affermissant la résolution de résister aux tentations et de surmonter les obstacles dans la vie morale.
Définition :
Ensemble des ressources physiques, morales ou intellectuelles qui permettent à une personne de s’imposer ou de réagir.
C’est la force et la liberté qui font les excellents hommes. La faiblesse et l’esclavage n’ont fait jamais que des méchants.
[Jean-Jacques Rousseau]
Justice
La justice consiste dans la constante et ferme volonté de donner à chacun ce qui lui est dû.
Définition :
Principe moral impliquant la conformité de la rétribution avec le mérite, le respect de ce qui est conforme au droit.
L’injustice ne se trouve jamais dans les droits inégaux, elle se trouve dans la prétention à des droits égaux.
[Friedrich Nietzsche]
Bien sûr, personne n’est à la fois prudent, fort, juste et faisant preuve de tempérance ; mais on doit essayer d’y tendre, non ?
Rappelons que les vertus sont des attitudes fermes, des dispositions stables, des perfections habituelles de l’intelligence et de la volonté qui règlent les actes, ordonnent les passions et guident la conduite.
Elles procurent facilité, maîtrise et joie pour mener une vie moralement bonne. L’homme vertueux, c’est celui qui librement pratique le bien.
Sources :