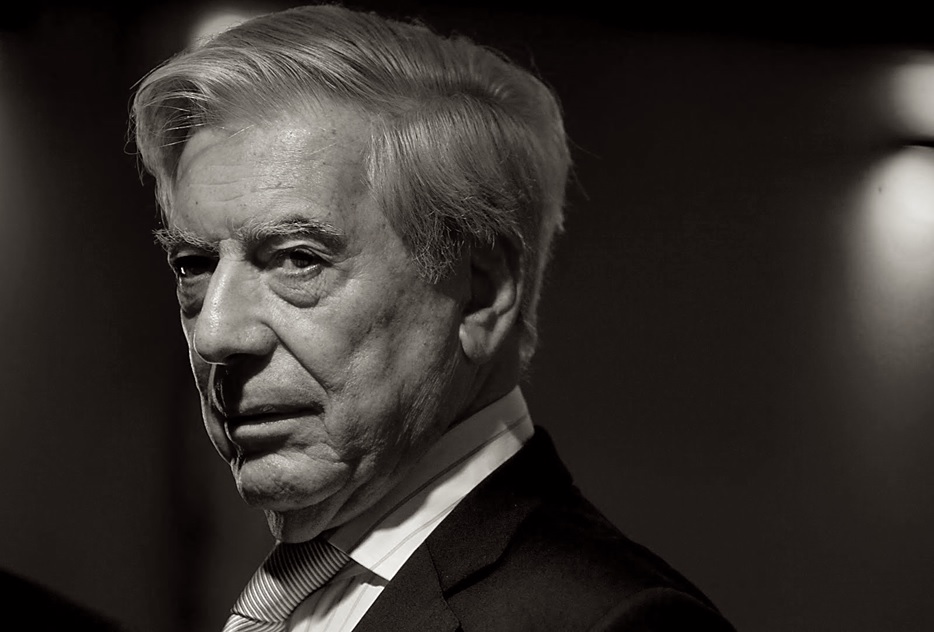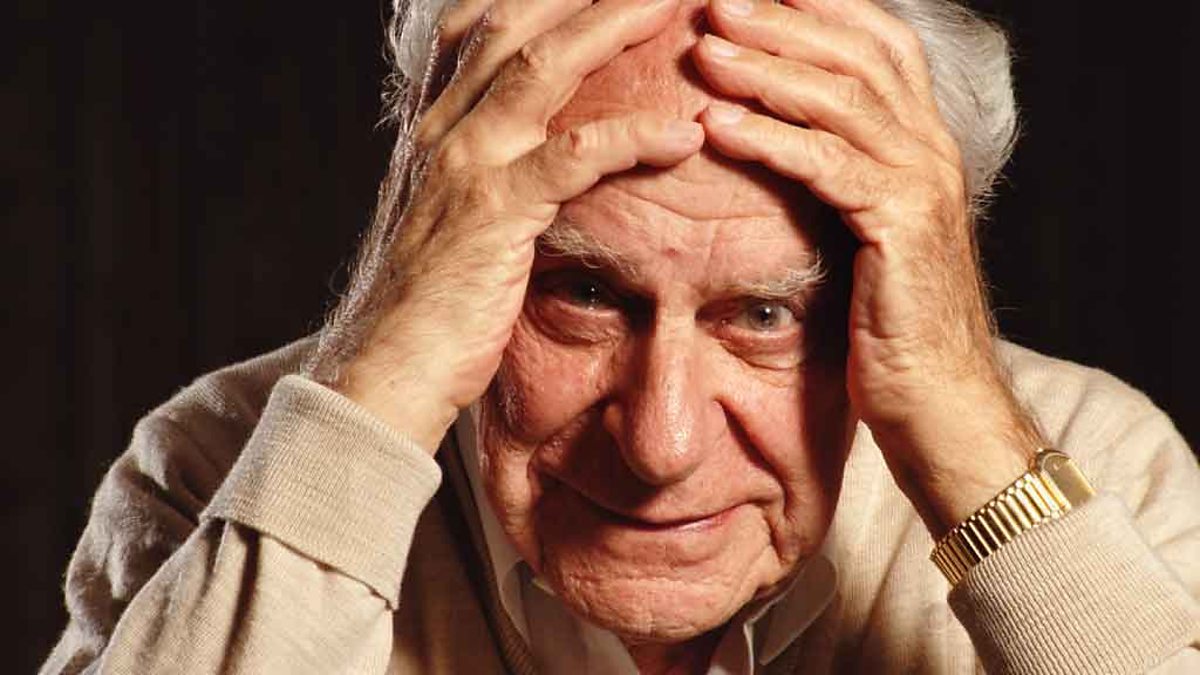Le recueil d’essais de Charles Larmore, « Modernité et morale » (aux Editions PUF), est un livre essentiel dans tous les sens du terme : les sujets traités me paraissent être importants, centraux, et la manière de les aborder est dense, précise, humble et ambitieuse à la fois. Je vais ici faire une brève recension des thèmes abordés, et je m’appuierai dessus pour d’autres billets. Le livre est trop dense pour être « résumé » dans un billet de blog. J’ai corné les pages, et noirci le livre de notes. Un excellent bouquin qui m’a accompagné cet été, et dont je relirai à coup sûr certains passages. C’est un livre d’une grande clarté, et d’une complexité assez élevée : les raisonnements, solides, vont vite à l’essentiel. Il faut s’accrocher un peu. La clarté, pour Larmore et la philosophie analytique, est une approche rationnelle, et logique, de l’argumentation :
Une position philosophique est claire dans la mesure où l’on spécifie les conditions dans lesquelles on l’abandonnerait.
Cette phrase résume bien l’éthique de la pensée chère à Larmore. L’introduction de son livre vise à expliquer que selon lui la philosophie n’a pas besoin de se prendre elle-même pour objet, et que les a priori des deux grandes écoles de philosophie (analytique et phénoménologique) sont à rejeter. Il reste, et c’est un des succès de la philosophie analytique, une éthique de la pensée, visant clarté et adéquation au réel.
Car il y a non seulement des normes pratiques concernant comment il faut agir, mais aussi des normes cognitives concernant comment il faut penser. En conséquence, il y a des vertus intellectuelles aussi bien que des vertus morales. (…) Au coeur de ce que je conçois comme l’éthique de la pensée, en philosophie comme dans tout domaine, est l’honnêteté intellectuelle qui reconnait la probabilité de l’erreur et l’assume par la recherche de la clarté.
Connaissance morale
La première partie vise à établir dans quel sens une connaissance morale est possible. C’était la raison de l’achat de ce livre : en lisant Popper, je m’étais posé cette question. Larmore y répond de manière magistrale et simple, il me semble. Et en s’appuyant sur des raisonnements, et une vision de la réalité proche de celle de Popper : un réalisme critique, faisant de la place, dans le réel, à côté des objets tangibles, et des ressentis psychologiques, aux normes et aux idées. Pour plus de détails, voir mon article résumant la description du réel par Karl Popper.
Larmore amène des éléments très intéressants dans la manière dont nous devons concevoir les faits moraux, en les situant explicitement dans le monde 3 de Popper :
Il suppose (…) que s’il existait des faits moraux, ils devraient ressembler aux faits physiques et psychologiques en étant accessibles à la perception ou à l’observation ; étant donné cette supposition, la manière dont de tels faits peuvent jouer un rôle dans la causalité psycho-physique doit certainement paraitre mystérieuse. Mais on n’a pas besoin de concevoir ainsi les faits moraux. Au lieu d’être un élément supplémentaire du monde perceptible, les faits moraux peuvent se concevoir comme des raisons, donc comme faisant partie de l’ensemble des raisons de croire et d’agir que nous pouvons reconnaître, non par la perception, mais par la réflexion.
Larmore, in fine, pense – et je suis en accord avec lui – que « le naturalisme est un des grands préjugés de notre époque ».
Or nous devons admettre que le monde (…) englobe non seulement la réalité physique et psychologique, mais également une réalité normative. Ou, comme les sophistes, nous devons renoncer à la raison pour nous abandonner à la persuasion. Loin d’être légitimé par les succès de la science moderne, le naturalisme, comme le non-cognitivisme moral qu’il inspire, s’avère l’ennemi mortel de la raison.
Coïncidence ? Un des blogs que je suis vient de publier une copieuse note de méta-éthique sur la « naturalité du Bien, et je pense que je vais commencer par là .
Morale des anciens et des modernes
A la suite de Henry Sidqwick, Larmore explique que l’approche de la morale est radicalement différente selon que l’on considère la notion de juste ou la notion de bien comme fondamentale. Ces deux conceptions par ailleurs, sont un marqueurs de ce qu’est la modernité :
La priorité du bien est au centre de l’éthique grecque, tandis que l’éthique moderne accorde la priorité à la notion de juste.
Kant, et d’autres, on fait émerger cette conception centrée sur le juste de la morale. Le coeur du débat est que le bien n’est plus un terrain d’entente.
C’est un acquis irrévocable du libéralisme politique que le sens de la vie est un sujet sur lequel on a une tendance naturelle et raisonnable, non pas à s’accorder, mais à différer et à s’opposer les unes aux autres. De là , l’effort libéral pour déterminer une morale universelle, mais forcément minimale, que l’on puisse partager aussi largement que possible en dépit de ses désaccords.
Larmore détaille ensuite notre rapport aux croyances, central dans la réflexion morale (on pense toujours dans un ensemble de croyances), et à la connaissance morale.
J’ai déjà fait remarquer qu’il est fort possible de justifier la validité de certaines obligations morales, si au lieu de s’élever à un point de vue absolument détaché, on s’appuie sur la validité d’autres obligtations que l’on accepte déjà . (…) Cette épistémologie repose sur un fait évident et sur deux normes cognitives qui sont aussi importantes qu’elles ont été négligées. Le fait, est que nous nous trouvons toujours en possession d’une multitude de croyances. A ce fait, s’ajoutent les principes suivants : 1/ Il nous faut une bonne raison pour douter comme il nous en faut une pour conclure (…) 2/ Justifier une proposition n’est pas simplement donner des prémisses vraies d’où elle découle, c’est donner des raisons qui dissipent des doutes sur sa vérité. (…) Pris ensemble, ces deux principes ont pour conséquence qu’il ne nous faut justifier une croyance que nous avons déjà que si nous avons d’abord trouvé des raisons de croire qu’elle est douteuse. C’est en cette conséquence qu’apparaît la nouveauté de ces deux principes. D’habitude, on suppose que la raison exige que chacune de nos croyances soit soumise à la justification. (Souvent cette supposition prend la forme de l’exigence que des croyances servant à justifier d’autres croyances doivent elles-mêmes se justifier.) Cette supposition est devenue si habituelle, si irréfléchie que l’on a oublié ses intentions originelles. Elle ne provient pas tant de la raison que de l’aspiration métaphysique à regarder le monde sub specie aeternitatis. (…) La question décisive est donc de savoir si nous voulons d’une épistémologie qu’elle soit un guide à l’éternité ou qu’elle soit un code pour la solution de problèmes. Si nous abandonnons cette aspiration métaphysique et prenons comme règle qu’il faut avoir des raisons positives de croire qu’une croyance existante peut être fausse pour la mettre en doute et donc pour en exiger la justification, la notion que toutes les croyances devraient être justifiées disparaîtra. Le seul fait que nous ayons déjà une croyance, et que nous l’ayons à cause de notre contexte historique, n’est pas une bonne raison de croire qu’elle puisse être fausse ni donc d’exiger qu’elle soit justifiée. De plus, si nous trouvons en effet des raisons positives de la mettre en doute, nous devons continuer à nous appuyer sur nos autres croyances existantes, non seulement pour chercher une solution à ce doute, mais aussi préalablement pour découvrir les raisons positives qui sont à la source de notre doute. Selon cette conception, il n’existe aucune opposition entre enracinement historique et rationalité.
Hétérogénéité de la morale
J’en avais parlé récemment (et Silberzahn aussi dans un très bon billet): un débat existe entre deux approche de la morale : éthique de responsabilité (conséquentialisme) et éthique de conviction (déontologie). Larmore propose une vision plus large, et explique la morale est hétérogène. A nous de nous dépatouiller avec les exigences parfois contradictoires de 3 principes généraux.
J’appelerais ces trois principes : principe de partialité, principe conséquentialiste et principe déontologique. Ils se situent tous trois à un niveau élevé de généralité. Le principe de partialité sous-tend les obligations « particularistes » qui ne s’imposent à nous qu’en vertu d’un certain désir ou intérêt que nous nous trouvons avoir. (…) Le principe de partialité exprime donc une priorité du bien sur le juste. (…) Les deux autres principes pratiques – les principes conséquentialiste et déontologique – sont universalistes et représentent des obligations catégoriques. Le principe conséquentialiste exige que l’on fasse ce qui produira globalement le plus grand bien (la plus grande somme algébrique de bien et de mal), eu égard à tous ceux qui sont affectés par notre action. (…) Le principe déontologique exige que l’on ne fasse jamais certaines choses (ne pas respecter une promesse, dire des mensonges, tuer un innocent) à autrui, même s’il doit en résulter globalement un moindre bien ou un plus grand mal. (…) Contrairement au principe de partialité, ces deux principes impliquent des devoirs qui sont catégoriques et s’imposent à l’agent, quels que puissent être ses désirs ou ses intérêts. Ils expriment, par conséquent, une priorité du juste sur le bien. Il me semble que toute personne réfléchie reconnaît, dans une certaine mesure, les exigences de ces trois principes.
Philosophie politique : libéralisme et romantisme
Je vais devoir sur ce sujet comprendre pourquoi Larmore met sous le terme de « romantisme » ce que j’appelle habituellement « conservatisme » (des courants de pensée valorisant, en opposition à l’individualisme, l’appartenance et les coutumes, la tradition). Au-delà de ce problème sémantique, il me semble qu’il offre une belle piste pour marier les deux, du moins en Occident. Le libéralisme n’est pas un idéal de plus, parmi d’autres ; le libéralisme prend acte de l’impossibilité de mettre tout le monde d’accord et propose un socle minimal de règles éthiques pour rendre possible la vie ensemble.
Il est dangereux de faire du libéralisme une conception de plus parmi toutes les visions partisanes et controversées de la vie bonne, car il ne représentera plus alors la solution crédible à l’un des problèmes moraux et politiques les plus pressants des Temps modernes. Il ne sera plus qu’un autre élément du problème. La conviction que la nature de la vie bonne ne peut vraisemblablement pas faire l’objet d’un accord raisonnable est un trait distinctif de la pensée moderne. Quand il s’agit du sens de la vie, toute discussion entre personnes raisonnables ne tend pas naturellement vers le consensus, comme le pensait Aristote, mais vers la controverse. Plus on parle d’un tel sujet, plus le désaccord croît, même en nous-mêmes, comme le fit observer Montaigne. Le libéralisme a représenté l’espoir que, malgré cette tendance au désaccord sur des questions d’une importance suprême, nous pourrions trouver le moyen de vivre ensemble sans recourir à la force. Dans le libéralisme s’exprime la conviction que l’on peut s’accorder sur une morale élémentaire tout en continuant de se trouver en désaccord sur ce qui donne sens à la vie.
Au bout du compte, cette conviction se révèlera peut-être sans fondement. Il est possible que le libéralisme ne soit qu’un idéal partisan de plus. Mais s’il en est ainsi, alors à moins de se dissoudre dans la lumière d’un Bien compréhensif et irrésistible, l’expérience moderne ne connaîtra qu’un avenir politique où « des armées ignorantes s’affronteront dans la nuit. »
Ce passage m’a fait penser à Von Mises (bizarrement, Larmore ne cite jamais ni Von Mises, ni Hayek, ce qui ne manque pas de me surprendre) :
Le libéralisme est rationaliste. Il soutient qu’il est possible de convaincre l’immense majorité que la coopération paisible dans le cadre de la société sert mieux les intérêts justement compris que les batailles mutuelles et la désintégration sociale. Il a pleine confiance dans la raison de l’homme. Il se peut que cet optimisme ne soit pas fondé et que les libéraux se trompent. Mais alors il ne reste plus aucun espoir pour l’avenir de l’humanité.
Par ailleurs, et c’est autre sujet que Larmore n’aborde pas directement, bien que central, je pense qu’à force d’ouvrir nos sociétés, via l’immigration, à des cultures trop différentes, nous avons sapé cette approche du libéralisme ; il n’est pas possible de faire coexister des cultures trop différentes au même endroit. Le socle commun pour cette approche libérale devient trop restreint.
La question centrale de la philosophie politique : quels sont les principes d’association politique qu’il est juste d’établir ?, est une question morale. Mais c’est une question autrement difficile dans les conditions modernes, où l’on s’est progressivement rendu compte que la vraie religion, le sens de la vie, la nature de la vie réussie sont des sujets sur lesquels les individus raisonnables ont une tendance naturelle, non pas à s’accorder, mais différer et à s’opposer les uns aux autres. Il nous faut alors chercher une morale universelle, mais minimale, que l’on puisse partager aussi largement que possible, en dépit de ces désaccords. C’est la conception du libéralisme politique que je développe et défends dans les essais de cette partie. Tout en me situant dans le camp libéral, je veux pourtant séparer la pensée libérale des idéeaux d’individualisme et d’autonomie que certains de ses grands théoriciens (Kant et Mill, par exemple) y ont associés. En tant qu’effort pour repérer une morale commune en dépit des controverses sur la nature du bien, le libéralisme devrait aussi éviter de prendre parti dans une des principales controverses culturelles des deux derniers siècles, celle qui à partir du Romantisme oppose les partisans de l’individualisme et les champions de l’appartenance à des traditions. C’est en ce sens que j’essai de reformuler la pensée libérale.
J’ai trouvé cette volonté très intéressante, et elle rejoint certaines de mes envies naïves. J’ai donc noté avec attention les auteurs français mentionnés par Larmore (qui a écrit ce livre en français directement, à la demande de Monique Canto-Sperber), dont la pensée lui est proche, et qu’il va falloir que je lise : Luc Ferry (que je connais un peu), Marcel Gauchet et Alain Renaut. Le programme est tracé.