Les prévisions de nombre sièges à l’Assemblée Nationale pour le MoDem sont catastrophiques. Certains – dont Bayrou – crient que le système n’est pas bon, puisqu’un candidat qui a eu 18,5 % de voix au 1er tour des présidentielles se retrouvera avec quelques sièges seulement au parlement. Argument factice : son bon score n’est que le reflet du fait qu’une partie de la population ne s’est reconnu ni dans Sarkozy, ni dans Royal. Un score de circonstance, sans adhésion, et purement orchestré par des médias – malheureusement – complaisants avec le politiquement correct.
Bayrou dénonce un système, crie au loup en évoquant la « concentration des pouvoirs ». Pourquoi ne propose-t-il pas des solutions politiques à la place ? Son programme était plus proche de celui de Sarkozy que de celui du PS : et pourtant il s’est positionné comme un candidat de centre gauche (certainement poussé à droite par l’UMP de Sarkozy qui a récupéré une bonne partie de l’électorat centriste). Après avoir refusé de rentrer dans l’UMP, après refusé de se positionner pour le second tour, après avoir crée dans l’urgence un parti politique mort-né au nom presque comique (MoDem, pourquoi pas ADSL ou Internet?), après avoir passé plus de temps à faire des calculs purement électoraux qu’à définir une politique originale et moderne, on retrouve Bayrou là où il s’est lui-même mis : à deux pas de sa mort politique. Il répète à l’envie que son combat c’est le « pluralisme ». Drôle de manière de promouvoir le pluralisme que d’obtenir 4 ou 5 sièges à l’assemblée nationale !
Résultats de recherche pour « politiquement correct »
-
Bayrou : mort politique annoncée…!
-
A propos
Qui suis-je ?

Salut ! Je m’appelle BLOmiG. J’ai 50 ans. Je suis marié et j’ai trois enfants. Je suis docteur en physique. Et passionné de philosophie, de musique, de politique, mais aussi par la science et la technique, par l’innovation. Ma véritable passion restant, bien sûr, la quête de la vérité.
Deux convictions animent ce que je poste sur ce blog, résumées dans la magnifique citation de Pascal ci-dessous :- il est nécessaire pour penser juste d’apprendre à exprimer ses pensées, à les discuter, à les confronter avec d’autres
- et il est important de maintenir un peu partout des endroits de libre expression totale (sans politiquement correct ni autocensure), c’est la condition d’existence du premier point
Je suis par ailleurs affublé de deux maux (pour notre époque) : je suis libéral, et conservateur. Dit autrement : je suis un farouche adversaire des socialistes, communistes, constructivistes, qui pour servir leur vision des choses sont prêts à sacrifier la liberté, et adversaire aussi des progressistes qui ont dévoyé le bel idéal de « progrès » (qui devrait être une « volonté/possibilité de perfectionnement ») en lui enlevant toutes ses limites, et tout rapport avec le réel.

L’homme est visiblement fait pour penser. C’est toute sa dignité et tout son mérite, et tout son devoir est de penser comme il faut.
Blaise Pascal (1623 – 1662)mathématicien, physicien, inventeur, philosophe, moraliste et théologien français
Contact
Vous pouvez me contacter grâce à ce formulaire :
Votre message a été envoyé
Soutien
Vous pouvez si vous le souhaitez, soutenir mon effort en me payant un café en Bitcoin sur cette adresse de Bitcoin : 33caBvazy19X1zfLSmh8ag7oxJpvMskkyu
ou en scannant le QR code ci-dessous

-
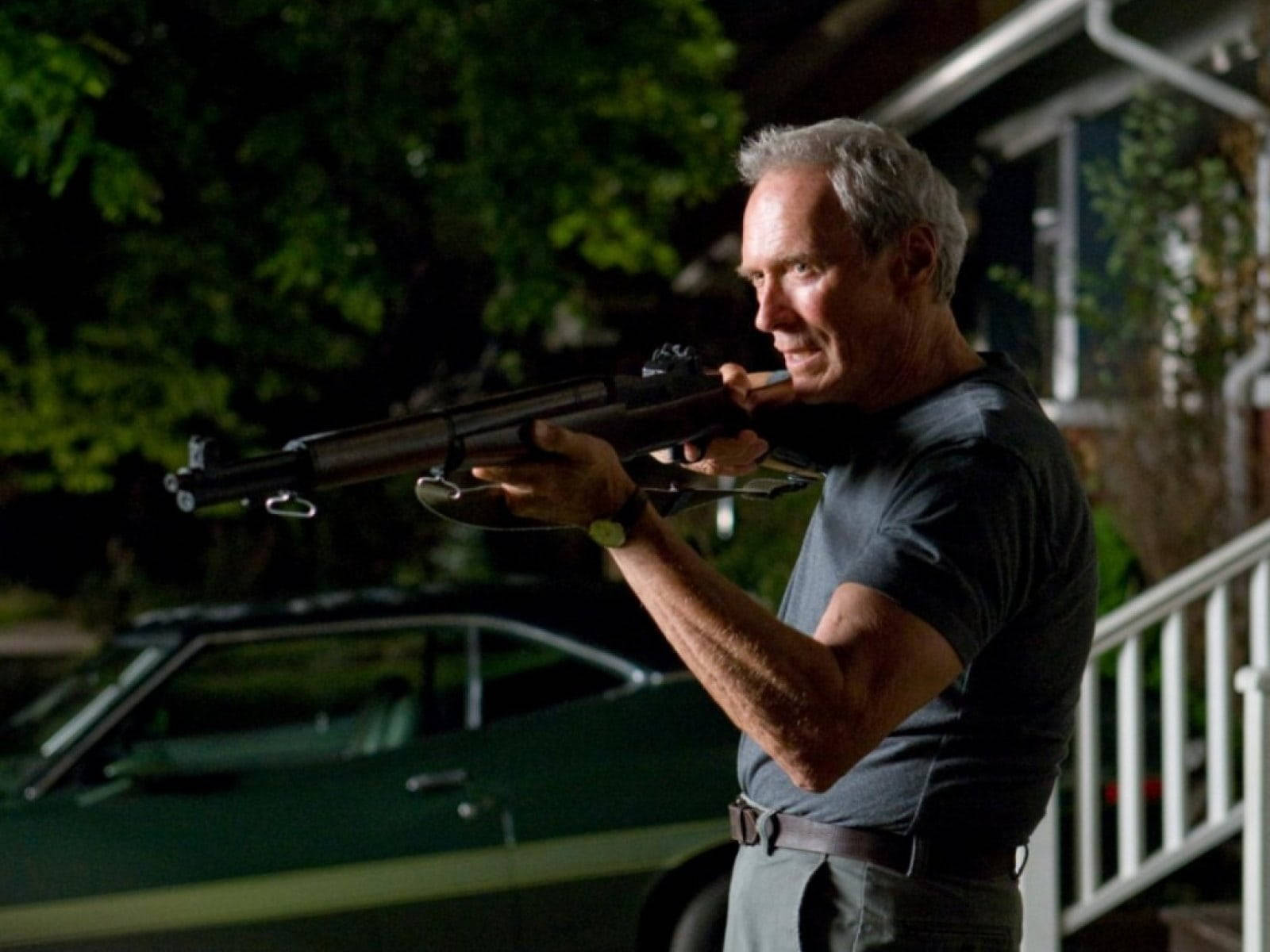
Propriété privée
Dans une discussion familiale qui s’est déroulée sur Signal, un point de désaccord a émergé sur la notion de « propriété privée » et sur le fait, disais-je, que les français, manipulés par des décennies de socialisme, ne respectent plus la propriété privée. Il m’a été répondu, et j’ai trouvé l’argument valide sur le moment, sans pour autant changer d’avis : « les français respectent la propriété privée : ils sont 60% à être propriétaires de biens immobiliers et bien d’autres y aspirent ». Cette phrase est vraie, d’un bout à l’autre. Mais ce n’est pas un bon argument. J’essaye d’expliquer pourquoi ici.
Etat de fait versus Principe
En effet, on peut tout à fait désirer ou convoiter un bien (ou un état de fait) sans pour autant respecter la propriété privée. Respecter la propriété privée, c’est respecter une « règle de juste conduite abstraite ». C’est un principe moral. Respecter la propriété privée, c’est considérer que tout être humain est propriétaire (et responsable) de sa vie, du fruit de son travail et de ce qu’il acquiert par des échanges libres. On peut donc tout à fait désirer être propriétaire, et considérer qu’il est légitime de voler le bien à quelqu’un d’autre (un riche, un salaud de capitaliste, etc.). Que les français, et les gens en général, gardent un bon sens et une compréhension concrète de leur propre intérêt, c’est fort heureux (il vaut mieux être propriétaire si on peut) ; mais cela ne valide en aucune manière leur respect de la propriété privée. Ce sera juste un bon moyen, s’ils deviennent propriétaires, d’avoir des gens en plus qui défendront ce principe (par intérêt personnel).
Je crois, et j’ai peut-être tort, qu’une grande partie de la population trouve légitime de « voler » des biens à certains pour les donner à d’autres. La notion même de « justice sociale », si bien démontée par Hayek, sert très exactement à cela. Justifier des transferts forcés. Rappelons-le : la très grande majorité de l’argent pompé aux français ne sert pas à financer les fonctions régaliennes de l’Etat, mais de la redistribution forcée (part du régalien dans le budget de l’Etat autour de 20%). J’entends déjà les récriminations : « et la solidarité! ». Mais quel est donc le sens d’une solidarité forcée ? La solidarité implique la compréhension mutuelle d’intérêts partagés, d’une unité de destin, qui incite à collaborer et à s’entraider, de manière réciproque. Je ne vois pas en quoi elle justifie le vol. J’y reviendrai plus bas.
Morale
Je reconnais que cette approche basée sur le respect de principe d’une règle de juste conduite applicable à tous de la même manière est très « déontologique ». Larmore a montré que la morale est hétérogène : à côté de ce principe déontologique, on trouve le principe conséquentialiste et le principe de partialité.
J’appelerais ces trois principes : principe de partialité, principe conséquentialiste et principe déontologique. Ils se situent tous trois à un niveau élevé de généralité. Le principe de partialité sous-tend les obligations « particularistes » qui ne s’imposent à nous qu’en vertu d’un certain désir ou intérêt que nous nous trouvons avoir. (…) Le principe de partialité exprime donc une priorité du bien sur le juste. (…) Les deux autres principes pratiques – les principes conséquentialiste et déontologique – sont universalistes et représentent des obligations catégoriques. Le principe conséquentialiste exige que l’on fasse ce qui produira globalement le plus grand bien (la plus grande somme algébrique de bien et de mal), eu égard à tous ceux qui sont affectés par notre action. (…) Le principe déontologique exige que l’on ne fasse jamais certaines choses (ne pas respecter une promesse, dire des mensonges, tuer un innocent) à autrui, même s’il doit en résulter globalement un moindre bien ou un plus grand mal. (…) Contrairement au principe de partialité, ces deux principes impliquent des devoirs qui sont catégoriques et s’imposent à l’agent, quels que puissent être ses désirs ou ses intérêts. Ils expriment, par conséquent, une priorité du juste sur le bien. Il me semble que toute personne réfléchie reconnaît, dans une certaine mesure, les exigences de ces trois principes.
Je suis peut-être trop fixé dans une approche déontologique. Mais si je pars sur une approche conséquentialiste, alors les partisans de la « justice sociale », et de la répartition (ce que j’appelle le vol légal, ou la spoliation) doivent reconnaître que le mode de fonctionnement actuel, ne respectant pas – à plein d’égards – la propriété privée n’atteint en aucune manière des conséquences souhaitables. Paupérisation, baisse générale du niveau de service, effondrement de l’école, on pourrait continuer la liste. Tout cela pour un seul indicateur qui va dans leur sens (la baisse des inégalités). Ils n’ont donc raison ni sur l’aspect déontologique, ni sur l’aspect conséquentialiste. Ils préfèrent que les gens soit pauvres mais égaux, plutôt que riches et inégaux. Et l’on a bien du mal, à retrouver là-dedans, une notion de solidarité. Un tel délitement de la société, un tel effondrement moral, ne saurait être un bon exemple de solidarité bien pensée. Par ailleurs, cette relative « égalité » des gens dans la pauvreté (mesurée par des indicateurs utilisés politiquement et à l’envers) cache bien mal la réalité concrète.
Partialité
Mais c’est là où l’on retrouve le troisième principe moral : le principe de partialité. Car, bien sûr, tout le monde n’est pas pauvre dans ce système. Certains, dont les dirigeants, ceux qui sont proches du pouvoir, ou ceux qui ont la chance d’avoir déjà des moyens, ne souffrent pas autant que le reste de la population. Certains bien sûr, ne sont pas des profiteurs immoraux, et essayent de faire bouger les lignes. Mais tout de même, le système en est venu à être clôt sur lui-même. C’est ce qui se passe à mon avis : une petite « caste » tire les marrons du feu, pour soi et pour ses proches, en faisant du chantage moral au reste de la population au nom de l’égalité et de la justice sociale. Ou de l’anti-racisme, ou de tout ce qui peut permettre de « menacer » d’exclusion sociale les opposants. Ils ont pillé les ressources du pays, pris des mauvaises décisions – au vu de l’intérêt général – sur presque tous les sujets, pillé les ressources des générations futures, pillé l’épargne des français. Il est probable, et c’était l’avis que j’exprimais au début de ce billet, qu’une bonne partie des français les déteste au moins autant par jalousie que par réprobation morale. Beaucoup se rêveraient dans la même situation, sans pour autant vouloir respecter des règles abstraites de juste conduite, et le droit de propriété.
Je ne demande qu’à avoir tort, et ça serait une grande source d’espoir que de savoir que les français, dans leur majorité, considère qu’il est injuste de voler quelqu’un, même riche.
-

La Révolution racialiste
Mathieu Bock-côté signe avec « La Révolution racialiste » un bel essai, sans appel, sur le wokisme et d’autres virus idéologiques (comme il les nomme très justement). Le problème avec Bock-Côté, c’est que j’écoute son émission chaque semaine en podcast : j’ai donc déjà entendu ses raisonnements toujours justes et équilibrés, percutants sans être caricaturaux. Le livre ne m’apporte pas tant que ça du coup. Mais si vous ne savez pas ce qu’est le wokisme, ou le racialisme, et si vous voulez le découvrir dans le détail ce livre est pour vous.
Documenté et honnête
Bock-côté, à l’instar d’un Finkielkraut, connaît ses adversaires, les lit, les comprend et analyse leur manière de raisonner. Jusqu’à la nausée parfois, car dans le livre, l’auteur cite abondamment les cinglés manipulateurs qui sont les porteurs de cette idéologie dangereuse. Le quatrième de couverture le dit bien :
On ne saurait segmenter une société sur une base raciale sans condamner chaque groupe à s’enfermer dans sa couleur de peau, qui devient dès lors l’ultime frontière au coeur de la vie sociale.
La vision racialiste, qui pervertit l’idée même d’intégration et terrorise par ses exigences les médias et les acteurs de la vie intellectuelle, sociale et politique, s’est échappée de l’université américaine il y a vingt ans. Et la voilà qui se répand au Canada, au Québec et maintenant en France.
Elle déboulonne des statues, pulvérisant la conscience historique, elle interdit de parler d’un sujet si vous n’êtes pas héritier d’une culture, et vous somme de vous excuser « d’être blanc », signe de culpabilité pour l’éternité. Le racialisme sépare et exclut, n’apporte pas de libertés qui qu’en disent ses hérauts, et, plus dangereux, modélise une manière de penser le monde.
Dis de manière plus directe : les woke sont des gros racistes anti-blancs. Toute la misère vient des blancs, seuls responsables de tous les maux. Tout cela serait ridicule, et risible, si une partie des gens n’y prêtaient pas le flanc, soucieux de surtout, surtout, ne pas paraître racistes. Affligeant en 2023 : ce qui pouvait se comprendre dans les années 1980, il y a quarante ans, est franchement un signe de véritable connerie, et de manque de structure intellectuelle.Egalitarisme radical et contre-universalisme
Derrière cette soupe idéologique, on retrouve à nouveau une logique égalitariste radicale (prête à couper des têtes pour que toutes fassent la même taille), et dans le même mouvement une négation de l’universalisme (qui ne serait qu’une forme de racisme déguisé).
Tout cela est bien inquiétant : cela confirme le constat que ceux qui ont le pouvoir sont soit cinglés, soit suffisamment manipulateurs pour surfer sur de telles inepties pour garder le pouvoir. En trahissant l’intérêt du peuple. Un petit extrait pour finir, mais ce livre, en confirmant ce que l’on voit, énerve par la justesse de son constat, et confirme la léthargie de la population française, qui se laisse, sur ce sujet comme sur d’autres, malmener.
La société occidentale est engagée dans une dialectique mortifère : le « développement de la puissance politique indigène » est indissociable de la soumission des élites, fascinées et effrayées par l’agressivité décomplexée de ceux qu’elle voit comme les nouveaux damnés de la terre. Si le décolonialisme ne représente évidemment pas l’opinion dominante chez les populations associées à la « diversité », on ne fera pas l’erreur d’oublier que ce sont les minorités idéologiques les plus résolues qui font l’histoire.
On rencontre le paradoxe multiculturaliste : souvent, ceux qui revendiquent leur identité de « racisés » sur un mode militant refusent d’être renvoyés à leurs origines mais ne cessent de les brandir. Le régime diversitaire et l’idéologie multiculturaliste favorisent l’exacerbation de l’identité d’origine en décourageant l’intégration substantielle ou l’assimilation. -

Trois coups de tonnerre
Jean Clayrac signe avec « Trois coups de tonnerre » un petit essai très intéressant, et rudement bien écrit. Jean Clayrac est le pseudonyme de l’auteur, également taulier du site Un Regard Inquiet, que je vous invite à découvrir. Le livre est sous-titré « Confession d’un antiraciste ordinaire », il est très bien résumé par le 4ème de couverture :
Un antiraciste ordinaire, naguère certain de sa bonne moralité, a pris conscience, l’année précédente, de ses compromissions intellectuelles et des drames qu’elles avaient engendrés. Il se plonge dans une réflexion sur leurs causes idéologiques, morales et finalement existentielles, pour ouvrir la voie à une refondation intellectuelle.C’est de la refondation de la gauche dont il s’agit. Et donc d’une partie de la société française, tant l’idéologie décrite dans l’essai – où elle y est démasquée, déconstruite, expliquée, analysée – imprègne les esprits en 2021 en France.
Prise de conscience tardive ?
Mieux vaut tard que jamais, se dit-on au début de l’essai. Car les trois coups de tonnerre sont l’affaire George Floyd, les actes de sauvageries de l’été 2020, et l’assassinat de Samuel Paty. 3 affaires relativement récentes qui, en retentissant comme des coups de teonerre, ont ouvert les yeux de l’auteur. On se demande comment du coup avaient retenti pour lui le 11 septembre, le Bataclan et tous les autres attentats islamistes. Mais mieux vaut tard que jamais ; et le livre, de fait, répond à cette question de manière très précise et assumée. C’est tout l’intérêt.
Mécanismes et causes de l’aveuglement volontaire
Jean Clayrac, avec une honnêteté rare, et une précision chirurgicale, explique pas-à -pas les mécanismes du déni de réel dans lequel une partie de la gauche s’est enfermée depuis très longtemps, les raisons de ce déni. Les formes prises par ce déni aussi. Tout y est très documenté. C’est l’analyse des causes idéologiques du déni (antiracisme bêlant, oubli de l’histoire, ethnocentrisme). Et on retrouve, bien sûr, le point central des travaux de Bock-Côté : paraître vertueux, socialement, a été un des moteurs de ce déni.
Une fois explicité tout cela, l’auteur poursuit son introspection, en écrivant « nous ». J’entends dans ce nous autre chose qu’une manière de ne pas dire « je » : il parle pour son « camp » idéologique, la gauche. Il cherche donc les causes morales du déni. Et il les explique très bien : lâcheté, conformisme, intelligence compromise.A faire découvrir à tous vos amis de gauche
Si le livre ne m’a pas appris tant que cela, il m’a permis de me mettre un peu dans les chaussures de quelqu’un d’idéologisé. Je suis admiratif du chemin parcouru par l’auteur (mais est-ce vraiment le cas, ou ce point de vue n’est-il qu’une manière rhétorique d’emmener dans son récit de manière assez large, y compris, surtout, ceux qu’il cherche à faire bouger ?). Le livre est remarquablement clair, bien écrit, et découpé en courts chapitres qui rendent la lecture et la progression du propos tout à fait limpide. En fait, je me suis dit en le terminant que j’allais l’offrir à mon ami de gauche, car cet essai explique mieux que moi une partie des idées qui sont les miennes. L’essai permet certainement de faire bouger certaines consciences. On ne peut que l’espérer…
-

Eloge de la discrimination
La provocation du titre n’est qu’apparente, et j’espère qu’à la fin de ce billet, vous serez d’accord pour dire que nous devons faire l’éloge de la discrimination.
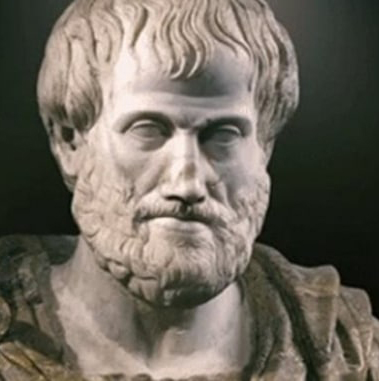
La plus grande injustice est de traiter également les choses inégales.
Aristote (384 – 322) philosophe grec
Ce billet, un peu long, progressera en 4 temps :
- le mot ”discrimination », en français comporte deux sens très différents. Nous reviendrons sur chacuns de ces acceptions
- la confusion entre les deux sens, entretenue par une pensée Égalitariste, conduit à confondre égalité de fait et égalité devant la loi, et à voir des actes injustes là où il n’y en a pas.
- pour illustrer ces confusions, nous regarderons en détail un cas pratique : la discrimination à l’embauche
- il existe un moyen simple de trier entre le légitime et l’illégitime : il consiste à allier respect strict de la liberté d’action individuelle, et tolérance.
Discrimination, un mot ambivalent
Le terme discrimination recouvre deux sens très différents.
Discriminer c’est distinguer
Le premier historiquement et étymologiquement, et probablement le seul légitime, est synonyme de distinction. Discriminer, c’est distinguer ce qui est différent, en vue ou non d’un traitement séparé. Discriminer, dans ce premier sens, est donc l’acte de séparer, de distinguer, de différencier. C’est donc un acte normal de l’intelligence qui observe le réel et s’y confronte : telle essence de bois n’a pas les mêmes caractéristiques que telle autre, telle personne m’est agréable et telle autre non, etc..
Discriminer c’est porter atteinte à l’égalité devant la loi
Le second sens, apparu avec cette connotation dans les années 1950, est péjoratif : il désigne la discrimination appliquée à des humains que l’on va, en fonction de tel ou tel critère, traiter différemment. Ce deuxième sens fait partie des choses que nous devons combattre, quand il s’agit de discriminations instituées (par une coutume ou par la loi). Nous sommes donc confrontés à un mot qui dans un cas décrit un acte moralement juste, et dans l’autre cas un acte moralement condamnableCe second sens désigne donc une pratique humaine jugée moralement répréhensible, en tout cas par toute personne attachée à l’égalité devant la loi. En gros, les démocraties libérales ont depuis un certain temps déjà mis en place des règles qui sont les mêmes pour tous. C’est le sens de la déclaration universelle des droits de l’homme, et des systèmes juridiques des Etats de droit.
Ces deux sens du mot ”discrimination » sont donc très différents. Si l’un est une activité naturelle de l’esprit humain qui analyse, sépare, différencie, l’autre est une pratique collective choquante, qui refuse aux citoyens l’égalité devant la loi (qu’elle soit la loi coutumière ou le droit positif).
Ce n’est pas par hasard que la symbolique judiciaire utilise depuis le XIIIe siècle une figure de la mythologie grecque, Thémis, sous les traits d’une femme aux yeux bandés, symbolisant l’impartialité. Le meilleur moyen de juger justement, c’est de ne pas savoir qui je juge. C’est un beau symbole des lois identiques pour tous.
Nous sommes donc confrontés à un mot qui dans un cas décrit un acte moralement juste, et dans l’autre cas un acte moralement condamnable. Voyons donc les types de confusions que cela peut induire.Confusion entre égalité de fait et égalité devant la loi
Conséquence : voir partout des discriminations
Il y a plusieurs risques avec ces deux sens compris dans le même mot. Le premier consiste à faire déborder le premier sens, l’acte de distinguer, sur le second et à ”justifier » des injustices. Le second qui est à mon avis beaucoup plus présent, et qui est l’objet de ce billet, consiste à faire déborder le second sens, traitement différent devant la loi, vers le premier et à systématiquement voir dans l’acte de ”séparer ce qui est différent » une injuste discrimination. Parce que le deuxième sens est évidemment négatif, quand il conduit à des inégalités devant la loi, nous avons peu à peu perdu l’usage positif du premier sens du mot (synonyme de distinction, et simplement un des modes de fonctionnement de la pensée humaine). Ce qui signifie que dans un certain nombre de cas nous ne pensons plus, et nous réagissons de manière réflexe en condamnant des discriminations qui n’en sont pas, ou qui sont des discriminations légitimes (celles correspondant au premier sens c’est-à -dire à un humain exerçant sa rationalité critique).
Il me semble que cette manie de voir d’injustes discriminations partout est le fruit d’un parti pris idéologique que l’on pourrait appeler l’égalitarisme. C’est-à -dire une confusion entre l’égalité devant la loi, et l’égalité de fait.Que signifie l’égalité dans notre devise ?
L’égalité devant la loi me semble tout à fait souhaitable et en accord avec l’idée de justice. L’égalité de fait – une situation identique pour tous – , si l’on y réfléchit bien, est une forme de totalitarisme. Ce totalitarisme égalitariste trouve ses racines dans le communisme. Pour atteindre une égalité de fait entre les gens, qui sont inégaux par leur naissance, leurs qualités, leur environnement, leur éducation, leur parcours, il faudrait mettre en place un système qui traite, devant la loi, inégalement les gens. Ce qui revient à brider certains et à aider d’autres. Il me semble que cette manie de voir d’injustes discriminations partout est le fruit d’un parti pris idéologique que l’on pourrait appeler l’égalitarisme.C’est le meilleur moyen de construire une société totalitaire : pour atteindre un objectif idéologique (tout le monde doit être dans les mêmes conditions de fait), il faudrait sciemment empêcher certains de se réaliser pleinement, tout en aidant d’autres à le faire. Prenons un cas simple : Albert est plus intelligent que Rémi. Allons-nous empêcher Albert d’apprendre et de s’instruire pour faire en sorte que Rémi puisse être à peu près au même niveau ? Allons-nous sortir Albert de sa famille dès son jeune âge pour éviter que ses parents, plus instruits, ne lui transmettent d’injustes connaissances ? Bien sûr que non ! Ce serait une négation directe de la liberté individuelle, et de la dignité des personnes. Cette voie ne conduit qu’à une horrible dictature évaluant – comment ? – les capacités de uns et des autres, et brimant la majeure partie de l’humanité pour construire une sorte d’homme imaginaire, toujours identique prétendument, mais jamais dans les faits car chaque personne humaine a sa singularité. C’est le domaine de l’absurde, de l’arbitraire, et c’est un monde sans liberté. Hayek l’avait exprimé de manière très claire :

Il y a toute les différences du monde entre traiter les gens de manière égale et tenter de les rendre égaux. La première est une condition pour une société libre alors que la seconde n’est qu’une nouvelle forme de servitude.
Friedrich Hayek (1899 – 1992) économiste et philosophe britannique originaire d’Autriche.
Il convient donc de préciser quelles sont les règles permettant de distinguer le légitime de l’illégitime, afin d’éviter cette confusion entre les deux sens du mot. Mais avant cela, regardons un cas concret qui aide à dessiner cette limite.
Cas pratique : la discrimination à l’embauche
Un exemple typique : recruter quelqu’un pour un travail est un acte de discrimination légitime. Il s’agit bien de choisir, de distinguer entre les candidats, celui ou celle qui sera le plus adapté pour le poste. Il appartient à celui qui recrute de décider les critères de choix pour ce candidat. Il peut avoir à en rendre compte aux propriétaires de l’entreprise, mais ce n’est certainement pas à des acteurs extérieurs au processus de venir lui dicter d’autres critères. Le cas de l’entretien d’embauche permet d’introduire toute la thématique : qui est légitime pour décider ? Avec quels critères ? Dans quels cas faudrait-il, s’il le faut, imposer des critères de choix différents ?
Affirmative action ou discrimination positive
La confusion entre discrimination au sens de choix, et discrimination au sens d’inégalité devant la loi a conduit beaucoup de pays, à commencer par les USA, à adopter des politiques d’affirmative action, ou discrimination positive. La discrimination positive est le fait de « favoriser certains groupes de personnes victimes de discriminations systématiques » de façon temporaire, en vue de rétablir l’égalité des chances.
J’aimerais vous montrer à quelle point cette démarche, bien que motivée par une louable intention (?), est erronée intellectuellement, et que ses effets concrets ont déjà permis de montrer à quel point elle était inutile, inefficace, et toxique.L’enfer est pavé de bonnes intentions
Intellectuellement, cette démarche est en contradiction directe avec l’égalité devant la loi, ce qui devrait presque suffire à faire douter de son bien-fondé. Un deuxième point devrait alerter : qui décide des groupes à favoriser ? Comment empêcher qu’une telle politique conduise à ce que d’autres groupes réclament les mêmes faveurs ? A nouveau, l’arbitraire règne. Et il est sans fin. Si on favorise les noirs, les femmes, ou les handicapés, pourquoi ne favoriserait-on pas les gros, ou les nains ? Les particularités humaines sont d’une telle étendue, que la liste ne peut que s’allonger à l’infini. Par ailleurs, pour ”favoriser » telle ou telle catégorie, il est nécessaire de la montrer du doigt, de la stigmatiser, ce qui est une contradiction interne à cette démarche. Pour éviter les discriminations, créons-en ! Drôle de manière d’assurer la cohérence des règles.
Il existe une liste longue comme le bras des inconvénients de la discrimination positive à l’embauche, j’en cite quelques uns :- le soupçon sur les qualifications (si je suis embauché parce que noir, qui pourra me considérer comme compétent ?)
- l’encouragement du communautarisme (si ma communauté est favorisée par la réglementation, pourquoi ferais-je des efforts?)
- la tension entre les communautés (si on discrimine positivement une communauté ou un groupe, cela veut dire que l’on discrimine négativement les autres)
Se renseigner
Pour en terminer sur cette idéologie, il importe de la confronter aux faits, et à la réalité. Là où elle a été mise en oeuvre, quels sont les résultats ? Un excellent livre sur le sujet, « Le Puzzle de l’intégration », par Malika Sorel-Sutter permet de se rendre compte des dégâts causés par la discrimination positive. Partout les résultats vont à l’inverse des buts visés, ce qui devrait heurter toute personne qui considère que l’on doit avoir en politique une éthique de responsabilité. Les exemples fourmillent dans son livre (aux USA, mais aussi en France, puisqu’en France et sans le dire ouvertement, les responsables politiques ont mis en oeuvre des politiques de discrimination positive sociales, territoriales – avec les ZEP-, sexuelles – avec la parité hommes/femmes – et communautaires). Je vous renvoie au livre de Malika Sorel pour découvrir la liste des personnalités politiques, de gauche comme de droite, citations à l’appui, qui sont favorables ou défavorables à la discrimination positive.
Que ce soit pour sélectionner des candidats à l’embauche, ou pour sélectionner des étudiants dans une filière, la sélection au mérite et sur les compétences est une bien meilleur rempart contre les inégalités : il permet à chacun, quelque soit ses chances de départ, d’avoir l’opportunité de travailler pour s’en sortir. Cela n’exclut pas d’aider, de soutenir ceux qui en ont besoin, par solidarité. Mais il convient de rester exigeant sur des règles identiques pour tous.
Citons une expérience intéressante rapportée par Jacqueline Costa-Lascoux, directrice de recherches au C.N.R.S. mais surtout, pour le sujet qui nous intéresse ici, membre du Haut Conseil à l’Intégration :Pourquoi analyser le refus d’embauche ou de stage sous le seul angle de la discrimination raciste ou ethnique ? L’expérience a été faite de tourner ces entretiens en vidéo pour ensuite en présenter les images aux candidats, aux employeurs, aux enseignants. Les résultats sont éloquents. Nombre de jeunes, par crainte ou par un sentiment de fatalité, arrivent en retard, habillés en jogging la casquette sur la tête, poussant la porte sans frapper, s’asseyant sans saluer sur le bord de la chaise le corps renversé comme pour regarder la télé, ne posant aucune question sur le travail mais en en rajoutant sur le salaire et les vacances… En face, la personne en costume pose des questions du type tests psychologiques ou psychotechniques, s’obligeant à rester dans une attitude raide de neutralité. Lorsque la scène est rediffusée aux protagonistes, les jeunes sont étonnés de leur ”look » et sont les premiers à dire que s’ils étaient employeurs ”ils ne se prendraient pas » ; quant à celui-ci, il comprend très vite l’inadaptation de son attitude à l’égard de jeunes qui n’ont jamais connu l’univers du travail salarié […] L’ignorance des codes sociaux et culturels au travail est l’obstacle le plus évident à l’embauche. Au lieu de crier immédiatement au racisme, il serait préférable non pas de raisonner en termes de catégories de populations mais en termes d’analyse de situations […]Quand je vois passer des messages – très idéologiques – exhortant les entreprises à « recruter sans discriminer », les bras m’en tombent ! Recruter, c’est discriminer.
Critères de choix entre discrimination légitimes et illégitimes : la liberté
Un dernier point, pour souligner ce qu’est l’attitude opposée à la discrimination positive. Dans chacun des exemples ci-dessus, il convient de distinguer ce qui est de l’ordre du choix personnel, et ce qui est de l’ordre de l’égalité des citoyens devant la loi. Dès que l’on se trouve dans le champ du choix personnel, de la liberté et de la responsabilité, la seule voie est de laisser celui qui est responsable d’un choix le faire en toute liberté ET responsabilité. Le meilleur moyen pour forcer une entreprise, une école ou une administration à ne pas procéder à d’injustes discriminations, c’est de la forcer à assumer ses responsabilités. Si telle ou telle entreprise choisit de discriminer les noirs à l’embauche, par exemple, faisons le savoir et dénonçons cette attitude si cela nous choque : boycottons ses produits, refusons d’aller y travailler, utilisons les médias pour faire pression sur ses dirigeants. C’est une méthode préférable à celle consistant à la forcer, par la loi, à embaucher des noirs. Si notre ennemi est le racisme (sous toutes ses formes), la seule arme est l’éducation. Forcer un dirigeant à embaucher des noirs ne le rendra pas moins raciste, s’il l’est. Il est fort probable que d’injustes discriminations soient à l’oeuvre dans tout recrutement, mais également des discriminations tout à fait légitimes. Mais que chacun se pose la question : lorsque nous sommes en situation de discriminer pour une embauche (une nounou, un salarié, un artisan, etc…), sommes-nous bien sûr de ne fonctionner que d’une manière parfaitement objective ? Non, bien sûr. Et il est essentiel que ce choix, qui est notre liberté et notre responsabilité, reste dans nos mains. Chacun a ses critères de choix.Le critère qui permet de distinguer entre les discriminations illégitimes, et celles qui sont légitimes, c’est la liberté.
Car enfin soyons raisonnables : il existe des gens qui n’aiment pas les gros, d’autres ceux qui ont des boutons, d’autres encore les noirs, ou les jaunes, ou ceux qui ont une barbe, ou les femmes voilées. Si nous devons pouvoir rendre des comptes, devant la loi, de n’avoir utilisé aucun critère arbitraire pour choisir, aucun choix ne sera plus possible. Tout choix est arbitraire, car c’est un acte de liberté d’une personne particulière, avec son histoire, ses envies, ses aspirations, ses goûts, ses préférences. Heureusement que nous sommes libres de faire nos choix comme nous le voulons. Cela veut dire qu’il faut accepter que certains utilisent des critères de choix qui ne sont pas les nôtres.
Vous l’avez compris : le critère qui permet de distinguer entre les discriminations illégitimes, et celles qui sont légitimes, c’est la liberté. La liberté est indissociable de la responsabilité. La discrimination légitime, c’est celle qui est de ma responsabilité. Si je suis responsable d’une embauche, c’est à moi et à personne d’autre de choisir. C’est ma responsabilité, et ma liberté.Conclusion : Au nom de la tolérance
Un dernier mot pour conclure : Gilbert Durand, qui a fait un travail formidable sur les imaginaires, a bien expliqué comment l’Occident est une civilisation dont le régime imaginaire est diurne, c’est-à -dire dans un registre de ”lumière ». Lumière, donc séparation : dans l’obscurité rien n’est distinct. Dans la lumière les formes se dessinent, et permettent de distinguer les objets, leurs frontières.
Alors dans cette logique, et pour rester une société d’hommes libres, je voulais faire l’éloge de la discrimination. Faisons le tri entre, d’une part, les discriminations devant la Loi et les institutions, injustes et à condamner, et toutes les autres d’autre part qui sont légitimes, car le fruit de décisions libres et personnelles, même si elles ne nous plaisent pas. C’est ce qu’on appelle aussi la tolérance. La tolérance est précisément cette souplesse sociale que l’occident a vu émerger pour permettre la coexistence pacifique des êtres, quelles que soient leurs convictions, leurs dogmes spirituels ou religieux. Chacun est appelé à la tolérance vis-à -vis des autres. La tolérance est un appel à respecter la liberté des autres. Vouloir interdire la liberté dans les critères de choix individuels, c’est inscrire dans la Loi une forme d’intolérance. Il convient donc, comme je le précisais plus haut, d’expliciter et de montrer du doigt l’idéologie qui, sous couvert de non-discrimination, la provoque, et dresse les uns contre les autres. L’Égalitarisme est son nom. Ce n’est pas une utopie, c’est une dystopie en construction, car ses partisans sont des ennemis de la liberté.