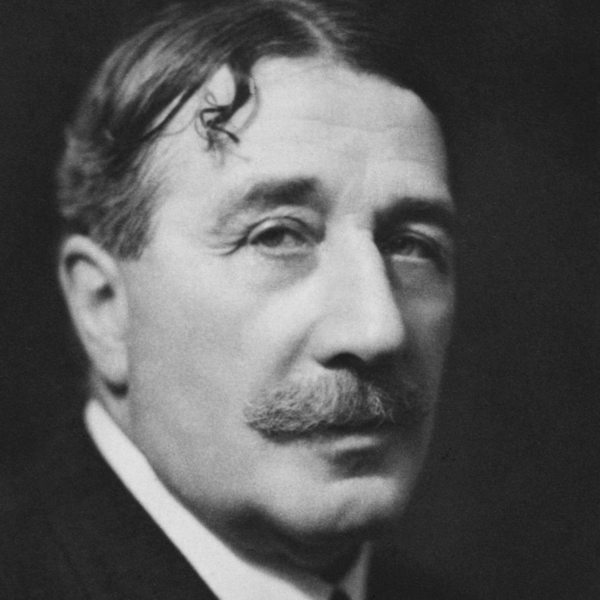Pour lutter contre toutes les formes d’irrationalité et de croyances dangereuses, il n’existe qu’une méthode : la pratique du doute et de l’esprit critique. Dans un remarquable petit ouvrage très détaillé et documenté (« Petit Cours d’autodéfense intellectuelle »), Normand Baillargeon détaille tous les pièges tendus par les marchands de rêve ou de cauchemar, et liste les outils et les méthodes de pensée permettant de se défendre. Un livre indispensable et simple à lire. Salutaire.
Parmi mes lectures de vacances, j’ai découvert un livre passionnant, facile à lire et à mon sens indispensable pour tous ceux qui aiment la raison et le doute. Il s’agit du « Petit cours d’autodéfense intellectuelle », de Normand Baillargeon (Lux Editeurs, Collection Instinct de Liberté). Il en existe une version un peu plus ancienne en ligne, sur la page d’Olivier Hammam. J’ai tout de suite été séduit par le propos : trop de croyances irrationnelles circulent, dans tous les milieux, et peuvent le faire uniquement parce que l’éducation au sens critique, au scepticisme et au doute scientifique n’est pas assez développée. Le livre présente des outils et des méthodes qui permettent de raisonner lucidement et d’aiguiser son sens critique.Le livre présente des outils et des méthodes qui permettent de raisonner lucidement et d’aiguiser son sens critique. Emaillé de citations et d’exemples très concrets, il est découpé en 5 grands chapitres, regroupés en deux grandes parties : outils de la pensée critique, et justification des croyances.
Quelques indispensables outils de la pensee critique
Dans cette partie, les différentes manières de mentir — consciemment ou non — avec des mots ou des chiffres sont présentés, ainsi que les outils intellectuels nécessaires pour éviter de se faire entourlouper.
- Chapitre 1 – Le langage : dans cette partie, l’auteur revient sur les mots utilisés, aux choix trompeurs que l’on peut faire et qu’il faut connaître pour éviter de se faire abuser. Il discute ensuite de logique, et plus particulièrement de l’art de combiner des propositions. La rhétorique, la fourberie mentale et la manipulation sont passées en revue avec les paralogismes courants.
- Chapitre 2 – Mathématiques (compter pour ne pas s’en laisser conter) : dans ce chapitre, l’auteur revient sur certains outils mathématiques de base (les « mathématiques citoyennes ») — manipulation des grands nombres, statistiques, présentations des données — indispensables pour pouvoir analyser les chiffres qui nous sont fournis et la manière dont ils sont présentés sans se faire abuser
La justification des croyances
Dans cette partie qui traite des croyances, l’auteur revient sur ce qu’est une croyance, et les trois grandes sources de connaissances et de croyances : expérience personnelle, sciences et médias. Pour chacun de ces domaines, l’auteur explique la démarche à avoir pour rester sceptique et ne pas se faire embobiner.
- Chapitre 3 — L’expérience personnelle : Justifier nos croyances par notre expérience personnelle est naturel, mais c’est une démarche dont il importe de connaître les limites (perception, souvenir, jugement)
- Chapitre 4 — La science empirique et expérimentale : pour savoir tracer la limite entre sciences et pseudosciences (les disciplines qui se parent des atours des sciences sans en adopter la rigueur dans la démarche et le doute systématique, par exemple l’homéopathie), pour tracer cette limite, donc, il importe de connaître quelques balises et quelques outils de la démarche scientifique (expérimentation avec contrôle de variable, avec groupe de contrôle et en double aveugle). L’auteur revient également sur des notions d’épistémologie, et sur les fondements de la Science. Je ferais un article prochainement là -dessus, parce que ces notions sont miennes depuis longtemps, étant scientifique, et que je trouve que la présentation devrait en être faite plus souvent.
- Chapitre 5 — Les médias : Dans ce chapitre, moins directement applicable pour nous parce que décrivant la situation dans les médias canadiens et US, l’auteur revient sur l’indispensable scepticisme de rigueur pour analyser les informations provenant des médias. Loin d’être la vérité, elles sont le résultat d’un choix dont il importe de connaître les tenants et les aboutissants. L’auteur semble considérer que le plus grave trouble dont souffrent les médias est le regroupement en une pensée unique mercantile et orientée politiquement. Ce n’est pas à mon avis le seul, mais les rappels qu’il fait sont importants.
Quelques citations
Vous savez que j’aime les citations : chaque chapitre de ce livre en contient plusieurs, et je me ferais un plaisir de les réutiliser dans les citations du dimanche. En voilà quelques-unes qui m’ont plu. Je précise au passage que le livre contient une belle section bibliographique, ainsi que des liens vers pas mal de sites Internet intéressants. Un livre moderne et humble, en somme. L’éducation à cette capacité critique est la seule éducation dont on peut dire qu’elle fait les bons citoyens.
Si l’habitude de penser de manière critique se répandait au sein d’une société, elle prévaudrait partout, puisqu’elle est une manière de faire face aux problèmes de la vie. Les propos dithyrambiques de quelconques orateurs ne sauraient faire paniquer des personnes éduquées de la sorte. Celles-ci mettent du temps avant de croire et sont capables, sans difficulté et sans besoin de certitude, de tenir des choses pour probables à des degrés divers. Elles peuvent attendre les faits, puis les soupeser sans jamais se laisser influencer par l’emphase ou la confiance avec laquelle des propositions sont avancées par un parti ou par un autre. Ces personnes savent résister à ceux qui en appellent à leurs préjugés les plus solidement ancrés ou qui usent de la flatterie. L’éducation à cette capacité critique est la seule éducation dont on peut dire qu’elle fait les bons citoyens.William Graham Sumner
Pour finir, deux autres citations utilisées par l’auteur dans le livre, en une belle épanadiplose, et qui prouvent qu’il ne tombe jamais dans un scepticisme rassis ou dans un nihilisme dangereux) : la première, parce que je l’avais déjà utilisée ici, et qu’elle figure au tout début du « Petit cours d’autodéfense intellectuelle »
Douter de tout et tout croire sont deux solutions également commodes qui, l’une comme l’autre, nous dispensent de réfléchir. Poincaré
et celle qui termine le livre, disant à peu près la même chose de manière plus détaillée :
Il me semble que ce qui est requis est un délicat équilibre entre deux tendances : celle qui nous pousse à scruter de manière inlassablement sceptique toutes les hypothèses qui nous sont soumises et celle qui invite à garder une grande ouverture d’esprit aux idées nouvelles. Si vous n’êtes que sceptique, aucune idée nouvelle ne parvient jusqu’à vous ; vous n’apprenez jamais quoi que ce soit de nouveau ; vous devenez une détestable personne convaincue que la sottise règne sur le monde — et, bien entendu, bien des faits sont là pour vous donner raison. D’un autre côté, si vous êtes ouvert jusqu’à la crédulité et n’avez pas même une once de scepticisme en vous, alors vous n’êtes même plus capable de distinguer entre les idées utiles et celles qui n’ont aucun intérêt. Si toutes les idées ont la même validité, vous êtes perdu : car alors, aucune idée n’a plus de valeur.
Carl Sagan
Je vous recommande vivement ce livre simple et clair. Il pourrait paraître prétentieux de se placer soi-même dans le camp des sceptiques, ou des lucides. Ce serait oublier que, comme la liberté, le doute et le scepticisme ne sont pas des choses acquises mais qui se travaillent chaque jour. Ce ne sont pas des choses données, mais toujours à conquérir.