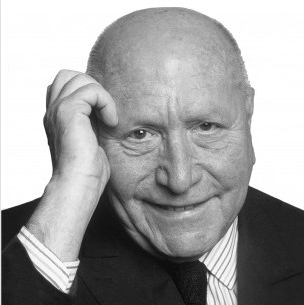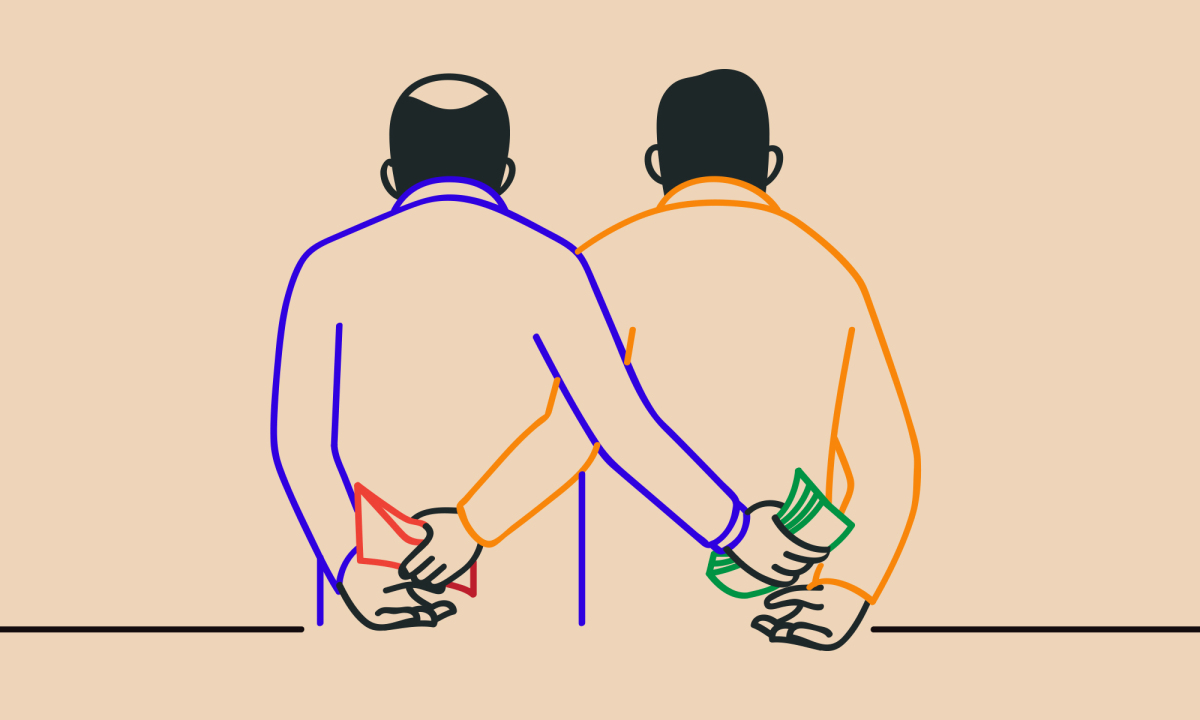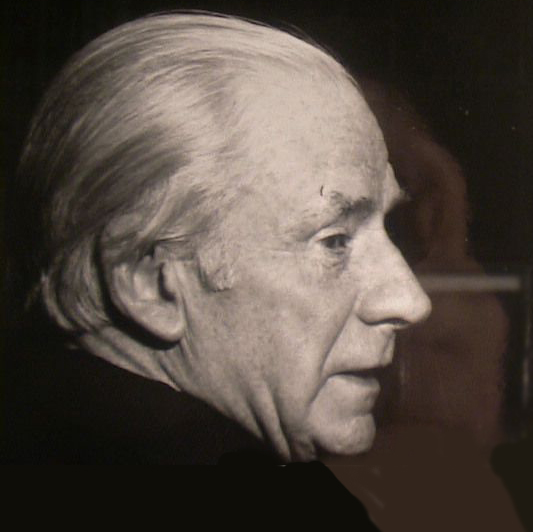C’est quoi, un « populiste » ? Pourquoi les médias mainstream accusent certains dirigeants d’être des populistes ? Qu’est-ce qui permet de catégoriser comme cela ? Ce mot est-il une insulte, ou un qualificatif neutre ? La définition de « populisme » est simple : « Tout mouvement, toute doctrine faisant appel exclusivement ou préférentiellement au peuple en tant qu’entité indifférenciée. » C’est la référence au « peuple » qui fait le populiste, la racine du mot le dit bien.
Au dictionnaire
Il est donc utile d’ouvrir un dictionnaire pour comprendre les différents sens de ce mot, et avancer dans la réflexion. Un des très bons dictionnaires en ligne, que je vous recommande d’ajouter dans vos favoris, c’est le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL). Voici un condensé de ce qu’on peut trouver à l’entrée peuple (j’ai trié et je n’ai gardé que ce qui semble alimenter la réflexion politique) :
A.
1. Ensemble des humains vivant en société sur un territoire déterminé et qui, ayant parfois une communauté d’origine, présentent une homogénéité relative de civilisation et sont liés par un certain nombre de coutumes et d’institutions communes.
2. P. ext. Ensemble de personnes qui, n’habitant pas un même territoire mais ayant une même origine ethnique ou une même religion, ont le sentiment d’appartenir à une même communauté.
B.
1. (…)
2. a) Ensemble des individus constituant une nation (…), vivant sur un même territoire et soumis aux mêmes lois, aux mêmes institutions politiques.
b) [P. oppos. aux gouvernants] Partie de la nation soumise à une autorité ayant le pouvoir politique.
3. [Le peuple institutionnalisé et doté d’une physionomie juridique] Ensemble des citoyens d’un pays qui exercent le droit de vote pour désigner leurs gouvernants.
C.
1. Le peuple. L’ensemble des personnes qui n’appartiennent pas aux classes dominantes socialement, économiquement et culturellement de la société.♦ Péj. Ensemble de personnes caractérisées par la vulgarité, le manque de distinction des manières quelle que soit la classe sociale à laquelle elles appartiennent.
Si je résume : le sens A est le peuple au sens anthropologique, le sens B est le peuple au sens juridique et politique et le sens C, prolongeant une nuance déjà un peu comprise dans le sens B (l’opposition entre les gouvernants et le peuple), est le peuple au sens marxiste, c’est-à -dire pensé dans un rapport de domination (opposition classes dominantes/classes dominées).
Qu’est-ce donc qu’un populiste, qui se réclame du peuple, ou qui est déclaré tel par ses adversaires ou ses soutiens ? Cela peut prendre, au vu de la définition, plusieurs sens. Ils sont tous susceptibles d’être pris négativement ou positivement, selon le point de vue adopté. J’essaye de dérouler ces possibilités ci-dessous, n’hésitez pas à réagir en commentaire pour prolonger la discussion. Le mot « populisme« , dans ses racines littéraires et historiques, résonne avec les sens B et C : description des milieux populaires en littérature (au sens de milieux pauvres/non dominants), et mouvement de la paysannerie contre le pouvoir tsariste.
Civilisations vs Multiculturalisme
Sur le plan anthropologique (sens A), il me semble clair qu’un populiste sera celui qui défend d’abord les intérêts d’un peuple particulier, d’une civilisation. Dès lors, il aura pour adversaire ceux qui défendent une autre civilisation, ou ceux qui pensent qu’il n’y a qu’une civilisation mondiale, et que les civilisations sont miscibles. Pour caricaturer, en France, quelqu’un qui se positionnerait pour défendre la culture française et la civilisation occidentale avant toute chose, aurait sur le dos les islamistes et autres particularistes, et la clique de diversitaires multi-culturalistes. Un populiste sur cette maille là est quelqu’un qui reconnait à sa culture propre et à sa civilisation des caractéristiques, des particularités, qui lui paraissent importantes à conserver, et à transmettre. Sur ce plan, il me semble assez sain d’être populiste.
Citoyens vs Dirigeants
Au sens juridique (sens B) et civique, le populiste sera celui qui veut parler au nom d’un peuple définit par le fait d’être soumis aux mêmes lois et aux mêmes institutions. Il aura comme adversaire ceux qui veulent, dans la communauté nationale, vivre avec d’autres lois, d’autres institutions, ou ceux qui pensent que les institutions actuelles sont tellement mauvaises, qu’il faut complètement en changer. Il aura donc sur le dos, les islamistes – encore eux -, les séparatistes, et les « révolutionnaires » partisans de la table rase. Selon la définition, il sera aussi le porte-parole des citoyens, par opposition aux gouvernants. Le populiste aura, potentiellement aussi comme adversaire, les actuels tenants du pouvoir (quels qu’ils soient). Sur ce second plan, juridique, il me semble aussi assez sain d’être populiste.
Plèbe vs Elites
Le sens C de la définition, marxiste, repose sur l’opposition, ou le rapport de force/domination entre les élites et le reste du peuple, la plèbe. Dans ce sens, le peuple c’est tout le monde, moins ceux qui ont une place dominante dans la société (sociale, politique, intellectuelle, économique, financière, etc..). Le populiste, dans ce sens marxiste, est celui qui se présentera comme parlant au nom des dominés, de ceux qui ne sont rien, par opposition aux élites. Cette forme est devenue présente, en partie je crois à cause de la diminution progressive du mérite des élites, et en partie à cause de la perte de mobilité sociale. Quand quelqu’un est en situation privilégiée, grâce à ses efforts, à ses qualités, et à son exemplarité, cela ne suscite en général, à part chez les jaloux et les marxistes, pas de colère parmi le peuple. Quand les plus démunis, peuvent, par leurs efforts, espérer progresser dans la société, et s’y faire une place, les élites ne sont pas uniquement les rentiers de leur naissance. Mais quand ceux qui profitent d’une situation plus que favorable sans que la justification de cette situation soit évidente, alors les autres, le peuple, se rebellent et y voient une forme de domination abusive, d’autant plus que ces situations leurs sont inaccessibles. Le populiste, dans ce sens, aura comme adversaires les fausses élites, les planqués du système, et les apparatchiks. Cette déception légitime a été très bien décrite par Ivan Rioufol, et par Pierre Mari. Je n’y reviens pas ici. Ce sens du mot populisme, à nouveau me parait légitime.
Je suis populiste
Même si je ne partage pas cette grille de lecture marxiste de la société, force est de reconnaitre que notre société est noyautée par une classe dominante qui ne comprend plus les aspirations du peuple. La crise des Gilets Jaunes l’a montré. Une partie des politiciens, des journalistes, des intellectuels, des dirigeants d’entreprise ne vit plus, et ne voit plus, la réalité du pays et des problèmes concrets que rencontrent leurs concitoyens. Il est temps de voir surgir un populiste qui parle, au nom des citoyens, d’identité, de culture française et occidentale, d’immigration, de l’extension abusive de la place de l’Etat, de la perte de souveraineté nationale. Si le populiste est celui qui a comme adversaires les islamistes, les révolutionnaires, les multi-culturalistes, les diversitaires, les élites partisanes du statu-quo social, alors je suis populiste.
Beaucoup d’autres pays, en proie aux mêmes problèmes, ont vu émerger des dirigeants populistes. A quand pour la France ?