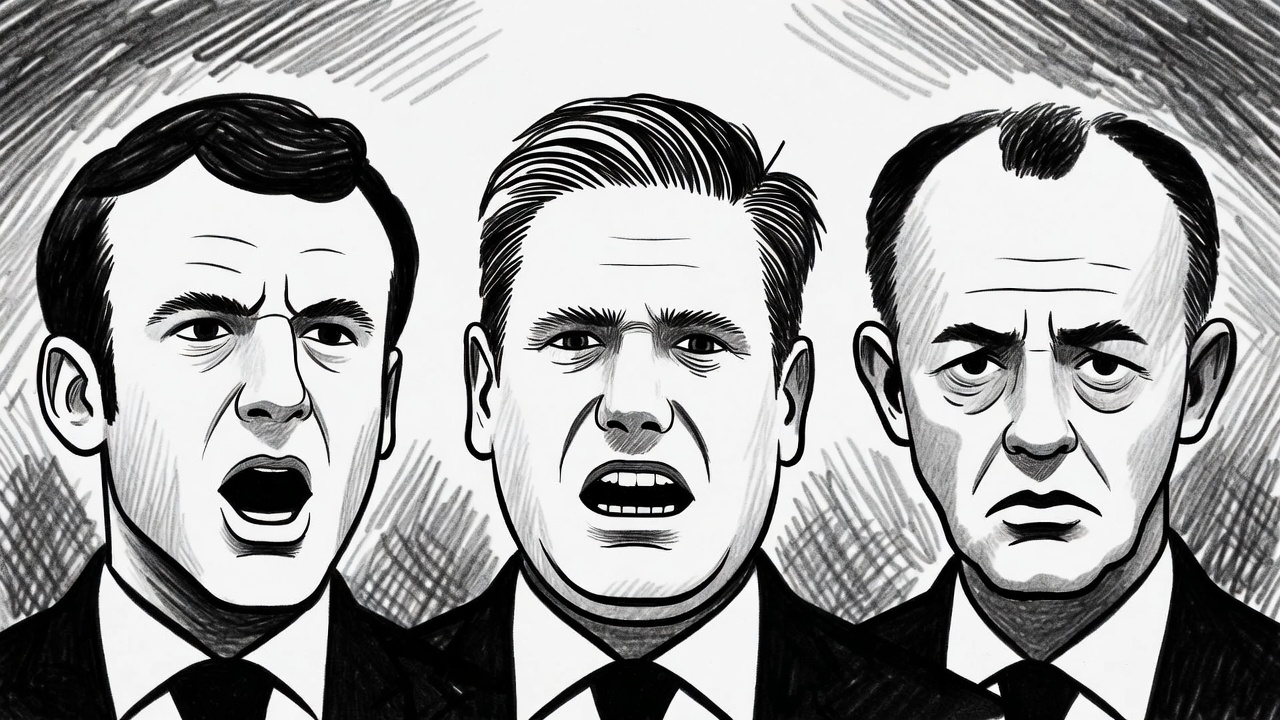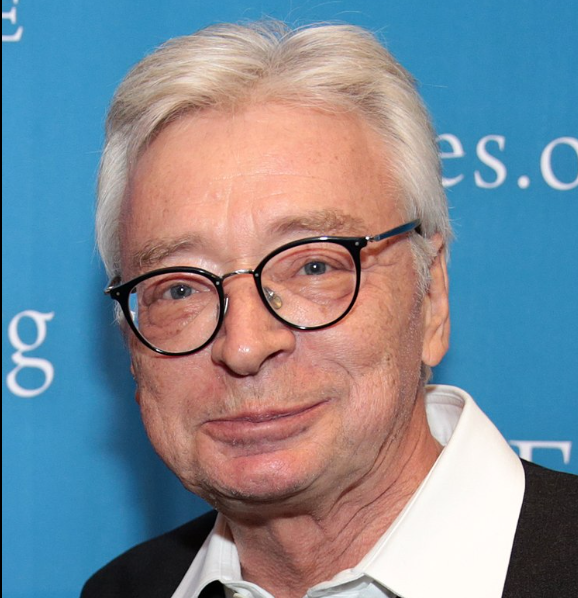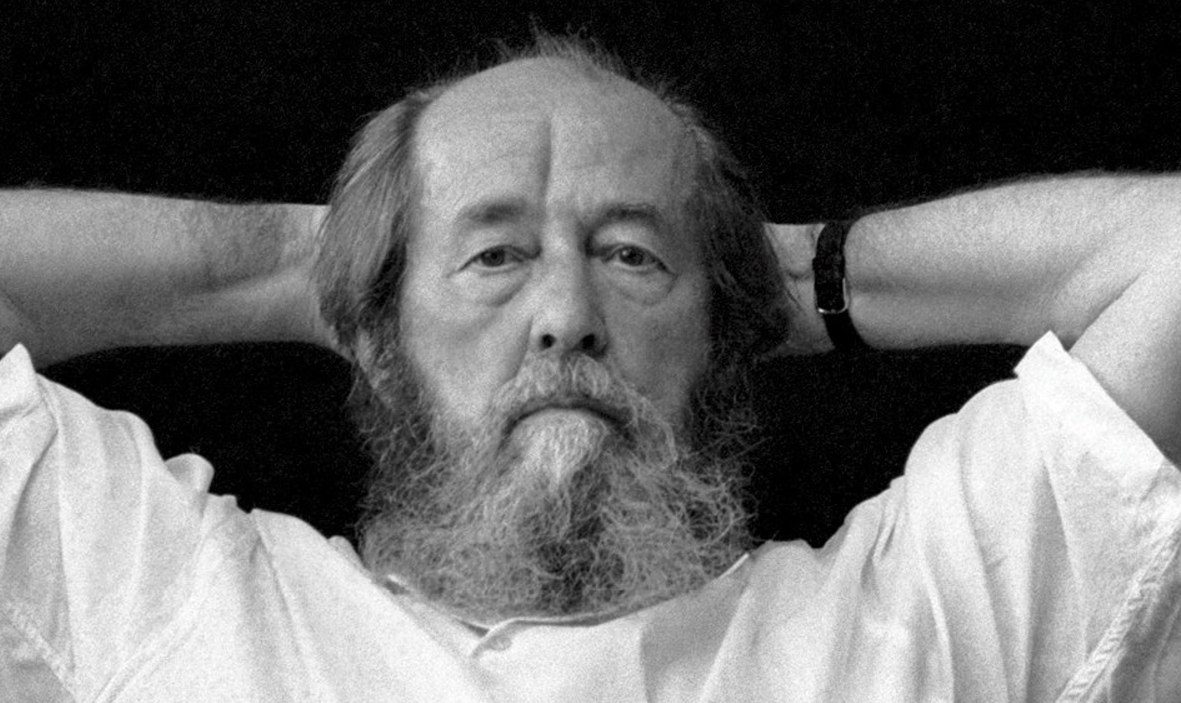Il est bien connu qu’une manière de tester un système, c’est de le mettre « sous stress » : cela révèle les failles, les problèmes – structurels ou non. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la crise sanitaire liée au Corona Virus (COVID-19) a bien révélé les failles du système de soin et de la société française. Voici quelques problèmes, quelques choses positives aussi, et quelques enseignements.
Les problèmes (re)révélés
Crise des élites
La crise des élites françaises, d’abord, si bien décrite par Pierre Mari, a été flagrante : gesticulation médiatique du pouvoir, navigation à vue, discours plats du président. Chacun a pu observer cela. J’en reparlerai en conclusion.
Territoires pas perdus pour tout le monde
Il n’y avait pas de raisons que pour que cela change, mais dès le début du confinement on a pu vérifier qu’il y a désormais plusieurs sortes de territoires en France, séparés, et n’obéissant pas aux mêmes règles (qui ne sont pas imposés par l’Etat). Cette réalité, montrée timidement, a vite été oubliée (heureusement certains médias continuent à parler du réel et il y a des sources alternatives partout sur Twitter).
Politisation de la société
La politisation de la justice, manipulée par des lobbys anticapitalistes et multiculturalistes a également été bien visible (affaire Amazon, qui n’a fait que confirmer ce que l’on avait pu voir au moment de l’affaire du mur des cons, des cabales contre Zemmour, ou de l’affaire Fillon. Cette politisation est également perceptible dans le domaine scientifique avec l’affaire Raoult : mélanger science et politique est monnaie courante et devrait toujours alerter les esprits critiques. Raoult n’est pas certainement pas le sauveur que certains ont voulu voir, mais ses arguments tiennent la route, et la mise en place de tests massifs dans son IHU devraient à minima imposer une forme de respect de la personne.
Inflation administrative et bureaucratique
Les deux problèmes mentionnés ci-dessus, ressortant d’une extension de la « politisation » de tous le sujets, me semble avoir une cause commune : l’inflation permanente du champ d’action de l’Etat. Cette inflation administrative, normative, bureaucratique, conduit à une « soviétisation » de l’économie française, et à beaucoup d’inepties.
Notamment, visible en ces temps de crises, des éléments de manque de réactivité et de compréhension des priorités. Scandaleux. Et comme les couches du mille-feuille sont multiples, on aboutit forcément à des décisions arbitraires, sans vision d’ensemble : pourquoi les hyper-marchés peuvent être ouvert, et pas les petits commerces ?
Classe politique globalement indigente
Les membres de la classe politique ont montré, dans leur grand majorité, qu’ils n’incarnaient plus aucune forme de « stratégie », ou de hauteur de vue. Globalement incapables de s’inspirer de ce qui marche dans les autres pays, ou d’appeler au refus des actions idiotes (élections régionales, avec confinement le lendemain). Je ne parle même pas des réactions du monde syndical, tant il nous avait déjà montré à quel point ils étaient hors de la réalité vécue par les français.
Idéologisation des esprits et utopie
La difficulté à être dans le réel, justement, et à résoudre les problèmes qui se posent à nous, ici et maintenant, fait partie de ce qui est ressorti de plus pénible. Obsession de l’idéal, et de l’après, très bien décrite et analysée par Philippe Silberzahn. Cette forme d’obsession utopique, et de préférence pour les idéaux, me semble être dans le même registre passif que la « vénération/détestation » des dirigeants : on a passé plus de temps à commenter les discours de Macron, dans la sphère médiatique, qu’à réfléchir aux moyens qui pourraient être mis en oeuvre pour pallier à nos manques.
Dans ce monde hors-sol, il est logique que les constructivistes aux manettes continuent à utiliser les mêmes leviers, addictifs, que d’habitude : l’argent sort de terre (ou plutôt de la planche à billet), pourquoi ne pas en distribuer à tout le monde ? Nous continuons de préparer la prochaine crise financière.
Quelques sources d’espoir
Solidarité et entraide spontanées
Il y a malgré tout, quelques signes encourageants. La capacité des gens à spontanément s’organiser a été remarquable. J’applaudis à ma fenêtre, et je suis content de voir mes voisins et les saluer. Je n’applaudis pas les soignants, mais l’ensemble des gens qui sont en première ligne, sans masques, depuis plusieurs semaines (livreurs, policiers, vendeurs, etc.). J’ai également trouvé salutaire l’effervescence de production et de partage de blagues sur le confinement, extraordinaire soupape, et moyen de prise de recul par rapport à des nouvelles très anxiogènes. Les forces d’entraide et de solidarités ont joué à tous les niveaux (y compris au niveau des si décriées et honnies entreprises).
Emergence de nouvelles figures ?
Il est trop tôt pour le dire, mais j’aime à penser que certaines voix qui se sont confirmées ou qui ont émergées dans ces temps de crises comme étant porteuses de vision structurées pour la France, prendront de l’importance dans l’après.
Enseignements : retour aux principes de base
Deux principes me paraissent essentiels à mettre en avant pour garder une forme de lucidité. La responsabilité, et l’esprit critique.
Et la responsabilité, bordel ?
Il est grand temps de redonner sa place à la responsabilité, indispensable composante de la liberté. Seuls des individus peuvent être responsable. On est responsable de quelque chose, devant quelqu’un. Il me semble qu’un certain nombre des maux décrits ci-dessus sont en partie causé par un manque généralisé d’esprit de responsabilité. Il ne s’agit pas de chercher des coupables, simplement de remettre cette logique d’action au coeur de l’organisation sociale. Devant qui sont responsables les juges ? Devant qui le gouvernement est-il responsable ? Devant qui l’obscur fonctionnaire qui interdit à un entrepreneur de vendre des masques est-il responsable ? Devant qui sont responsables ceux qui n’envoient pas les malades en surnombre vers les cliniques privées ? Tous ces fonctionnaires, ou membres de l’appareil d’Etat, ou de la sphère publique, devraient être responsables devant les contribuables, et devant le peuple. L’Etat doit être au service du peuple, et pas l’inverse. Quelles procédures allons-nous mettre en place pour éviter les dysfonctionnement et les décisions absurdes ? Les élites ne pourront être réhabilités dans l’esprit des français que s’ils endossent, en même temps que le pouvoir, des responsabilités.
Esprit critique
A titre personnel, je traverse cette crise étant plus convaincu que jamais qu’il est indispensable d’apprendre à penser par soi-même. Les experts de l’OMS ont donné, sur le port des masques, des avis contradictoires à une semaine d’intervalle. Personne ne peut penser, ou évaluer à notre place. Si les français apprennent à nouveau à penser par eux mêmes, à sortir des carcans idéologiques qui empêchent de voir le réel, alors cette crise aura peut-être apporté une bonne chose. Espérons que peu à peu cela permette de sortir de la double impasse dans laquelle nous sommes : socialiste, et multiculturaliste.
Quelques règles d’hygiène de pensée, pour compléter l’hygiène du langage, sont toujours utiles à rappeler ou à intégrer dans nos habitudes.
- Ne pas accepter les arguments d’autorité, tout en écoutant les experts
- Laisser une place au doute, et comparer plusieurs points de vue avant de se faire une opinion
- Distinguer ce qui est de l’ordre des faits / énoncés sur la réalité, et ce qui est de l’ordre des représentations / interprétations de cette réalité
- Se méfier de ceux qui cherchent à éviter le réel
Il y en certainement plein d’autres : vous les partagez en commentaire ?