On devrait toujours relire les excellents ouvrages : c’est bien d’ailleurs ce que désigne l’expression « livre de chevet ». C’est ce que je suis en train de faire avec deux d’entre eux en ce moment, dont l’extraordinaire « L’action humaine », de Ludwig Von Mises11. Lien wikipedia : faites attention à la qualité des informations que vous pouvez y trouver, notamment celles ayant des résonnances politiques.. Il est extraordinaire tant par l’ampleur du propos (fonder la science économique / praxéologie, ou science de l’action humaine), que par le style incroyablement clair, synthétique tout en étant d’une grande précision conceptuelle. C’est la deuxième fois que je le lis, et je suis déjà à peu près sûr que je le relirai un jour (j’en avais déjà parlé ici : Pas d’excuses : deux grands livres gratuits)
Mon propos ici n’est pas de vous en donner une synthèse, mais plutôt de vous demander de me faire aveuglement confiance : achetez le livre, ou téléchargez-le, lisez les 50 ou 100 premières pages et dites moi si vous pouvez arrêter la lecture. Sachez simplement qu’il y est question de l’action humaine, et de la science qui étudie cette action. Von Mises pose au début du livre les bases épistémologiques et conceptuelles permettant de distinguer la praxéologie des autres sciences (sciences naturelles, psychologie, histoire). C’est-à-dire qu’il précise des éléments de méthode et des caractéristiques propres à l’économie ou praxéologie. Individualisme méthodologique, caractère formel et aprioriste, notions de valeur, de catallaxie (notion reprise par son élève Hayek). C’est absolument passionnant.
Pour donner une idée de son style, je recopie ici un long passage où il explique le caractère aprioristique de la praxéologie.
Les relations logiques fondamentales ne sont pas susceptibles de preuve ou de réfutation. Tout essai pour les prouver doit s’appuyer implicitement sur leur validité. Il est impossible de les expliquer à un être qui ne les posséderait pas pour son propre compte. Les efforts pour les définir en se conformant aux règles de définition ne peuvent qu’échouer. Ce sont des propositions premières, antécédentes à toute définition nominale ou réelle. Ce sont des catégories ultimes, non analysables. L’esprit humain est totalement incapable d’imaginer des catégories logiques autres que celles-là. Sous quelque forme qu’elles puissent apparaître à d’hypothétiques êtres surhumains, elles sont pour l’homme inéluctables et absolument nécessaires. Elles sont la condition première et indispensable de la perception, de l’aperception, et de l’expérience. (…)
L’esprit humain n’est pas une table rase sur laquelle les événements extérieurs écrivent leur propre histoire. Il est équipé d’un jeu d’outils pour saisir la réalité. L’homme a acquis ces outils, c’est-à-dire la structure logique de son esprit, au cours de son évolution depuis l’amibe jusqu’à son état actuel. Mais ces outils sont logiquement antérieurs à toute expérience quelconque. L’homme n’est pas simplement un animal, entièrement soumis aux stimuli déterminant inéluctablement les circonstances de sa vie. Il est aussi un être qui agit. Et la catégorie de l’agir est logiquement antécédente à tout acte concret.
Le fait que l’homme n’ait pas le pouvoir créateur d’imaginer des catégories en désaccord avec les relations logiques fondamentales et avec les principes de causalité et de téléologie nous impose ce que l’on peut appeler l’apriorisme méthodologique.
Tout un chacun dans sa conduite quotidienne porte témoignage sans cesse de l’immutabilité et de l’universalité des catégories de pensée et d’action. Celui qui adresse la parole à ses semblables, qui désire les informer et les convaincre, qui interroge et répond aux questions d’autrui, peut se comporter de la sorte uniquement parce qu’il peut faire appel à quelque chose qui est commun à tous — à savoir la structure logique de l’esprit humain. L’idée que A puisse être en même temps non-A, ou que préférer A et B puisse être en même temps préférer B à A, est simplement inconcevable et absurde pour un esprit humain. Nous ne sommes pas en mesure de comprendre une sorte quelconque de pensée prélogique ou métalogique. Nous ne pouvons penser un monde sans causalité ni téléologie. Il n’importe pas à l’homme qu’il y ait ou non, au-delà de la sphère accessible à l’esprit humain, d’autres sphères où existe quelque chose qui diffère, par ses catégories, du penser et de l’agir humains. Nulle connaissance ne parvient de ces sphères à un esprit humain. Il est oiseux de demander si les choses-en-soi sont différentes de ce qu’elles nous apparaissent, et s’il y a des mondes que nous ne pouvons comprendre et des idées que nous ne pouvons saisir. Ce sont des problèmes hors du champ de la cognition humaine. Le savoir humain est conditionné par la structure de l’esprit humain. S’il choisit l’agir humain comme objet de ses études, il ne peut avoir en vue que les catégories de l’action qui sont propres à l’esprit humain et sont la projection de cet esprit sur le monde extérieur en changement et devenir. Tous les théorèmes de la praxéologie se réfèrent uniquement à ces catégories de l’action et sont valides seulement dans l’orbite où elles règnent. Ils ne prétendent fournir aucune information sur des mondes et des relations dont nul n’a jamais rêvé et que nul ne peut imaginer.
(….)
Le raisonnement aprioristique est purement conceptuel et déductif. Il ne peut rien produire d’autre que des tautologies et des jugements analytiques. Toutes ses implications sont logiquement dérivées des prémisses et y étaient déjà contenues. Donc, à en croire une objection populaire, il ne peut rien ajouter à notre savoir.
(…)
Tous les théorèmes géométriques sont déjà impliqués dans les axiomes. Le concept d’un triangle rectangle implique déjà le théorème de Pythagore. Ce théorème est une tautologie, sa déduction aboutit à un jugement analytique. Néanmoins, personne ne soutiendrait que la géométrie en général et le théorème de Pythagore en particulier n’élargissent nullement notre savoir. La connaissance tirée de raisonnements purement déductifs est elle aussi créatrice, et ouvre à notre esprit des sphères jusqu’alors inabordables. La fonction signifiante du raisonnement aprioristique est d’une part de mettre en relief tout ce qui est impliqué dans les catégories, les concepts et les prémisses ; d’autre part, de montrer ce qui n’y est pas impliqué. Sa vocation est de rendre manifeste et évident ce qui était caché et inconnu avant. Dans le concept de monnaie, tous les théorèmes de la théorie monétaire sont déjà impliqués. La théorie quantitative n’ajoute rien à notre savoir qui ne soit contenu virtuellement dans le concept de monnaie. Elle transforme, développe, ouvre à la vue ; elle ne fait qu’analyser et, par là, elle est tautologique comme l’est le théorème de Pythagore par rapport au concept de triangle rectangle. Néanmoins, personne ne dénierait sa valeur cognitive à la théorie quantitative. A un esprit qui n’est pas éclairé par le raisonnement économique, elle reste inconnue.
Et vous, quels sont vos livres de chevet ? Ceux que vous avez déjà relu, et que probablement vous relirez encore ?
Étiquette : Von Mises
-

L’action humaine
-

Enlisement idéologique
J’aime bien les voyages en train. Quand je suis seul, je passe au relais presse acheter un magazine qui me fait une partie du trajet. Lors d’un de mes derniers voyages, j’ai acheté le hors-série du Point, consacré aux grands débats de l’économie.
Méconnaissance des auteurs autrichiens
J’ai été déçu, je dois le dire. Il y a un gros travail de fait, mais depuis l’édito jusqu’à la manière de traiter les sujets, je retrouve l’espèce de mêli-mêlo peu éclairant que j’ai l’habitude de trouver dans les médias. C’est à mon sens relié à deux causes principales : une pensée très française, marxisante, et une presque complète méconnaissance de l’Ecole Autrichienne d’économie et des mécanismes économiques.
Je ne suis pas compétent pour juger tous les articles, et l’humilité la plus élémentaire consiste à garder une partie de ses critiques pour soi. Par contre, il se trouve que je connais quelques auteurs cités dans le recueil : Bastiat, Von Mises, Hayek notamment. Et sur ces auteurs, par contre, je peux me permettre de porter un regard critique. Et ce que je lis n’est pas glorieux.
Deux exemples. Il est dit de Bastiat, page 52, qu’il « ne doit pas être considéré comme un théoricien ». J’aimerais bien savoir pourquoi ! Au contraire, Bastiat, certes volontiers polémiques, a construit des bases de réflexions très proches de l’Ecole Autrichienne d’économie, avec une description de la valeur et de l’utilité comme des choses subjectives. Cette approche, qui ressort de l’individualisme méthodologique, est – contrairement à ce qui est écrit dans le Hors-série – une approche théorique très solide.
Deuxième exemple, sur Hayek, page 84 : après avoir décrit une de ses analyses, il est écrit qu’elle « reflète ses obsessions ». Pathologiser un auteur, de manière insidieuse, me rappelle les manières de faire du politiquement correct décrite par Bock-Côté. J’ai lu Hayek, et s’il y a un bien un auteur qui réfléchit de manière rationnelle, puissante, en amoureux de la vérité, c’est bien lui ! Mais un journaliste français ne pouvait pas faire un papier sur Hayek sans l’égratigner un peu au passage. Question de posture. Il ne faudrait pas que les copains socialistes pensent que le Point est devenu néo-ultra-libéral radical…
Biais déjà décrits par Butler
Le mêli-mêlo est typique de ce que décrit Benoît Malbranque dans la préface de l’excellente « Introduction à l’Ecole autrichienne d’économie », d’Eammon Butler (dispo gratuitement aux Editions de l’Institut Coppet) :
Bien que non majoritaire, une position courante concernant la méthodologie économique est de dire qu’aucune des méthodologies n’est la réponse unique aux défis épistémologiques de l’économie, et que, pour cette raison, il convient de n’en employer aucune de manière directe. Ce « pluralisme méthodologique », comme certains l’ont appelé, a de nombreux défenseurs et jouit d’un prestige grandissant. Il est pourtant aisé de comprendre pourquoi ce n’est pas une position satisfaisante. Au fond, le pluralisme méthodologique n’est rien de plus que la réponse d’économistes égarés incapables de se faire un avis sur ce qui constitue la méthode appropriée à la science économique. […]
Pour Ludwig Von Mises et ses disciples, la question de la méthode est fondamentale : elle conditionne le sain développement de théories économiques rigoureuses, justes et porteuses de sens. Les principes méthodologiques soutiennent l’ensemble de l’édifice autrichien, et c’est sans surprise qu’on retrouve leur exposition dans la plupart des grandes oeuvres de Mises. Ce dernier se faisait une idée bien précise de l’économie. Il fallait se la représenter comme une sous-catégorie de la « science de l’agir humain » qu’il intitula « praxéologie ». En économie, il ne s’agit pas de dire pourquoi les individus agissent en suivant tel ou tel objectif ou en s’efforçant de faire correspondre leur conduite à tel ou tel code moral. Il s’agit de reconnaître et d’utiliser le fait qu’ils agissent bel et bien en suivant des objectifs et en faisant correspondre leur conduite à un code moral — en somme, qu’ils agissent intentionnellement.[…] Dans leur insistance sur le choix de l’action humaine comme fondement de toute connaissance économique, les Autrichiens étaient nécessairement poussés à n’accepter que les individus comme sujet de leur étude, et à suivre scrupuleusement l’individualisme méthodologique. Après tout, seuls les individus agissent. Ainsi que l’écrira le même Rothbard, « la première vérité à découvrir à propos de l’action humaine est qu’elle ne peut être initiée que par des « acteurs » individuels. Seuls les individus ont des objectifs et agissent pour les atteindre.»Ce qui me reste de cette lecture (le Hors-Série du Point) : l’impression gênante qu’il s’agissait plus pour les auteurs de prétendre couvrir tous les points de vue que de regrouper des savoirs. Non : on ne peut pas mettre toutes les idées au même niveau, comme si c’était une affaire de goûts et de couleurs. La Science économique, solide dans l’approche autrichienne, parce que ne cherchant pas à singer les sciences naturelles, en faisant étalage d’outils mathématiques camouflant la réalité sous des macro-indicateurs composites, est une science de l’action humaine. Il faut commencer par rappeler ce que l’on sait. Il en va sur ce sujet, comme sur les sujets de réchauffement climatique, d’un mauvais mélange de science et de politique (c’est souvent le cas). Les journalistes auteurs de ce hors-Série feraient bien de se reprendre, et de sortir de leur enlisement idéologique.
-
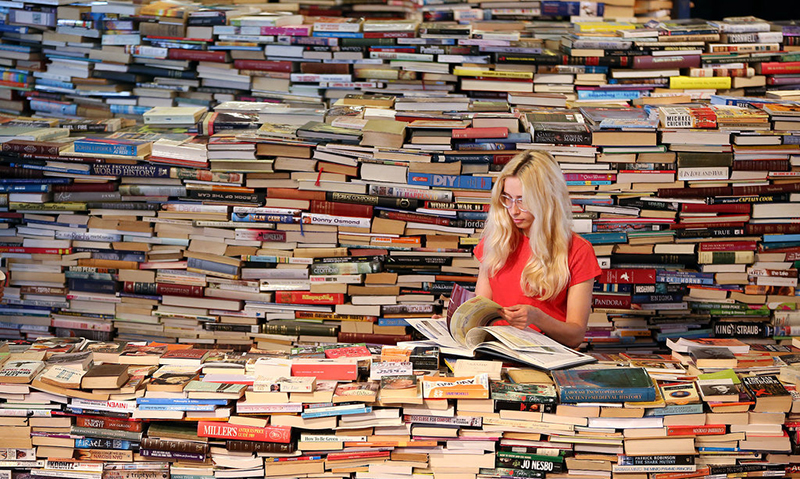
Pas d’excuses : deux grands livres gratuits
C’est pour partager deux liens passionnants que je fais ce court article aujourd’hui. Plus que des liens, ce sont deux livres accessibles gratuitement en ligne. De grands ouvrages du libéralisme : Harmonies économiques (Bastiat) et L’action humaine (Von Mises). Les deux sont des ouvrages d’économie, mais pas d’économie au sens technique du terme. Non : simplement des ouvrages qui parlent de l’action humaine, et des choses que l’on sait sur cette action, sur les éléments qui influencent les choix des individus, et sur les phénomènes qui en résultent.
Harmonies économiques : la valeur est subjective
Le premier est le magnifique « Harmonies économiques« , de Frédéric Bastiat. Profond, enthousiaste, optimiste et écrit dans un français vraiment beau et précis. Dans cet ouvrage (mais il faut lire tout Bastiat), Bastiat livre sa vision de la société et pose les bases, en partie, de ce qu’on appellera par la suite l’école autrichienne d’économie. Quelques points saillants (communs aux deux auteurs je trouve, et c’est pourquoi ils sont dans une même école de pensée) :
- la société est harmonique, c’est-à -dire qu’un certain nombre de mécanismes auto-régulent une bonne partie des phénomènes à l’oeuvre dans une société de droit, pour autant que l’on respecte de manière stricte la liberté d’action (liberté étant entendu au sens de « libre dans le cadre de la loi »). Cette vision est explicitement opposée à une vision socialiste ou communiste, et avant que Marx ne sévisse, Bastiat avait déjà démonté une bonne partie de la doxa socialiste/communiste.
- la valeur est toujours subjective : toute tentative pour décrire une valeur absolue est par principe vouée à l’échec. La valeur, c’est ce que chaque individu va associer, dans un contexte donné, à telle ou telle action ou choix. La valeur c’est toujours une préférence dans l’action. Rien d’immuable ou de constant ou d’objectif, donc. La valeur est subjective.
L’action humaine, traité de praxéologie
Le second livre est le non moins important traité de « L’action humaine« , de Ludwig Von Mises. Ce fabuleux livre, clair, concis et direct apporte des éléments fondamentaux pour comprendre ce qui distingue, comme science, l’économie des autres autres sciences. L’économie, ce n’est pas l’histoire, ce n’est pas la biologie, ce n’est pas la philosophie, c’est une science de l’action humaine (praxéologie).
La praxéologie traite de l’action humaine en tant que telle, d’une façon universelle et générale. Elle ne traite ni des conditions particulières de l’environnement dans lequel l’homme agit ni du contenu concret des évaluations qui dirigent ses actions. Pour la praxéologie, les données sont les caractéristiques psychologiques et physiques des hommes agissants, leurs désirs et leurs jugements de valeur, et les théories, doctrines, et idéologies qu’ils développent pour s’adapter de façon intentionnelle aux conditions de leur environnement et atteindre ainsi les fins qu’ils visent.
(Ludwig von Mises, L’Action humaine, 1949)
Je ne saurais assez vous recommander la lecture de ces deux ouvrages. Commencez par le Bastiat, plus simple, et antérieur dans le temps. Harmonies économiques devrait être au programme d’étude du cycle normal de tout lycéen. Découvrir ce qu’est la valeur, l’échange, la monnaie, la propriété, au travers de textes courts, bien écrits, riches philosophiquement tout en étant limpides : voilà une mission qui devrait être remplie par tout système éducatif bien pensé.
Donc, vous ne savez pas ce qu’est l’économie, ni par où prendre le morceau ? Il y a des ressources merveilleuses en ligne, gratuitement accessibles: Pas d’excuses !