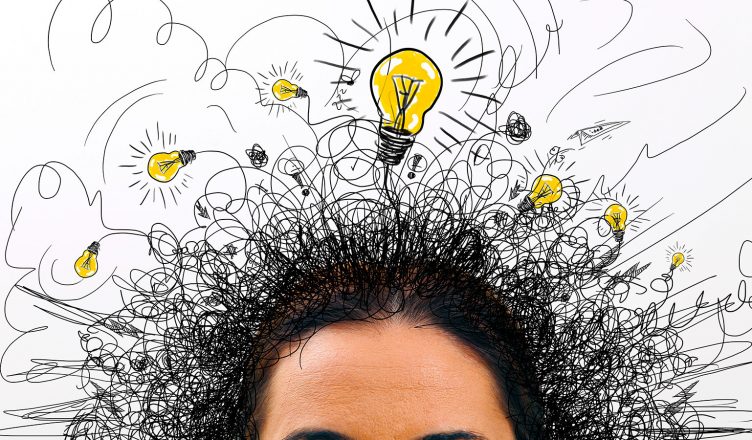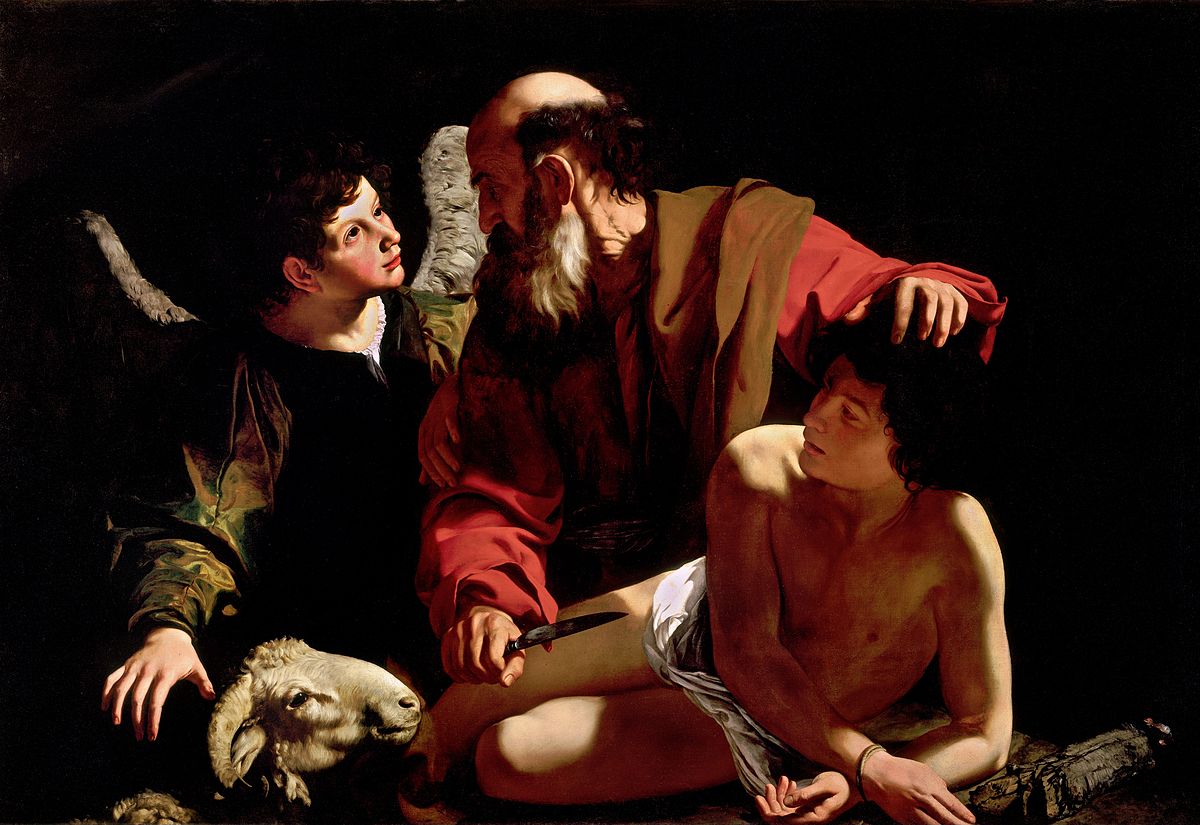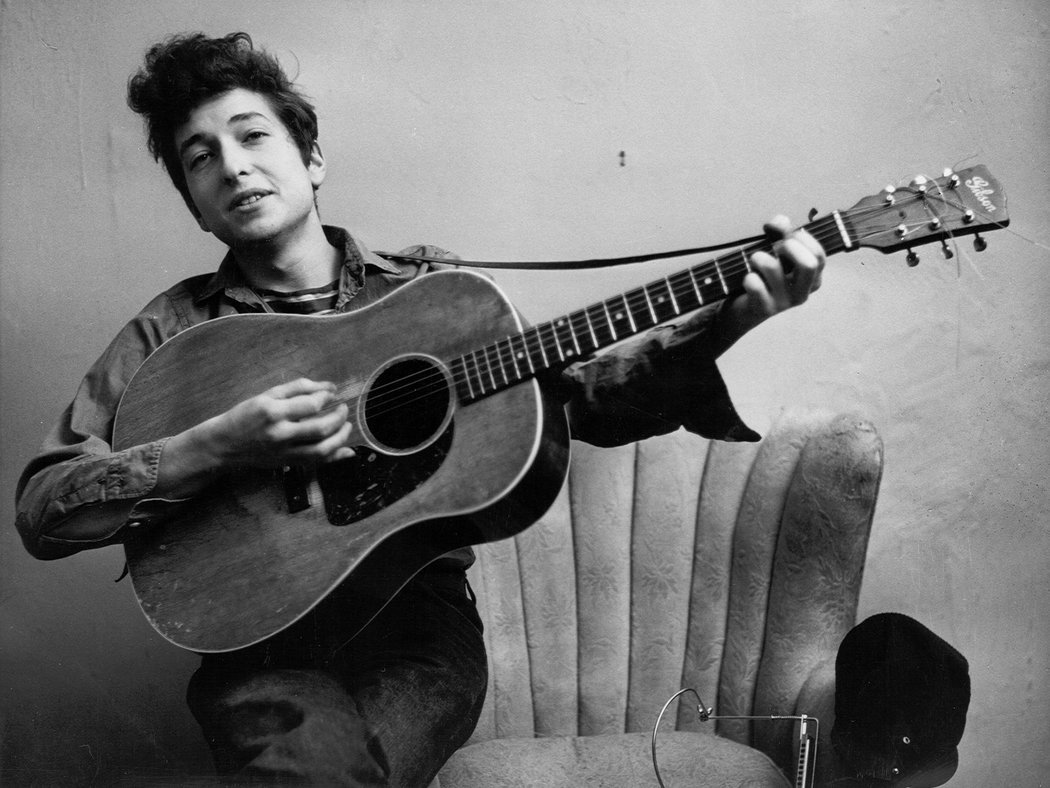J’ ai toujours beaucoup aimé la science-fiction, dans les romans, comme au cinéma. C’est un genre d’histoire qui permet de décaler complètement le regard sur le monde, en proposant des univers imaginaires très riches, utopiques ou dystopiques (souvent dystopiques, d’ailleurs). Je garde des souvenirs forts des romans de Ray Bradbury, HG Wells, Isaac Asimov, Frederic Brown, Dan Simmons, ou autres Maurice Dantec.
2 auteurs de science-fiction à découvrir
Je partage avec vous deux nouveaux auteurs que j’ai dévoré depuis cet été :
- Iain M. Banks, auteur d’une somme de livres regroupés en un « cycle de la culture ». Je viens de terminer les deux premiers, qui sont vraiment de bons romans, dans un univers étonnant, mêlant une technologie très avancée, et des cultures très différentes. Les descriptions des IA que l’on peut y trouver sont vraiment très intéressante, parce que l’accent est mis sur l’interaction entre les humains et les sortes de robots. Il y a aussi des Mentals, qui sont des sortes de super intelligence artificielles, presque des Dieux, qui pilotent en partie le destin de l’humanité.
- Philippe K. Dick, qui est un auteur ultra-connu, mais que je découvre avec un plaisir immense. Après deux recueils de nouvelles, « Question de méthode », et « Paychek », je me délecte avec « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? ». C’est le livre qui a servi d’inspiration pour « Blade Runner ». Philippe K. Dick a un style vraiment extraordinaire, plein d’humour, de noirceur aussi, et ses personnages sont vraiment forts, très humains, vivants, avec des émotions contradictoires et simples à la fois. Un grand auteur (plus puissant d’ailleurs que Iain M Banks, à mes yeux)
Bref, la science-fiction continue à être un style passionnant pour moi. Les imaginaires technologiques ont déjà été travaillés par une multitude d’auteurs, et à ce titre constitue une matière culturelle très vive, présente, et qui pose une foule de questions passionnantes. A lire sans modération !