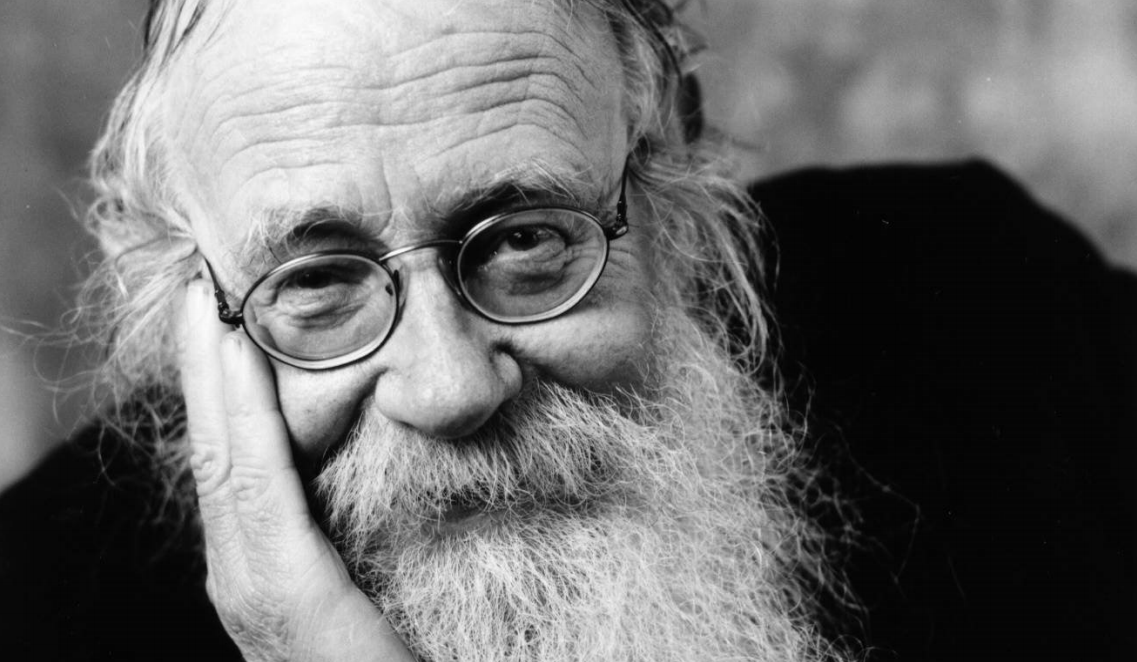Le dernier numéro de l’Incorrect est probablement le meilleur depuis le début. Il tape très fort en mettant l’accent sur ce qui se passe dans les pays de l’Est, et avec des interviews d’Eric Zemmour et Boualem Sansal. Et il m’a bousculé : dès l’édito de Jacques de Guillebon, La muselière, apparaît le mot illibéralisme. C’est un point de controverse récurrent avec mes amis de L’Incorrect : je suis le libéral de la bande, et ils n’entendent pas la liberté comme je l’entends.
Bien sûr, il ne s’agit pas d’un tic de langage. Il s’agit d’un des thèmes mis en avant par Viktor Orban dans ses discours. Dire qu’il a théorisé l’illibéralisme, c’est tout de même un peu fort ; disons qu’il utilise le terme, et qu’il y a un mis un contenu. Le numéro du magazine m’a donc bousculé, énervé, et finalement m’a forcé à réfléchir. Ce qui est le meilleur compliment que je puisse faire à l’équipe de rédaction.
Le libéralisme, bouc émissaire ?
Raymond Boudon utilise également le terme illibéralisme pour désigner « cette théorie latente, souvent présente à l’état semi-conscient, selon laquelle toute relation sociale conflictuelle serait un jeu à somme nulle. Ce prisme d’analyse, très couramment utilisé, ignore qu’une possible coopération se cache derrière tout conflit […]». Rien à voir, ou pas grand-chose avec ce dont il est question ici.
Les opposants affichés au libéralisme font une sorte de gloubiboulga pour mettre sur le dos du libéralisme, tour à tour : le consumérisme, la marchandisation du corps humain, l’abandon des frontières, Le libéralisme est devenu le bouc-émissaire idéologique par excellence.la perte d’identité. Et pourquoi pas la destruction de la planète, pendant qu’on y est ? Quelle boutade ! C’est la logique du bouc-émissaire, si bien décrite par René Girard : le libéralisme est devenu le bouc-émissaire idéologique par excellence. Comme l’avait bien décrit Christian Morel : quand il y a un problème, soit on cherche un coupable, le bouc émissaire, que l’on sacrifie pour exorciser le mal, soit on se comporte de manière rationnelle, et on cherche la manière de modifier nos modes de fonctionnements pour que le problème ne se pose pas à nouveau dans quelques temps.
Il est probablement commode de choisir le libéralisme comme bouc-émissaire. C’est surtout commode quand on vit dans une société dont le mode d’organisation, pacifique, ouvert, tolérant, libre, avec une égalité des citoyens devant la loi, doit à peu près tout au libéralisme, et permet de dire à peu près tout et n’importe quoi. Mais scier la branche sur laquelle on est assis n’a jamais constitué une manière adéquate de se comporter. Par ailleurs, choisir le libéralisme comme bouc-émissaire, c’est lui donner un caractère sacré, presque divin, qui n’est absolument pas juste intellectuellement. S’il y a une pensée rationnelle, peu idéologique, c’est bien le libéralisme. Sa vertu et sa cohérence doit probablement attiser des jalousies.
Quelle est la fonction du bouc émissaire ? Celle d’expier les fautes pour le groupe, et de stopper la propagation de la violence. Ne sous-estimons pas les faits : le besoin et la recherche de bouc émissaire correspond à une période sociale difficile, violente. Quelle est cette violence qui nécessite un bouc émissaire idéologique ? La vraie violence de la société d’abord, bien sûr. Les attentats. Le désarroi idéologique aussi, il me semble. Dans un époque où la vérité devient si difficile à dire et à discuter, où l’esprit rationnel et critique est si peu présent dans la société, il est probable que cette logique de victime expiatoire soit naturelle. Naturelle, mais dangereuse, car elle entretient une forme d’illusion de réglage des problèmes. On ne règle rien par la violence, et surtout pas dans la logique de bouc émissaire.
Mais ça ne prend pas : intellectuellement, tout cela est du pipeau. Comment expliquer qu’il y a trop de libéralisme, dans un pays où l’état est omniprésent ? La libéralisme, c’est le respect de l’ordre spontané, la cattalaxie. La libéralisme, c’est la subsidiarité. Il n’y a pas grand chose dans la France de 2018 qui ressorte d’un excès de libéralisme.
Est-on illibéral parce qu’on veut affirmer l’identité culturelle et historique de son pays ? Je ne crois pas, d’autant plus que notre identité culturelle est profondément occidentale et libérale.
Les marxistes ont gagné ?
Les marxistes ont réussi leur tour de force sémantique et idéologique : tout le monde, de l’extrême gauche à l’extrême droite, rejette le libéralisme. La plupart du temps sans savoir ce que c’est. Mais la guerre idéologique est sur ce point, gagnée. Il est de bon ton, pour être audible, de cracher sur le libéralisme.
Les vrais combats
L’ennemi, on l’aura compris, n’est pas le libéralisme. Quel est-il ? Il y a, à mon sens, deux choses qu’il s’agit de combattre, et qui ressortent d’un même trait, à savoir une tendance à l’excès : un excès d’ouverture à des moeurs et éléments venant d’autres civilisations, et un excès dans l’expansion des droits à , qui est un trait de notre propre culture démocratique.
Excès de tolérance
Pour faire vite, par excès de tolérance à la différence et dans une forme écoeurante de relativisme moral, nous avons laissé en France se développer des moeurs, et des modes de fonctionnement qui ne sont pas compatibles avec les valeurs occidentales. Les zones de non-droit, le communautarisme, la mise sous coupe réglée d’une partie de la communauté musulmane par les islamistes sont quelques exemples. Ces incompatibilités, ces différences, sont toujours au fond liées à des différences de civilisations, donc de religion.
En laissant se développer l’islam radical, par aveuglement anticlérical conduisant à nier le fait religieux, on a provoqué un retour vers l’expression politique du fait religieux. Le christianisme doit-il s’engouffrer là -dedans ? Notre excès de tolérance nous a conduit à tolérer des moeurs inacceptablesLes politiciens conservateurs, ou simplement amoureux de leur pays, doivent-ils nécessairement porter le drapeau d’une religion dans leurs combats politique ? Je ne le crois pas. Le christianisme, qui a inventé la laïcité, se perdrait dans ce jeu de dupes.
C’est aux politiciens de lutter contre l’idéologie islamique, pas aux religieux. Ce faisant les catholiques et autres chrétiens tombent dans le piège redoutable d’accréditer l’idée selon laquelle l’islam serait une religion, au même titre que le christianisme. Ce qui est faux. Le christianisme est sécularisé. Le christianisme ne prône pas la guerre mais l’exemplarité, par la vertu. Sur les liens, entre politique, conservatisme et religions, je ne résiste pas à citer un passage d’Hayek, grand philosophe, issu d’un article, « Why i am not conservative« , où il explique que le terme « libéral » a déjà été tellement abîmé par la gauche qu’il hésite à se dire encore « libéral ».
Il y a cependant un aspect qui justifie de dire que le libéral occupe une position à mi-chemin entre le socialiste et le conservateur: il est aussi éloigné du rationalisme brut du socialiste qui veut reconstruire toutes les institutions sociales selon un modèle prescrit par sa raison individuelle, que du mysticisme auquel le conservateur doit si souvent recourir. Ce que j’ai décrit comme la position libérale partage avec le conservatisme une méfiance envers la raison dans la mesure où le libéral est très conscient du fait que nous ne connaissons pas toutes les réponses, et qu’il n’est pas sûr que les réponses qu’il a sont certainement les bonnes ou même que nous pouvons trouver toutes les réponses. Il ne refuse pas non plus de demander de l’aide à des institutions ou des habitudes non rationnelles qui ont fait leurs preuves. Le libéral se distingue du conservateur par sa volonté de faire face à cette ignorance et d’admettre à quel point nous savons peu de choses, sans revendiquer l’autorité de sources de connaissances surnaturelles là où sa raison lui manque. Il faut bien admettre que, sous certains aspects, le libéral est fondamentalement un sceptique – mais avec suffisamment de modestie pour laisser les autres chercher leur bonheur à leur manière et pour adhérer systématiquement à cette tolérance qui est une caractéristique essentielle du libéralisme.
Il n’y a aucune raison pour que ce besoin signifie une absence de croyance religieuse de la part des libéraux. À la différence du rationalisme de la Révolution française, le libéralisme vrai n’a rien contre la religion, et je ne peux que déplorer l’anticléricalisme militant et essentiellement illibéral qui animait le libéralisme continental du XIXe siècle. Le fait que cela n’est pas essentiel dans le libéralisme est clairement démontré par ses ancêtres anglais, les Old Whigs, qui, au contraire, étaient bien trop étroitement liés à une croyance religieuse particulière. Ici, ce qui distingue le libéral du conservateur, c’est que, aussi profondes que soient ses croyances spirituelles, il ne se considérera jamais comme ayant le droit de les imposer aux autres et que, pour lui, le spirituel et le temporel sont des sphères différentes qui ne doivent pas être confondues.
Notre excès de tolérance nous a conduit à tolérer des moeurs inacceptables, à commencer par la place de la femme dans l’islam, et par le rejet de la liberté de croyance, et de la laïcité. Rien de tout cela n’est attribuable au libéralisme.
Expansion infinie des « droits à … »
Pierre Manent en a très bien parlé dans son dernier ouvrage. Notre culture démocratique nous a conduit à accroître sans cesse l’exigence de nouveaux droits, qui dépassent maintenant largement les droits naturels qui avaient été explicités par les différents textes des révolutions libérales. Cet excès, interne à l’Occident, et non plus externe, doit évidemment être combattu avec force. Je crois que c’est une partie de la discussion. Les dérives eugénistes, GPA, et autres délires transhumanistes, n’ont pas tellement de rapport avec le libéralisme, mais plutôt avec un manque d’éducation, de barrières morales délimitant le bien et le mal. Pas grand-chose à voir avec le libéralisme.
Il est tout de même piquant que ces deux choses (excès de tolérance, extension infinie des droits), que je crois lire dans les critiques du libéralisme, soient des excès ; alors que le libéralisme est une philosophie qui justement a pensé les limites que l’on devait poser au pouvoir et à la liberté pour que la société soit juste. Le libéralisme est une pensée de la modération et de la régulation ; lui attribuer des excès est tout de même bien paradoxal, voire franchement ridicule.
Libéral-conservatisme
Combattre ces deux excès – excès de tolérance à la différence, et excès d’extension des droits – doit être notre combat. Et si la cible est une partie de nos élites, alors critiquons les pour de vraies raisons… les tenants d’une Europe qui nierait l’identité des peuples ne pèchent pas par libéralisme, ils pèchent par manque d’enracinement dans leur propre histoire. C’est probablement une forme d’universalisme un peu abstrait et niant les particularismes que l’on pourrait leur reprocher, certainement pas leur libéralisme.
Illibéralisme ou conservatisme ?
Le petit encart de Benoît Dumoulin (p 58) pose très bien le débat. En gros, l’illibéralisme n’est pas opposé aux valeurs fondamentales du libéralisme, mais est simplement la forme actuelle « la plus aboutie du conservatisme ». Et l’on retombe sur l’éternel problème de la droite, qui décidément ne veut pas comprendre qu’elle doit être capable de faire la synthèse entre libéralisme et conservatisme, non pas de continuer à opposer les deux.
Il n’y a, à mon sens, aucune incohérence dans une position politique libérale-conservatrice. Continuer à opposer les deux, c’est manquer ce qui permettrait d’unifier, justement, la droite. Et le grand paradoxe de ce numéro de l’incorrect, c’est que Chantal Delsol, toujours passionnante, et connue pour son positionnement libéral-conservateur, rentre dans ce credo « illibéral », au lieu de nous aider à articuler les deux, et d’être ainsi la cheville ouvrière de l’union des droites.
La tolérance et les droits naturels sont au coeur de la pensée libérale. Il suffit pour cela de relire cette très belle phrase du préambule de la Déclaration d’indépendance américaine :
Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur.
C’est l’excès de tolérance dont nous avons collectivement fait preuve qui fait du libéralisme une cible. Mais ni la tolérance, ni la liberté, ne doivent devenir nos ennemis. Ce sont de belles choses. Battons-nous contre ce qui n’est pas tolérable (y compris la tolérance à l’intolérable), et n’unissons pas nos cris à ceux qui ne visent qu’une forme ou une autre d’asservissement.
Il appartient aux intellectuels de droite ou de gauche, de France et de Navarre, d’articuler tout cela et de penser les tensions et les paradoxes : l’universel et le particulier, la tolérance et l’identité, la liberté et l’égalité.
L’illibéralisme n’est pas le bon outil conceptuel. Qu’Orban soit un allié potentiel pour réinventer une Europe qui assume son identité, c’est une chose. Cela ne fait pas de l’illibéralisme, mot niant la liberté, un idéal intéressant.