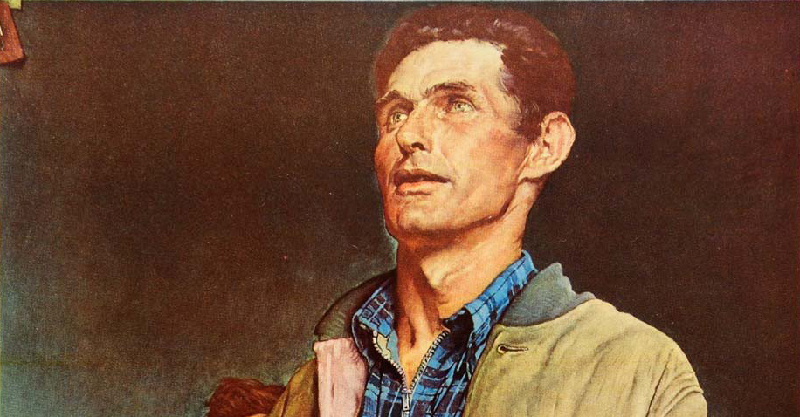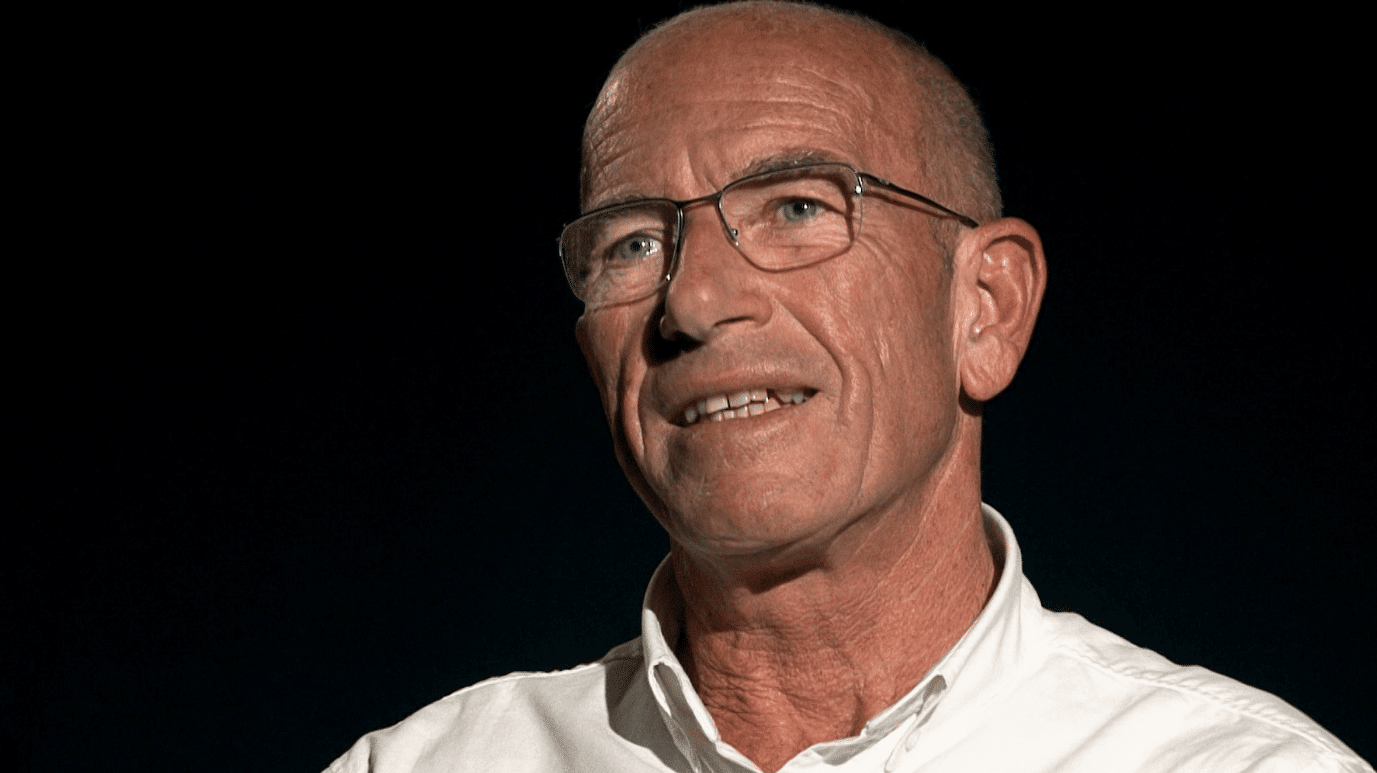Je ne serais probablement pas d’accord en tout avec Etienne Chouard, mais il a raison quand il dit que tout citoyen devrait réfléchir à la Constitution. Et je pense que sur le point de la liberté d’expression, cela s’applique très bien.
Constitution
La définition de la Constitution dit bien sûr tout, mais je suis plus pragmatique que cela. De mon point de vue, il est plus simple de repartir des basiques : toute société humaine fonctionne en ayant un certains nombre de règles. Ces règles définissent un certain nombre d’interdits qui encadrent la liberté humaine, en précisant les conditions d’applications. Elles doivent être, pour être justes, adossée aux règles morales de la société en question, et valable pour tous de la même manière. Certaines de ces règles sont implicites, traditionnelles, et d’autres sont explicites, écrites. Je ne reviens pas là-dessus, j’en ai déjà parlé en détail ici : Loi et règlementation.
La Constitution, dans mon esprit, est un ensemble de principes et de meta-règles qui permettent de juger de la validité des règles (lois, règlementations, décrets, etc.). La Constitution définit ce qu’est une bonne règle.
C’est dans cet esprit que le Bill of Right US a été écrit, et je le trouve bien plus puissant et pertinent que notre propre constitution (qui en fait, sans la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, n’est qu’une longue liste descriptive de l’organisation des pouvoirs, certes intéressante, mais guère utile pour parler « principe » ou « meta-règles »). Pourquoi ? Parce la première meta-règle, le premier amendement, dit qu’une bonne loi ne pourrait entraver la liberté de conscience et d’expression des citoyens. Le second amendement, dit qu’une bonne loi ne pourrait pas désarmer les citoyens. Le troisième précise que sauf cas très exceptionnel, le respect de la propriété privée sera absolu. Allez lire le texte, vous verrez qu’il réellement costaud. Les législateurs et hommes de pouvoirs ne peuvent pas faire taire les gens, les désarmer, les exproprier arbitrairement, etc. Ils essayent, mais les citoyens américains sont protégés par leur Constitution.
Liberté d’expression
Dans ce billet, je voulais partager mes interrogations et recherches sur la liberté d’expression (le 1er amendement américain), car elle est bien menacée. Pour en savoir plus sur la liberté d’expression, vous pouvez aller lire l’excellent article de la Stanford University. Les récents évènements en Angleterre le montrent : on y laisse des hordes armées circuler en ville pour terroriser tout le monde en appelant au meurtre, mais on peut emprisonner un citoyen pour ses propos sur les réseaux sociaux.
J’ai déjà rappelé ailleurs la magnifique démonstration de John Stuart Mill concernant la nécessité de la liberté d’expression.
Philippe Nemo a raison bien sûr, quand il dit qu’il faut abolir les lois de censures en France. Mais est-ce suffisant ? Je ne le crois pas.
Constitution Française
Dans notre Constitution, la liberté d’expression n’est mentionnée nulle part. Un petit peu dans l’article 4 (« La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation »), mais le terme « équitable » laisse la porte ouverte à toutes les dérives. Le 1er amendement est beaucoup plus clair et radical :
Le Congrès n’adoptera aucune loi relative à l’établissement d’une religion, ou à l’interdiction de son libre exercice ; ou pour limiter la liberté d’expression, de la presse ou le droit des citoyens de se réunir pacifiquement ou d’adresser au Gouvernement des pétitions pour obtenir réparations des torts subis.
Il faut aller chercher dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (à laquelle il est fait référence dans le préambule).
Article 10
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
Article 11
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
L’article 11 pourrait sembler donner les mêmes garanties que le 1er amendement US, mais ce n’est pas le cas : il suffit qu’une loi (telles que celles dont l’abrogation est demandée par Nemo) délimite des cas où la liberté d’opinion n’est plus la bienvenue (selon qui ? pour quelles raisons ?) pour faire taire les gens. Un article de Constitution qui laisse la loi venir changer son sens n’est pas très solide. C’est d’ailleurs le cas en France, puisque des juges politisés autorisent et voient comme recevables des plaintes qui sont de véritables tentatives de censures. Qu’est-ce qui garantit la liberté d’expression en France ? Pas grand-chose. Pour une part de notre attachement culturel à ce principe, mais il faut regarder les choses en face : les gauchistes au pouvoir, y compris au Conseil Constitutionnel (voire la sortie de Fabius au moment de la dernière présidentielle), n’ont aucune espèce d’envie de laisser parler leurs opposants. On peut voir les attaques contre Cnews, C8, L’incorrect (pour des unes, par leur banque), et les dissolutions d’associations identitaires diverses comme autant d’exemples de cette réduction lente, mais sûre, de la liberté d’expression.
Constitution Anglaise
La situation est beaucoup plus complexe en Angleterre, car leur système de règles est un mélange de règles coutumières, de droit positif contenu dans plusieurs documents différents : Magna Carta, Habeas Corpus, Bill of Rights, différents Acts). Mais ce qu’on peut y voir n’incite pas à l’optimisme : il n’y a pas de droit formel à la liberté d’expression, celle-ci reposant principalement sur la « common law » (droit coutumier ou jurisprudence). Quand la culture change, le « droit coutumier » aussi. C’est tout l’intérêt d’une Constitution : elle ancre de manière formelle des choses qui sont rendues plus difficiles à faire bouger. Pour l’Angleterre, du coup, c’est l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui joue, et c’est la même que celle de la Déclaration des droits de l’Homme. Depuis plusieurs années déjà, la police de la pensée veille au grain multiculturaliste en Angleterre.
Pour un 1er amendement à la Française
Il me semble clair qu’il faut absolument réintégrer dans notre Constitution un article identique à celui de la Constitution Américaine : un article interdisant aux législateurs, politiciens, hommes du pouvoir, de restreindre la liberté d’expression et d’opinions. Sans conditions. Sans cela, nous suivrons le même chemin que l’Angleterre.