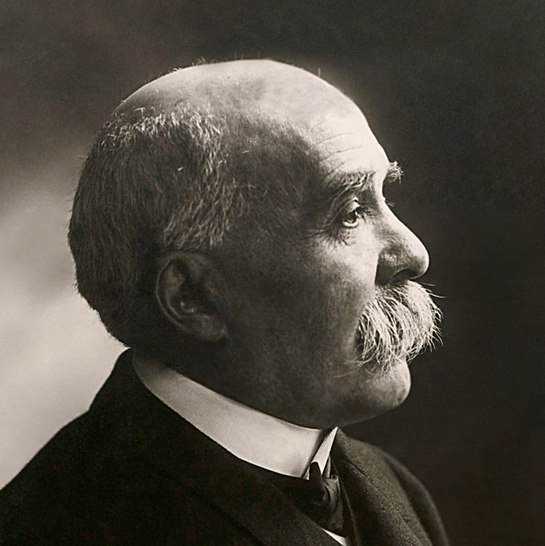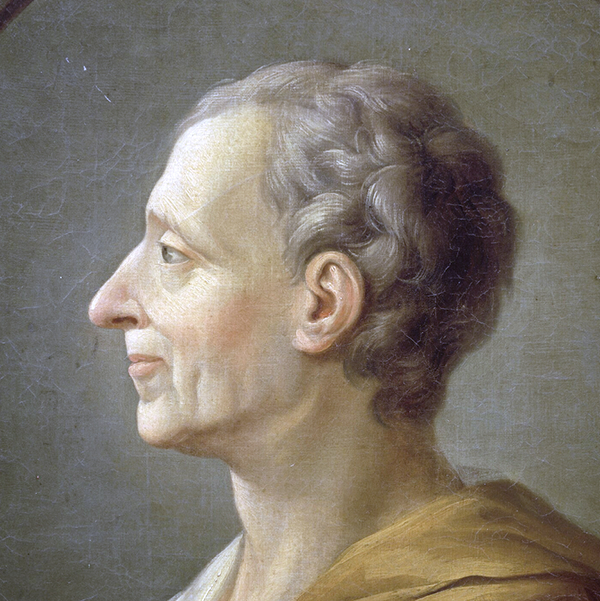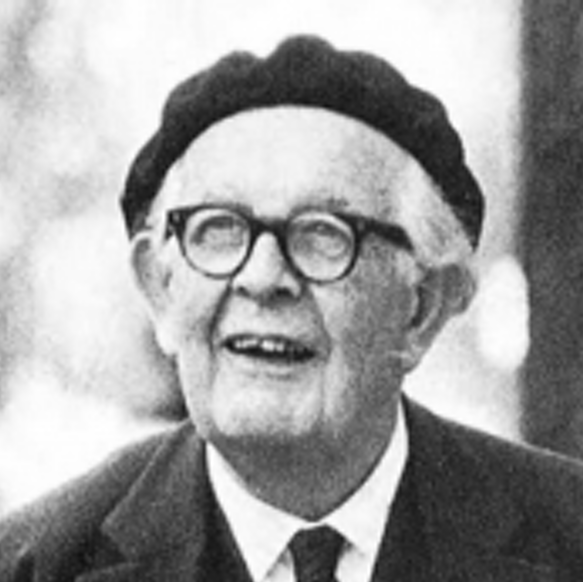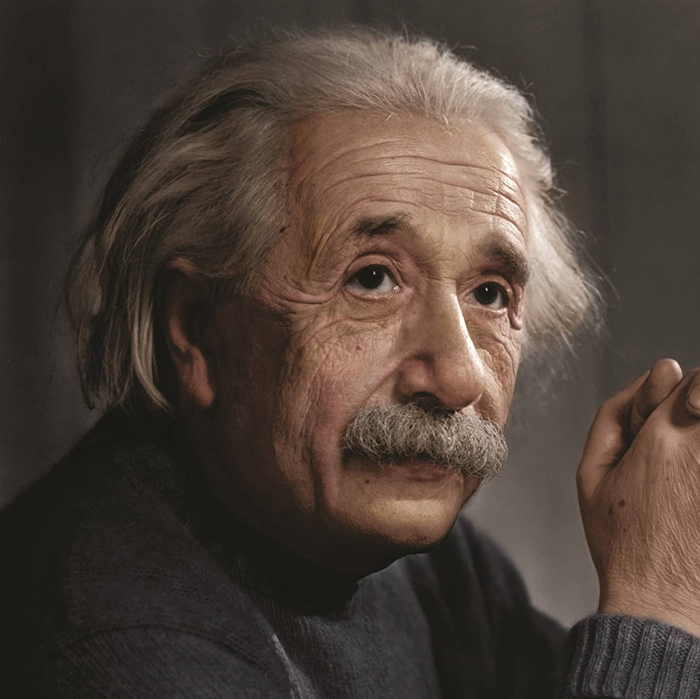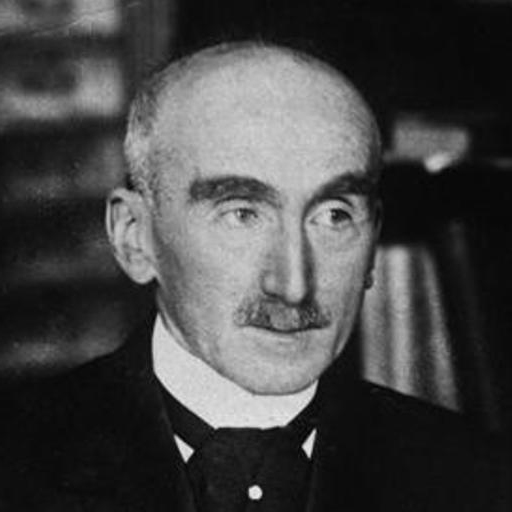J’ai terminé la semaine dernière le Manifeste des Alter-libéraux. Il s’agit du programme pour les présidentielles et les législatives du parti Alternative Libérale. Les auteurs sont Edouard Fillias, Sabine Hérold , Aurélien Veron, Jean-Paul Oury et Ludovic Lassauce.
Ce petit livre, facile à lire, est une bouffée d’air frais pour la pensée sclérosée par l’uniformité du discours français gauchisant et adorateur de l’Etat providence. L’auteur principal (et malheureux candidat à la candidature pour l’élection présidentielle) livre un discours cohérent, vif et jeune. Beaucoup de propositions de bon sens : j’ai trouvé cette lecture très agréable. L’originalité : le parti-pris est celui de la liberté individuelle à tous les étages. Le livre est plus un éloge de la liberté dans tous les domaines, qu’un plaidoyer pour le libéralisme économique. Ce qui rend le discours plus recevable par l’opinion publique, et même temps lui enlève de sa portée politique. Ce qui se retrouve, à mon avis, dans la prise de position pour soutenir Bayrou, alors même que les idées d’Alternative Libérale sont beaucoup plus proches de Nicolas Sarkozy. Ce choix restera à mon avis une erreur politique historique pour ce mouvement.
Le liberalisme doit devenir transversal
Pour finir, je trouve que ce parti souffre du même défaut que les mouvements écologistes. Sa force est à la fois sa faiblesse. L’écologie met la survie de la planète en priorité numéro un : c’est sa force (parce qu’effectivement tout dépend de cela : quelle société si la planète n’existe plus ?) et sa faiblesse (quelle politique pourrait se passer d’intégrer l’écologie dans ses actions : c’est le développement durable, et on voit que l’écologie est fondamentalement quelque chose de transversal). De même, le libéralisme met la défense des libertés individuelles en priorité numéro un : c’est sa force (quelle société peut être souhaitable si ses membres ne sont pas libres?) et sa faiblesse (la liberté doit être un fondement pour toute démocratie, et par là -même elle est aussi transversale et ne peut pas être la propriété d’un parti, mais doit être une sorte de préalable à tout discours politique). La vraie démarche aurait consisté à faire ce que Nicolas Hulot a fait pour l’écologie : faire signer un « pacte libéral » à tous les candidats. Encore aurait-il fallu pour cela que les médias soient aussi réceptifs au discours du libéralisme qu’à celui de l’écologie. Le chemin est encore long…
A lire donc, pour redonner aux idées politiques cette composante indispensable sur le plan philosophique – la liberté individuelle – , bien que vouée, à mon sens, à être intégrée pleinement par tous les partis raisonnables et amoureux de la liberté.