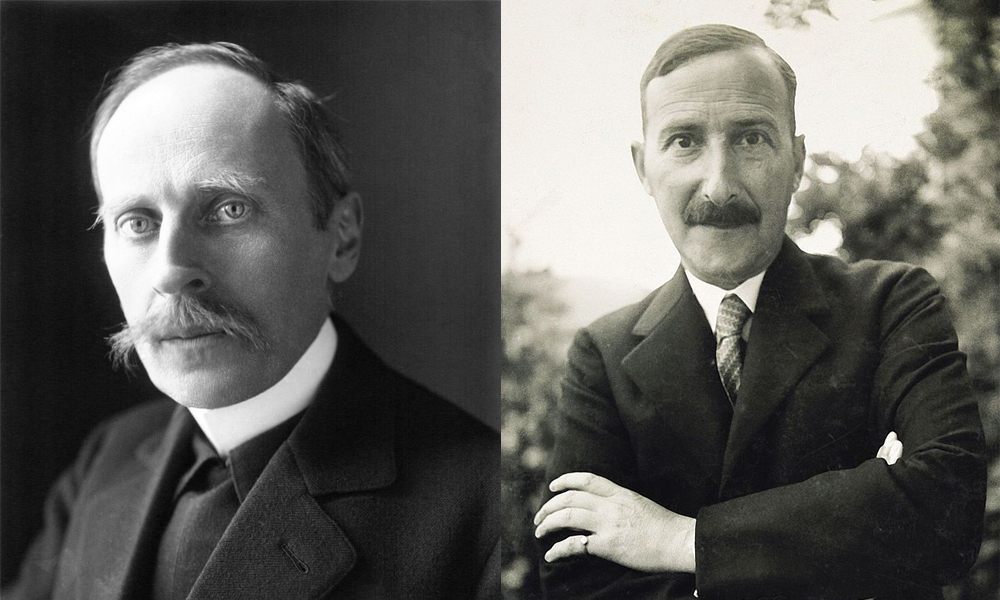Je suis en ce moment d’humeur sombre. Je pensais que l’expression « toucher le fond » portait en elle une forme d’espoir, puisqu’arrivés au fond, on peut s’appuyer dessus pour rebondir, repartir vers le haut. Ce que les dirigeants européens et français nous démontrent depuis des décennies, c’est qu’il n’y a pas de fond. Rien n’y fait : les chocs répétés avec le réel ne les fait pas bouger d’un iota. Ils continuent avec arrogance à étaler leur incompétence, leur idéologie, et leur totale absence d’intérêt pour les peuples de leurs différents pays. A persévérer dans l’erreur.
Errare humanum est. Perseverare diabolicum.
Certes, on peut se réconforter en se disant que les peuples ont élus dans plusieurs pays européens des dirigeants un peu moins pervers, et que le mouvement enclenché aux USA va avoir des conséquences positives sur les lignes en Europe.
Mais force est de constater que plus les US montrent le chemin et plus les dirigeants européens s’enfoncent. Il y a là un spectacle particulièrement difficile à supporter. Macron continue à faire de pitoyables représentations théâtrales, pendant que son sinistre de l’économie, l’affreux communiste Lombard, explique qu’il faut continuer à saborder notre économie, voler l’épargne des français, et que nous allons sauver la planète. Rien que d’écrire cela, et j’en ai des frissons de dégoût : qu’avons-nous fait pour avoir à des postes ministériels de tels abrutis incultes ?
Les médias mainstream comme on les appelle (mais que l’on devrait plutôt renommer les raconteurs d’histoires) continuent leur sordide jeu de désinformation systématique. L’excitation atteint son comble sur 3 minutes d’un échange avec Zelensky et Trump/Vance : qui est allé regarder l’échange en entier ? Est-ce vraiment le sujet principal pour les Européens par ailleurs : quel média est allé montrer et expliquer ce qui se passe en Roumanie (pour le coup, en Europe) ? Le refus de démocratie est à son comble, la tentation censoriale est plus que jamais présente parmi les élites paniquées, et rien ne semble indiquer que le peuple soit intéressé par ces sujets. Les indignations sélectives, pilotées par le pouvoir, sont de plus en plus incroyables (au sens propre du terme), et sont pourtant reprises en boucle. Orwell n’est pas loin du tout : « on empêche les élections de se tenir en Roumanie, c’est pour le bien de la démocratie », « on continue à pomper tout le fric qu’on peut sans jamais arrêter de dépenser, c’est pour la prospérité ». « on va tout faire pour continuer à alimenter la guerre avec la Russie, c’est pour la paix ». « l’immigration musulmane massive depuis quarante ans n’a aucun lien avec les violences en hausse en France ». Sincèrement ?
Le sentiment d’une chute inarrêtable est permanent. Le RN est incapable de jouer un vrai rôle d’opposition : soumis à la gauche intellectuelle. Si vous avez sur vous un peu d’espoir, je suis preneur. Je n’ai plus beaucoup d’échantillons sur moi. Je songe sérieusement à ce qu’il faudrait de plus pour me décider à quitter ce si beau pays en train de sombrer, sans jamais toucher le fond. Quarante ans de socialisme auront-ils eu raison de nous ?