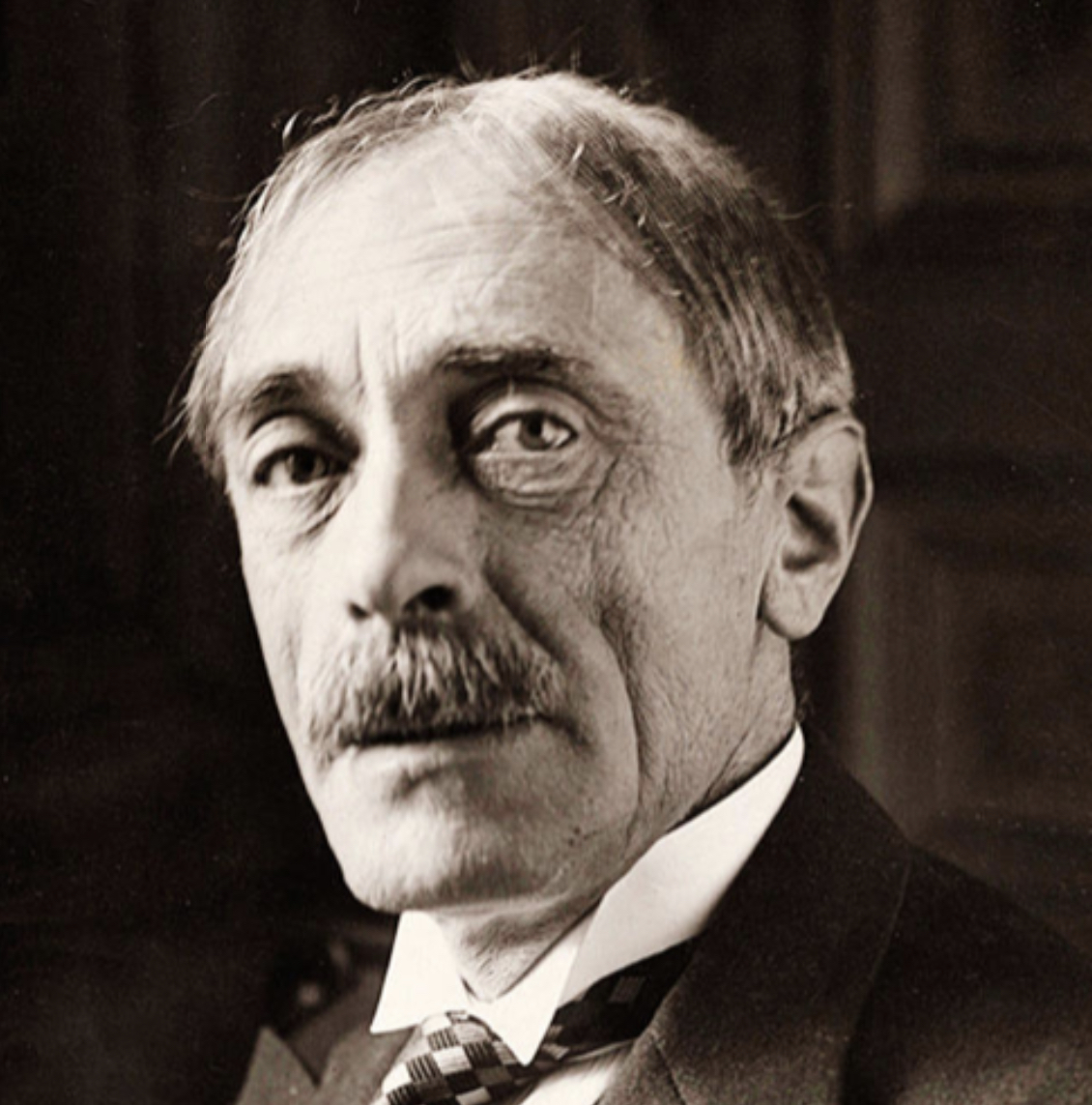Radical ou arbitraire ? Individualiste ou collectiviste ? J’ai pensé pendant longtemps que ce qui rendait sympathique le collectivisme, c’était une forme de pragmatisme non radical, qui serait venu contrebalancer ses aspects par ailleurs exécrables (principalement l’acceptation de l’arbitraire). Il n’en est rien : les collectivistes sont tout aussi radicaux que les libéraux ; ils partent simplement d’un principe qui n’est pas le même. Mais ils le suivent, et l’appliquent de manière radicale. La différence, c’est que leur principe de départ est injuste, et sans signification objective.
Radical ou arbitraire ?
Une vraie interrogation qui se pose, lorsqu’on se plonge dans la pensée libérale, est qu’elle part d’un principe fondateur juste (refus de la contrainte, respect absolu de la liberté individuelle dans le cadre de la loi), et qu’elle en tire toute les conséquences. Jusqu’au bout. C’est ce qu’on appelle être radicalLe dictionnaire donne plusieurs sens à radical. Entre autres, en philosophie, « Qui va jusqu’au bout de chacune des conséquences impliquées par le choix initial », « Attitude qui refuse tout compromis en allant jusqu’au bout de la logique de ses convictions » et « Doctrine réformiste fondée sur l’attachement à la démocratie, à la propriété privée, à la laïcité de l’enseignement » ; si la radicalité est une forme de cohérence dans la pensée, elle peut aussi être une forme de dogmatisme. Et je déteste le dogmatisme.
Comme par ailleurs, les doctrines non-libérales (constructivistes) acceptent dans leurs gènes une part d’arbitraire, j’étais dans pris dans cette espèce de dilemme, à savoir choisir entre « radicalisme » et « arbitraire ».
Hier soir, j’ai compris que cette alternative est une fausse alternative.
Tout le monde est radical
Pris sous l’angle philosophique, radical signifie « qui va jusqu’au bout des conséquences impliquées par le choix initial ». Ce n’est qu’une forme de cohérence idéologique, et finalement d’amour de la vérité. Si je pars d’un principe vrai, alors je dois le dérouler proprement. Soit quelque chose est vrai, soit quelque chose est faux.
En enlevant la connotation péjorative du mot « radical », on se rend compte que à la fois les libéraux, et à la fois les constructivistes / utilitaristes sont radicaux. Ils déroulent logiquement (et c’est heureux) des idées politiques issues de principes fondateurs différents.
Le principe fondateur du libéralisme, Si on cherche à « construire » une société meilleure, il vient toujours un moment où l’on va empiéter sur la liberté et la propriété de certains, pour favoriser d’autres. Ce que le libéralisme rejette, justement…c’est le respect des individus, et le refus de la contrainte. Aucun individu ne doit avoir le droit de forcer un autre à faire ce qu’il ne veut pas. C’est simple, et il parait évident que si ce principe était respecté partout, il ne pourrait pas y avoir d’injustice. Ce principe est fondamentalement individualiste, et juste – parce que non arbitraire -.
Le principe fondateur du constructivisme, c’est l’idée qu’il faut améliorer le sort des populations, notamment les plus démunis, par des mesures centralisées d’organisations de la société. Les constructivistes partent du principe fort qu’il peut être justifié d’empiéter sur la liberté de certains, pour améliorer le sort des plus On n’a guère le choix qu’entre ces deux radicalismes : nier l’existence d’une justice sociale, ou nier la liberté des individus. J’ai choisi.démunis, et donc pour améliorer une sorte de « bien-être » global, ou d’intérêt général. C’est un principe collectiviste, arbitraire. C’est le pouvoir qui décide, au gré des changements de majorité ou de régime, du sens à donner à tous ces mots abstraits « justice sociale », « bien-être global », etc…Quand le pouvoir est arbitraire, cela signifie que ce n’est plus une norme impartiale (identique pour tous) qui est la règle, mais la volonté d’un homme ou d’un groupeLexilogos donne : Arbitraire (En parlant du pouvoir) : Substitution aux règles de la justice distributive ou aux normes fixes et impartiales de la loi, de la volonté variable et intéressée d’un homme ou d’un groupe. Synonyme : despotisme].
Contrairement à ce que je pensais, ce côté arbitraire du constructivisme n’est pas le pendant du radicalisme libéral ; car les constructivistes sont radicaux aussi. Il y a simplement un radicalisme individualiste, qui place le triptyque « liberté individuelle-responsabilité-propriété » au-dessus de tout, et un radicalisme constructiviste, qui place la « justice sociale », ou l’ »intérêt général » au-dessus de tout.
Là où les libéraux voudraient que l’utilisation de la force soit strictement réservé à l’application de la loi, et donc également à réprimer toute forme de contrainte et de restriction des libertés, les collectivistes pensent qu’il est justifié de contraindre certains pour donner à d’autres. Un collectiviste ne supporte pas l’idée que quelqu’un puisse vivre dans son coin, sans avoir à participer à un effort collectif, justifié par la « solidarité ». Et il trouvera justifiée l’usage de la force, s’il le faut, pour faire rentrer les récalcitrants dans le jeu collectif. Le libéralisme écrase le collectif au nom de l’individu ; le constructivisme écrase les individus au nom du collectif.
On n’a guère le choix qu’entre ces deux radicalismes. J’ai fait mon choix. Et vous ?