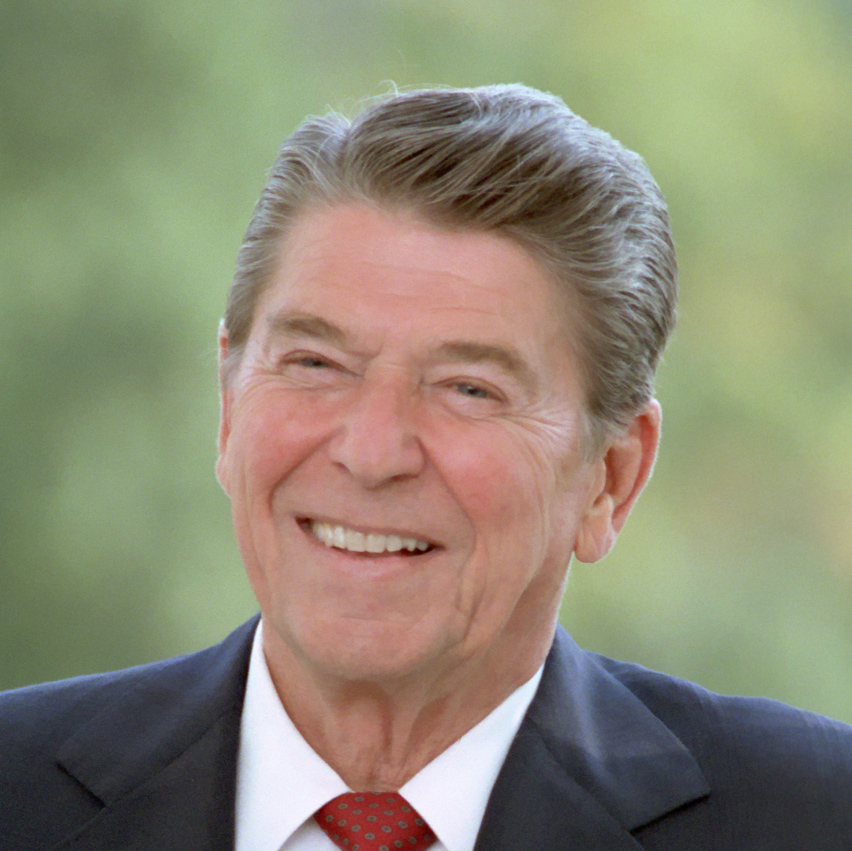Notez bien que la question n’est pas : trouvez-vous indispensable qu’il y ait des médias ? Personne, je crois, ne doute de l’utilité de pouvoir s’informer librement. Pas de médias, pas de liberté d’informer ou de s’informer, ça veut dire dictature. Et pour pouvoir s’informer librement, il faut disposer d’un grand choix et d’une diversité de sources. C’est ce qu’on appelle le pluralisme. Si tous les médias racontent exactement la même chose, alors c’est qu’ils ne parlent plus du réel, et on retourne sur la dictature (c’est le journal du parti). Le réel, et c’est ce sur quoi les gens veulent avoir des informations, s’appréhende au travers de filtres cognitifs, et avec des points de vue particuliers. Il n’y a pas d’information objective.
Non : la question posée ici est de savoir s’il est une bonne ou une mauvaise chose, pour que les médias fassent bien leur travail, de leur donner des subventions. J’ai listé ici des arguments pour ou contre (listes non-exhaustives, que vous pouvez compléter et discuter en commentaire), et un petit test vous permettra de répondre oui ou non à cette question récurrente.
Pour les subventions
- L’activité médiatique d’information, consistant à informer, analyser, enquêter, recouper est beaucoup moins rentable que la diffusion de films ou d’émissions de jeux. Sans soutien, une partie de l’offre d’information disparaitrait et on perdrait en pluralisme
- Face aux géants des autres pays (américains notamment), il convient de soutenir de manière intelligente la production et les activités médiatiques françaises, notamment théâtre et cinéma. C’est la fameuse exception culturelle. La « culture » n’est pas un bien comme un autre.
- En ne subventionnant pas la presse et les médias, ils seront à la merci de grands groupes capitalistes, qui pourront faire pression en fonction de leurs intérêts sur les « bonnes » et les « mauvaises » informations
Contre les subventions
- Les subventions maintiennent sous perfusion des médias sans aucun lectorat, ou spectateurs. L’argent pris pour les soutenir est de l’argent qui n’est plus disponible pour d’autres activités (y compris la création d’autres médias, plus rentables). Un média qui réussit, c’est un média qui sait trouver des clients, dans un milieu concurrentiel, et être rentable. Au nom de quoi serait-ce une entreprise pas comme les autres ? Par ailleurs, les subventions sont accordées de manière plus ou moins arbitraires aux différents médias
- Il y a plein de métiers différents dans le monde des médias (création, production, diffusion, etc.) : Aucun de ces secteurs d’activité ne fait parti des fonctions régaliennes de l’Etat.La culture, l’information, dans un pays libre, n’a rien à faire dans le giron de l’Etat. C’est dans les dictatures, justement, que ces activités sont liées à l’Etat
- S’il fallait soutenir un secteur avec des subventions parce qu’y réussir est difficile, alors il faudrait soutenir l’ensemble des secteurs, ce qui implique des subventions dans toutes les activités, avec une armée de fonctionnaires pour gérer tout cela au moins mal.
Petit sondage
[yop_poll id= »1″]