Alors que Sanofi-Aventis
s’est vu refuser son nouveau médicament (l’Acomplia, ou Zimulti aux USA) contre l’obésité par la Food&Drug Admnistration aux USA, le jeu économique est rude pour le groupe pharmaceutique. Visiblement, cet échec va lui faire perdre son avance sur ses concurents américains (Pfizer notamment). Le médicament en question semble avoir des effets secondaires psychiques importants (pensées suicidaires..).
Alors que l’obésité progresse (aux USA comme en France), on en vient donc à inventer des médicaments contre l’obésité. Plutôt que de prévenir l’obésité, par la nutrition, par la sensibilisation aux comportements addictifs que la nourriture peut provoquer, par la pratique régulière d’un exercice corporel, on va fabriquer des pillules pour aider les obèses à maigrir. Je ne connais pas les mécanismes exacts de ce médicament mais, visiblement il bloque des récepteurs spécifiques présents dans le cerveau, les tissus adipeux et le foie, et le médicament joue donc sur le métabolisme du glucose et des lipides, c’est-à -dire sur la façon dont le corps utilise ou stocke les sucres et le graisses, et sur la sensation de satiété.
On va donc pouvoir bouffer comme des gorets, car une pillule magique viendra modifier la manière dont notre corps va stocker tout ça. Bouffons du sucre et de la graisse !
Et puis les effets secondaires semblent liés à une augmentation des pensées suicidaires chez les utilisateurs. Mais ça ne change pas grand chose : l’obésité n’est-elle pas une forme de suicide à la bouffe, comme la cigarette peut l’être avec la nicotine et les goudrons. Dormons tranquilles, la pharmacie veille sur notre bien-être ! Ne perdons pas trop de temps à réflechir au mal-vivre qui cause l’obésité, puisque nous saurons bientôt en soigner les symptômes.
Étiquette : Vie
-
Pensée du matin : le meilleur des mondes n’est pas loin !
-

L’esprit de l’athéisme
Je viens de terminer « L’esprit de l’athéisme« , de Comte-Sponville. C’est Max qui me l’avait offert Noël. Super cadeau ! C’est un livre court, dense et plein de raison, comme d’habitude avec Comte-Sponville.
Le livre est découpé en trois parties, chacune avec un titre sous forme de question :
- Peut-on se passer de religion ? Voilà le paragraphe de conclusion du chapitre :
Résumons-nous. On peut se passer de religion ; mais pas de communion, ni de fidélité, ni d’amour. Ce qui nous unit, ici, est plus important que ce qui nous sépare. Paix à tous, croyants et incroyants. La vie est plus précieuse que la religion (c’est ce qui donne tort aux inquisiteurs et aux bourreaux) ; la communion, plus précieuse que les Eglises (c’est ce qui donne tort aux sectaires) ; la fidélité, plus précieuse que la foi ou que l’athéisme (c’est ce qui donne tort aux nihilistes aussi bien qu’aux fanatiques) ; enfin – c’est ce qui donne raison aux braves gens, croyants ou non – l’amour est plus précieux que l’espérance ou que le désespoir. N’attendons pas d’être sauvés pour être humains. - Dieu existe-t-il ? Dans ce deuxième chapitre, sont passées en revues les trois « preuves » historiques de l’existence de Dieu, et Comte-sponville y ajoute trois raisons pour lui importantes qui le confortent dans sa non-croyance. Un passage de la conclusion de ce chapitre :
Dieu existe-t-il ? Nous ne le savons pas. Nous ne le saurons jamais, en tout cas dans cette vie. C’est pourquoi la question se pose d’y croire ou non. Le lecteur sait maintenant pourquoi, pour ma part, je n’y crois pas : d’abord parce qu’aucun argument ne prouve son existence; ensuite parce qu’aucune expérience ne l’atteste; enfin parce que je veux rester fidèle au mystère, face à l’être, et à l’horreur et à la compassion, face au mal, à la miséricorde ou à l’humour, face à la médiocrité (si Dieu nous avait créés à son image et absolument libres, nous serions impardonnables), enfin à la lucidité, face à nos désirs et à nos illusions. Ce sont mes raisons, du moins celles qui me touchent ou me convainquent le plus. Il va de soi que je ne prétends les imposer à quiconque. Il me suffit de revendiquer le droit de les énoncer publiquement, et de les soumettre, comme il convient à la discussion. […] La religion est un droit. L’irréligion aussi. Il faut donc les protéger l’une et l’autre (voire l’une contre l’autre, si c’est nécessaire), en leur interdisant à toutes deux de s’imposer par la force. C’est ce qu’on appelle la laïcité, et le plus précieux héritage des Lumières. On en redécouvre aujourd’hui toute la fragilité. Raison de plus pour le défendre, contre tout intégrisme, et pour le transmettre à nos enfants. La liberté de l’esprit est le seul bien, peut-être, qui soit plus précieux que la paix. C’est que la paix, sans elle, n’est que servitude. - Quelle spiritualité pour les athées ? Ce dernier chapitre expose la spiritualité selon Comte-sponville, toute orientée vers l’action, et la prise de conscience que le seul absolu que nous ayons est celui de l’Etre, vécu plus comme un silence, une sensation que comme une pensée. Il est proche là -dessus des mystiques et des bouddhistes. J’ai un peu plus de mal à le suivre là , même si des passages me touchent beaucoup…
Pour conclure, c’est un superbe livre : un appel à la raison, au doute, à la discussion et à la spiritualité. Message rare par les temps qui courent. Pour donner un petit bémol, qui n’est que personnel : j’aborde la question de l’absolu différemment de Comte-sponville. Il le cherche malgré tout dans le mystère de l’être ; il ne veut pas s’en séparer complètement. Personnellement, et c’est certainement mon caractère qui parle, l’absolu me semble une notion pas forcément utile pour vivre. Je me sens plus proche en cela de Montaigne.
Enfin, tout au long des pages, Comte-Sponville illustre ses pensées de plein de citations excellentes, que j’utiliserais certainement pour mes rituelles « citations du dimanche »… En voilà deux que j’ai bien aimées, et que je trouve profondes…Pour les éveillés, il n’est qu’un seul monde, qui leur est commun; les endormis ont chacun leur monde propre, où ils ne cessent de se retourner.
HéracliteSi l’on entend par éternité non la durée infinie mais l’intemporalité, alors il a la vie éternelle celui qui vit dans le présent.
WittgensteinSi ces questions de spiritualité, de Dieu, de mystère vous intéresse, alors n’hésitez pas : ce livre est une mine de réflexion passionnantes.
- Peut-on se passer de religion ? Voilà le paragraphe de conclusion du chapitre :
-
Eloge de la simplicité
Complexité du monde, nécessaire simplicité
Le monde est extraordinairement complexe. Les humains sont extraordinairement complexes. Vouloir appréhender le monde nécessite d’intégrer une certaine complexité. On ne peut évidemment pas résumer le monde entier et la condition humaine en une phrase. Mais pour qui veut une certaine efficacité dans l’action, il est nécessaire de savoir simplifier. Simplifier, c’est viser la simplicité, et non pas oublier la complexité.
La simplicité n’a pas besoin d’être simple, mais du complexe resserré et synthétisé.
[Alfred Jarry]Simplifier ce qui ne l’est pas : mariage de notre vérité et du monde
Tout le travail de la connaissance — scientifique ou non — est de simplifier. Le monde n’est pas plus simple parce qu’on opère des simplifications, c’est notre vision qui en est modifiée. La simplicité ne peut exister que pour un être pensant.
Il n’y a pas de simplicité véritable. Il n’y a que des simplifications.
[Léon-Paul Fargue]La simplicité n’est donc pas un état du monde (puisqu’il est complexe), mais donc un travail à accomplir.
La simplicité est en définitive très difficile à atteindre. Elle repose sur l’attention, la pensée, le savoir et la patience.
[John Pawson]Comme tout travail, il n’a pas de fin. Et comme tout travail bien mené, il est source de bonheur. C’est parce que le monde est complexe, difficile, tourmenté, que nous devons essayer de le penser simplement. C’est une voie de sagesse, à mon avis. Vouloir faire coller sa vérité avec la complexité du monde en compliquant sa vérité est une erreur. Au contraire, il faut choisir, et simplifier la complexité de notre conception du monde.
L’homme devrait mettre autant d’ardeur à simplifier sa vie qu’il en met à la compliquer.
[Henri Bergson]L’art de vivre pleinement ne consiste pas tant à compliquer les choses simples qu’à simplifier celles qui ne le sont pas.
[François Hertel]Sagesse de la liberté et du choix
Alors, bien sûr, choisir la simplicité implique d’exclure des choses. Cela implique de savoir faire le deuil des branches multiples pour conserver les plus solides. La jeunesse accueille plus facilement la complexité du monde sans trancher. C’est quelque chose que l’on apprend en vieillissant, parce qu’on se construit en faisant des choix :
Vieillir c’est simplifier.
[Daniel Thibault]Chance et volonté de simplicité : clef du bonheur ?
Viser la simplicité est un chemin de bonheur : et comme le bonheur, c’est exigeant mais indispensable. C’est la seule manière de marier notre vérité à la réalité du monde.
Rencontrer quelqu’un avec qui la vie est simple, c’est peut-être la plus belle chose qui puisse arriver. C’est ce qui m’est arrivé avec Ben’. Chance de la rencontre, et désir réciproque de simplicité dans les relations.Il y a quelques rencontres dans la vie où la vérité et la simplicité sont le meilleur manège du monde.
[Jean de La Bruyère] -
Etes-vous vertueux : les quatre vertus cardinales
Il y a un mois, un gars dans une formation a évoqué – pour illustrer son propos – les 4 vertus cardinales. Comme je n’aime pas trop rester dans l’ignorance, je suis allé chercher ce que c’est, et je vous livre le résultat de mes recherches.
Tout d’abord, qu’est-ce qu’une vertu ?Vertu : Disposition habituelle, comportement permanent, force avec laquelle l’individu se porte volontairement vers le bien, vers son devoir, se conforme à un idéal moral, religieux, en dépit des obstacles qu’il rencontre.
Beau programme, n’est-ce pas ? Cela donne envie d’être vertueux…
Les quatre vertus cardinales sont les suivantes : Prudence, tempérance, force et justice. Le christianisme considère qu’elles jouent un rôle central (cardinale vient de « cardo », qui signifie = charnière, pivot) dans l’action humaine, et pour le comportement des hommes entre eux. Elles sont issues de l’antiquité (Platon, Aristote, philosophes stoïciens). Voilà les définitions que l’on peut trouver sur Wikipédia et Lexilogos, assorties de quelques citations piochées sur Evene. Je ne suis l’auteur de rien dans cet article, ce ne sont que des copiés-collés, mais ces définitions donnent à réfléchir, je trouve. Et permettent de se poser les questions : suis-je vertueux ? La vertu est-elle un idéal à viser ou non ?Prudence
La prudence dispose la raison pratique à discerner en toute circonstance le véritable bien et à choisir les justes moyens de l’accomplir.
Définitions :- Première vertu cardinale, celle qui allie force d’esprit, faculté de discernement, connaissance de la vérité dans la conduite de la vie.
- Qualité, attitude d’esprit de celui qui prévoit, calcule les conséquences d’une situation, d’une action qui pourraient être fâcheuses ou dangereuses moralement ou matériellement, et qui règle sa conduite de façon à les éviter
La prudence ne prévient pas tous les malheurs, mais le défaut de prudence ne manque jamais de les attirer.
[Proverbe espagnol]Tempérance
La tempérance assure la maîtrise de la volonté sur les instincts et maintient les désirs dans les limites de l’honnêteté, procurant l’équilibre dans l’usage des biens.
Définition :
Modération, sobritété, retenue, mesureLa tempérance est un arbre qui a pour racine le contentement de peu, et pour fruits le calme et la paix.
[Ferdinand Denis]Force
La force, c’est-à -dire le courage, assure dans les difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite du bien, affermissant la résolution de résister aux tentations et de surmonter les obstacles dans la vie morale.
Définition :
Ensemble des ressources physiques, morales ou intellectuelles qui permettent à une personne de s’imposer ou de réagir.C’est la force et la liberté qui font les excellents hommes. La faiblesse et l’esclavage n’ont fait jamais que des méchants.
[Jean-Jacques Rousseau]Justice
La justice consiste dans la constante et ferme volonté de donner à chacun ce qui lui est dû.
Définition :
Principe moral impliquant la conformité de la rétribution avec le mérite, le respect de ce qui est conforme au droit.L’injustice ne se trouve jamais dans les droits inégaux, elle se trouve dans la prétention à des droits égaux.
[Friedrich Nietzsche]Bien sûr, personne n’est à la fois prudent, fort, juste et faisant preuve de tempérance ; mais on doit essayer d’y tendre, non ?
Rappelons que les vertus sont des attitudes fermes, des dispositions stables, des perfections habituelles de l’intelligence et de la volonté qui règlent les actes, ordonnent les passions et guident la conduite.
Elles procurent facilité, maîtrise et joie pour mener une vie moralement bonne. L’homme vertueux, c’est celui qui librement pratique le bien.
Sources :- Evene, pour les citations
- Lexilogos, pour les définitions
- L’article sur les vertus cardinales de Wikipédia, pour le texte
-
Citation #1

Je veux que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d’elle, et encore plus de mon jardin imparfait.
Michel Eyquem de Montaigne (1533 – 1592) philosophe, humaniste et moraliste français de la Renaissance
-
Quelques citations en équilibre
Tout est question d’équilibre dans notre vie et dans notre action, en tout cas pour ceux qui veulent vivre en vérité. L’organisme même est un équilibre complexe, interne et avec son milieu. La recherche de l’équilibre est une donnée physiologique, et donc psychologique. Tendre vers l’équilibre est une caractéristique humaine :
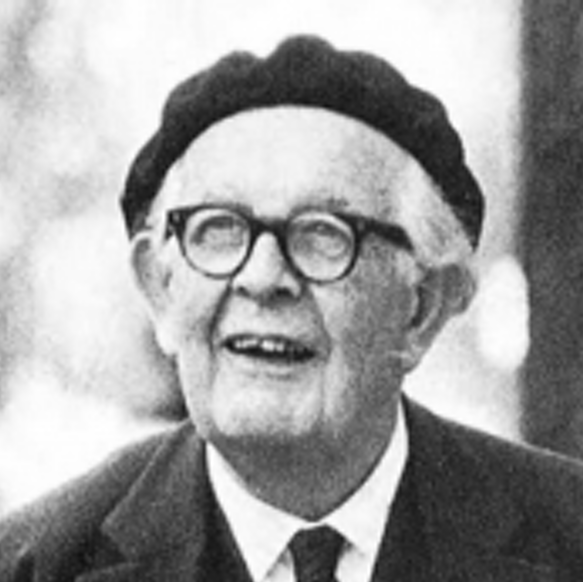
La tendance la plus profonde de toute activité humaine est la marche vers l’équilibre.
Jean Piaget (1896 – 1980) biologiste, psychologue, logicien et épistémologue suisse
Il faut toujours se garder des extrêmes, qu’ils soient en pensée ou en comportement. C’est ce qu’on appelle la tempérance :

Tout ce qui est excessif est insignifiant.
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754 – 1838) Homme d’Etat et diplomate français
Il convient donc toujours de chercher à équilibrer les contraires, et les contraintes. Ce qui revient souvent à identifier les extrêmes, et à chercher entre les deux la voie d’action équilibrée. C’est être pragmatique, plutôt que dogmatique.
Equilibrer le temps consacré aux choses, équilibrer les pensées contradictoires qui nous peuvent nous assaillir, équilibrer les sentiments qui peuvent être complexes.
On passe notre temps à équilibrer les choses, plus ou moins bien, plus ou moins souvent, selon notre caractère.
Au final, c’est une chose qui est paradoxale : si on veut être équilibré en tout, il faut aussi l’être en ce qui concerne l’équilibre. Ne pas être trop équilibré, c’est-à -dire savoir toujours se mettre en déséquilibre, en mouvement. Le paradoxe n’est qu’apparent : il faut équilibrer le temps consacré au jugement, à la réflexion et celui consacré à l’action. Ces deux là semblent d’accord là -dessus :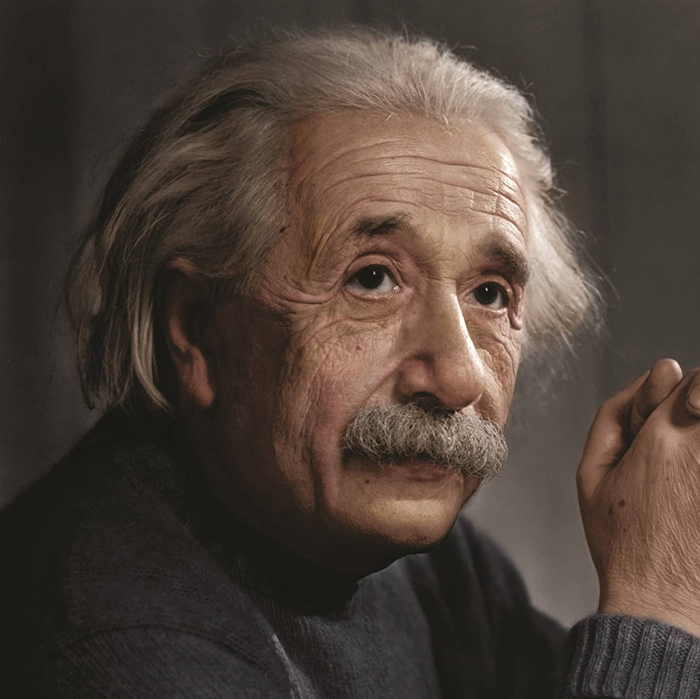
La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre.
Albert Einstein (1879 – 1955) physicien théoricien allemand, puis helvético-américain
et
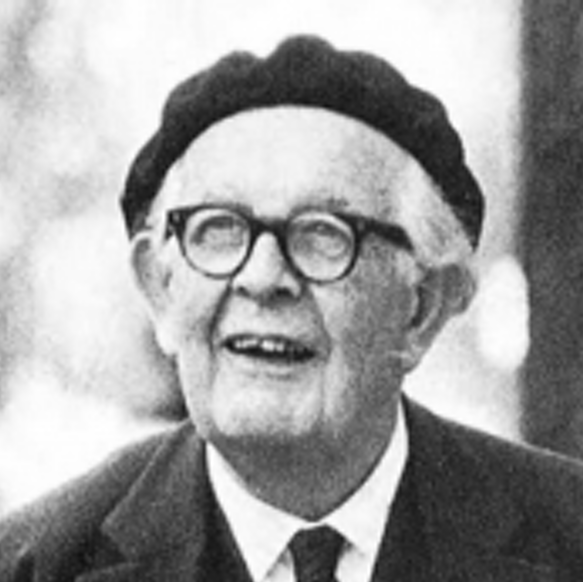
Équilibre est synonyme d’activité.
Jean Piaget (1896 – 1980) biologiste, psychologue, logicien et épistémologue suisse
Dans les faits, cela revient à :
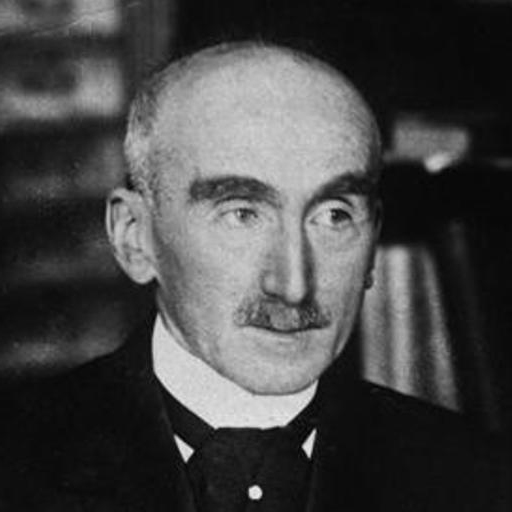
Agir en homme de pensée et penser en homme d’action.
Jean Piaget (1859 – 1941) philosophe français
Source des citations : www.evene.fr et kulture-et-konfiture