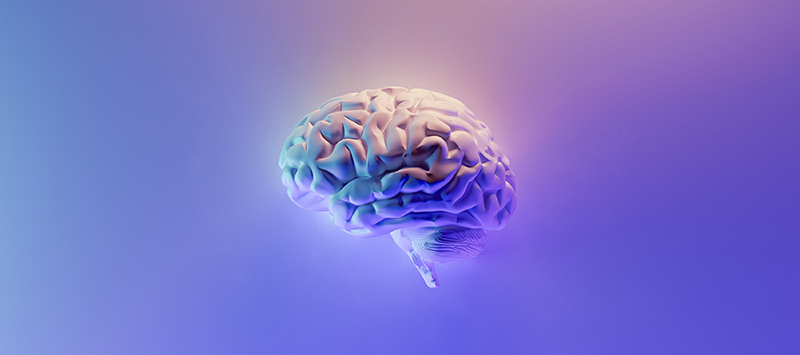Je lis régulièrement les éditos et certains articles de Riposte Laïque. Il me semble qu’il s’agit là d’un site utile, qui permet de sortir du politiquement correct et du regard généralement complaisant posé par les médias sur les extrémismes religieux, musulmans en particulier. C’est, avec Primo-Europe, Point de Bascule Canada ou encore Bivouac-Id, une de mes sources d’informations francophones sur le sujet de l’islamisme, et de sa frontière pas toujours très nette avec l’Islam.
Rétablir l’autorité républicaine
L’edito du n°62, Le système peut dire merci à ceux qui ont cassé, depuis 40 ans, toute autorité républicaine sonne juste sur beaucoup de points. Il y revient, notamment sur la situation extrêmement difficile de beaucoup de professeurs, puis sur celle des policiers :
Et que dire du sort réservé aux policiers ? […] Dans quel pays leur tire-t-on dessus à balles réelles, sans qu’ils ne puissent répliquer ? Dans quel pays garde-t-on systématiquement à vue un policier qui a fait usage de son arme, même quand il a sauvé la vie d’une personne en danger ? A-t-on oublié le traitement subi par ce courageux fonctionnaire qui, en tirant sur un groupe de supporters racistes du Paris-Saint-Germain en train de tabasser des supporters juifs, a sauvé la vie de l’un d’entre eux ? Quand des délinquants volent une voiture, et forcent un barrage, c’est toujours le policier qui fait figure de salaud ! Des sociologues racontent même que s’il y a des violences dans les quartiers, c’est à cause d’eux, et que s’ils restaient dans leur commissariat, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes ! Comment les gouvernements, de droite comme de gauche, ont-ils pu abandonner ainsi ceux qui, bien souvent, sont les derniers remparts contre la loi de la voyoucratie ?
Un dérapage, et des questions…
L’ensemble du texte est plutôt juste, je trouve. Mais la conclusion ne laisse pas de surprendre : sans aucun rapport avec le reste du texte, un petit couplet sur le capitalisme, caricatural et tiré par les cheveux…:
Cela ne peut qu’engendrer une société de désordre, où la loi de la jungle l’emporte sur les lois de la République — qui sont les seules à pouvoir protéger les faibles contre les forts. Le système capitaliste, qui avait besoin de casser toute notion de régulation, ne dira jamais assez merci aux gauchistes et aux compassionnels droits-de-l’hommistes qui ont contribué, par des discours irresponsables assénés depuis quarante ans, à saper les édifices républicains, pour le plus grand bonheur d’une idéologie libérale-libertaire dont l’oeuvre quotidienne est le désastre auquel nous sommes aujourd’hui confrontés.
A tous ses idiots utiles le capitalisme reconnaissant peut dire merci.
En quoi l’idéologie libérale peut-elle être tenue responsable de la perte d’autorité ? Associer libertaire et libéral dans un même anathème, c’est d’ailleurs afficher toute son inculture. En quoi le capitalisme aurait-il besoin de supprimer toute régulation ? Quel manque de lucidité, et quel parti pris honteusement affiché ! Je me pose la question suivante : s’ils sont capables de pondre des réflexions aussi grossières, et aussi orientée politiquement, qu’en est-il de leur sens critique au moment de traiter l’information sur les sujets de laïcité, et de religions ?
Alors, c’est sûr, je continuerai à lire Riposte Laïque. Mais avec en tête, désormais, un peu plus d’esprit critique, et comme une méfiance. Leur mode de raisonnement, pour des gens qui passent leur temps à taper sur les religions, me semble dangereusement proche, sur certains sujets, du mode « incantatoire » généralement associé à ces mêmes religions…