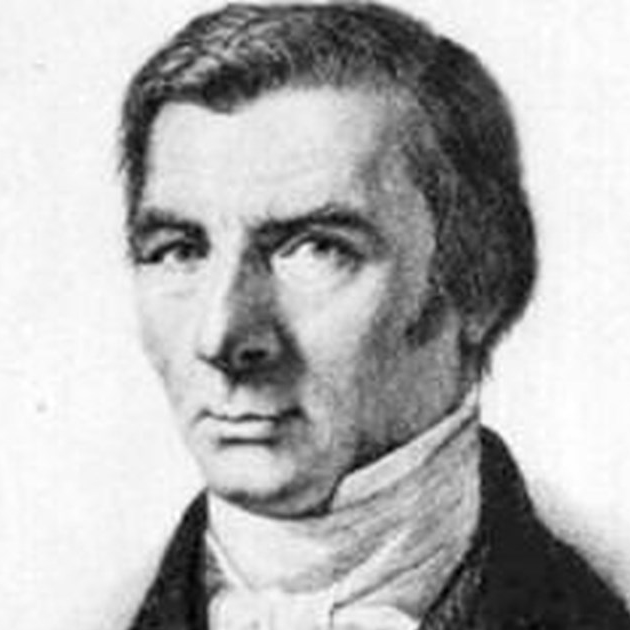Ily a des matins, où la manière dont sont traités les infos par les journalistes, et la manière dont sont traités les problèmes par les politiciens, donnent un sentiment de bataille perdue d’avance, de gâchis et de mission impossible. Et puis, heureusement, des textes lus à droite à gauche me permettent de voir que je ne suis pas seul. A trouver l’intervention omniprésente de l’Etat déprimante, alarmante même. A trouver le niveau d’éducation de mes concitoyens tout aussi alarmant. Aujourd’hui, c’est la tribune de Guy Sorman que j’aurais aimé écrire. A défaut d’avoir son talent et sa compétence, je vous la recopie ici.
Les Français, dit on, c’est le lieu commun de la saison, réclameraient « le retour de l’Etat ». Certes, mais chez nous, l’Etat n’est jamais parti : le taux de prélèvement public est parmi les plus élevés en Europe et dans l’OCDE, supérieur à 50%. Par ailleurs, ce taux n’a cessé de monter depuis 1981, de même que le nombre des fonctionnaires. Ceci sous les gouvernements de droite comme de gauche. Nos banques sont étroitement contrôlées, l’Etat a partout des participations industrielles, le Code du travail est le plus protecteur des salariés en Europe, le Code des impôts est le plus indéchiffrable, l’impôt sur la fortune c’est Français (demandez à Johnny[1. ou à
John Malkovich…]), etc.. L’information est aussi sous l’autorité de l’Etat et va l’être plus encore avec la désignation du président de la télévision publique par le chef de l’Etat (du Poutinisme audiovisuel). L’éducation, à tous les niveaux, ne pourrait être plus étatisée dans son organisation et son contenu qu’elle ne l’est déjà . Donc, de quoi parle-t-on ?
On devine, bien entendu, que le Français rêve d’un monde plus prévisible ; mais plus d’Etat serait à l’expérience, moins de croissance, pauvres mais égaux. La grande illusion est tout de même, de croire que l’Etat est plus rationnel et rassurant que le marché : c’est historiquement faux. Le marché fait des bulles mais les Etats font la guerre.
A lire également, La folie injectrice chez Franck Boizard, et Si on apprenait enfin l’économie ?, tribune d’Yves de Kerdrel.