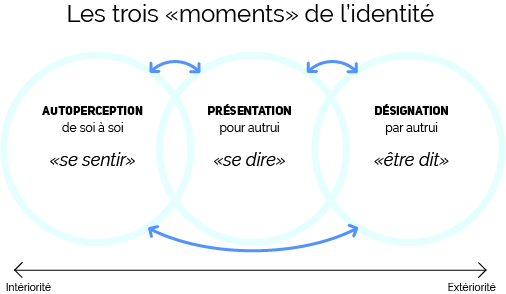J’ai eu la chance d’avoir parmi mes cadeaux d’anniversaire le dernier opus d’Eric Zemmour, Destin français. Avant de rentrer dans la recension du livre, qui est formidable, il me parait nécessaire de dire quelques mots d’Eric Zemmour, tant le personnage soulève de passions.
Esprit libre et sincère
J’aime beaucoup Eric Zemmour, et je suis moins en phase avec ses idées. Je regarde régulièrement l’excellente émission Zemmour & Naulleau, depuis longtemps, et j’ai vu pas mal de ses interventions et conférences (Youtube est ton ami). C’est un homme courtois, direct, qui sait rester au niveau des idées dans les échanges, et qui laisse très rarement les émotions prendre le dessus, malgré la virulence parfois grotesque de ses interlocuteurs à son égard. Il a par ailleurs une grande culture, historique, littéraire, politique, et un vrai goût pour la controverse et le débat d’idées.
Je suis moins en phase avec ses idées, en grande partie parce qu’il revendique une forme de marxisme et d’anti-libéralisme (pas toujours cohérent d’ailleurs). Je suis beaucoup plus en phase avec son amour de la France, et sa vision de ce qu’est l’Occident (c’est à mon avis là que ses idées anti-libérales sont peu cohérentes : l’Occident est une civilisation libérale, dans tous les sens du terme). Les anathèmes réguliers dont il est la cible (y compris sous forme de procès devant les tribunaux) sont injustes, et la plupart du temps ses critiques les plus acerbes ne connaissent ni ses idées, ni ses ouvrages. Il a été étiqueté « néo-réac » par la gauche bien-pensante, et cela suffit à beaucoup pour en faire le parfait bouc-émissaire de leurs petits esprits totalitaires.
Passionnant livre d’Histoire de France
Destin français est un livre formidable et passionnant. C’est le livre d’un passionné d’histoire, de la France, et d’histoire de France. Découpé en chapitre très courts, consacrés chacun à une personnalité – parfois à un monument ou à un film -, il se lit facilement. Il se dévore même. C’est très bien écrit, et la grande culture historique de Zemmour, sans jamais s’étaler, sert à merveille à donner du relief à chaque personnage de cette galerie de portraits, en redonnant des éléments de contexte et de perspectives toujours appropriés.
J’y ai appris énormément de choses, et c’est un livre qui donne vraiment envie d’aller se plonger dans l’étude de l’histoire, et les livres d’histoires. On peut ne partager certaines de ces analyses – c’est mon cas – mais c’est toujours pédagogique, brillant et profond. Et comme tout bon livre d’histoire, il donne de l’épaisseur à notre époque en faisant voir des liens entre elle et certaines de ses racines. Magnifique, à dévorer chaque soir. Un livre de chevet.
Pour finir, je partage cette interview de Zemmour par Elie Chouraqui, que j’ai trouvé très intéressante.