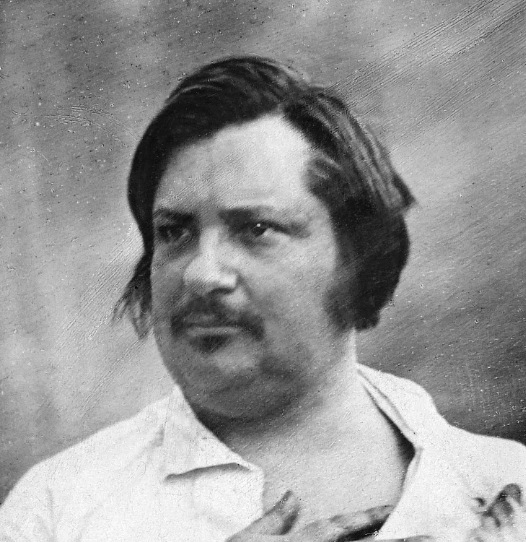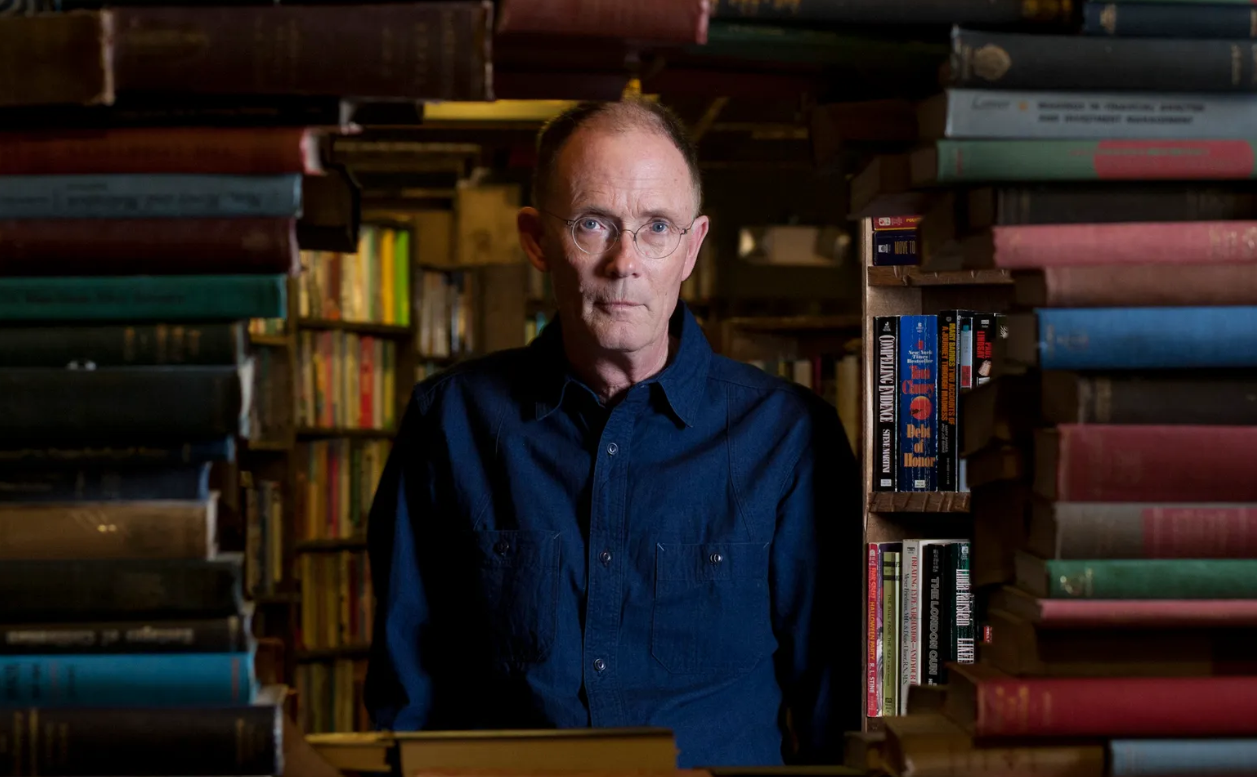Jean-Charles Galli (@JeanCGalli) et Alexandre Stachtchenko (@StachAlex) signent avec « Bitcoin Le choc géopolitique » un livre passionnant et pédagogique sur le Bitcoin, avec un angle d’attaque singulier explicité dans le titre : leur regard est géopolitique. Ils expliquent dès l’introduction pourquoi : dans la mesure où les Etats se sont arrogé le monopole de l’émission de monnaie, ils ont fait passer cette fabuleuse invention (la monnaie) du monde purement économique à un monde politique, et, dans la mesure où les échanges internationaux sont désormais la norme, géopolitique.
Rendre à Hayek
Comme beaucoup d’auteurs ayant étudié le Bitcoin, ils remettent en perspective les différentes raisons qui ont conduits des générations d’informaticiens, et de spécialistes de cryptographie, à tester, essayer, échouer, et finalement réussir à créer une « monnaie électronique purement pair-à-pair qui permet des paiements en ligne envoyés directement d’un acteur à au autre sans passer par une institution financière. » (Satoshi Nakamoto). Les problèmes générés par la mauvaise gestion des Banques centrales, du système bancaire, et des Etats (création monétaire incontrôlée, endettement massif, dévaluation permanente de la monnaie) en sont la cause, et ils avaient été analysé par Hayek dans son ouvrage de 1976 : « The denationalization of money » (il avait anticipé la création de Bitcoin en 1984 dans une interview restée célèbre où il expliquait « Nous ne retrouverons pas de bonne monnaie tant que nous ne l’enlèverons pas des mains du gouvernement. (…) Nous ne pouvons pas le retirer violemment des mains du gouvernement, tout ce que nous pouvons faire, c’est introduire par un moyen détourné quelque chose qu’ils ne peuvent pas arrêter. » Visionner l’interview de Hayek).
Riche et utile
Le livre revient sur un certain nombre de choses déjà connues de ceux comme moi qui sont passionnés par le sujet, mais qui sont, ici, présentées de manière suffisamment documentée, approfondie, et pédagogique pour que le livre constitue une excellente introduction à Bitcoin.
J’ai particulièrement apprécié les éclairages stratégiques du point de vue des Etats et des entreprises (trop rarement ajoutées à cette discussion, alors qu’elles jouent un rôle central dans l’adoption). Ainsi, d’ailleurs, que les éclairages apportés sur le minage et le rôle de cette industrie dans une possible meilleure gestion globale d’un système énergétique (j’avais déjà appris beaucoup grâce aux interviews de Seb Gouspillou @SebGouspillou). La plongée détaillée dans ce que Nayib Bukele (@nayibbukele) a mis en place au Salvador est également passionnante, par le courage et la ténacité de cet homme, et tant on peut voir sur cet exemple à quel point les institutions internationales (FMI notamment) sont politisées et prédatrices.
D’une manière générale, la grande qualité du livre repose sur le regard très réaliste que portent les auteurs sur l’essor du Bitcoin : loin d’un discours d’idéaliste ou de propagande, ils décrivent de manière pragmatique les progrès (incroyables) et les risques (réels) dans le parcours du Bitcoin depuis sa création.
Train qui passe… avec ou sans nous ?
A la fin de la lecture, je ressors avec le sentiment assez frustrant de constater que tous ceux qui regardent ce sujet avec sérieux arrivent aux mêmes conclusions : la France aurait tout ce qu’il faut pour choisir de monter à bord de ce train (le nucléaire, la population bien formée, un système bancaire important et structuré), mais que la clique de socialistes au pouvoir dans les différents strates bloquent cette innovation majeure, en lui mettant des batons dans les roues (fiscaux, juridiques, médiatiques, politiques, réglementaires). Notre classe politique pour des raisons idéologique, sur ce sujet comme sur d’autres, joue contre l’intérêt du pays et de son peuple. Je mets à part Sarah Knafo (@knafo_sarah) qui a visiblement travaillé le sujet et qui s’en est faite, avec d’autres, la porte-parole au niveau européen pour expliquer que le Bitcoin est la monnaie libre, là où les MNBC (monnaies numériques de banque centrale) ne sont que des instruments de surveillance de plus. Le livre d’ailleurs montre très bien les contradictions morales, logiques et économiques, qui font des MNBC une arnaque intellectuelle : pour être réellement ce qu’elles prétendent être, elles devraient se mettre en place avec en parallèle la suppression des Banques Centrales, ce qui, bien sûr n’est pas le cas… Je laisse le mot de la fin aux auteurs, en citant un morceau de leur conclusion, et les remercie pour ce livre très riche et utile.
A mesure que le temps passe, le statut de Bitcoin comme réserve de valeur numérique rare, non confiscable et ne requérant aucune permission pour être utilisé se renforce, sous un triple effet : un nombre croissant d’utilisateurs convaincus partout dans le monde, l’acculturation qui s’opère et l’engagement de grandes sociétés et d’Etats dont les engagements ont valeur de prescripteurs. A mesure que sa rareté augmentera et que son adoption s’étendra, Bitcoin s’imposera comme une réserve de valeur numérique incontournable, offrant un outil d’émancipation financière face aux aléas des systèmes monétaires traditionnels.