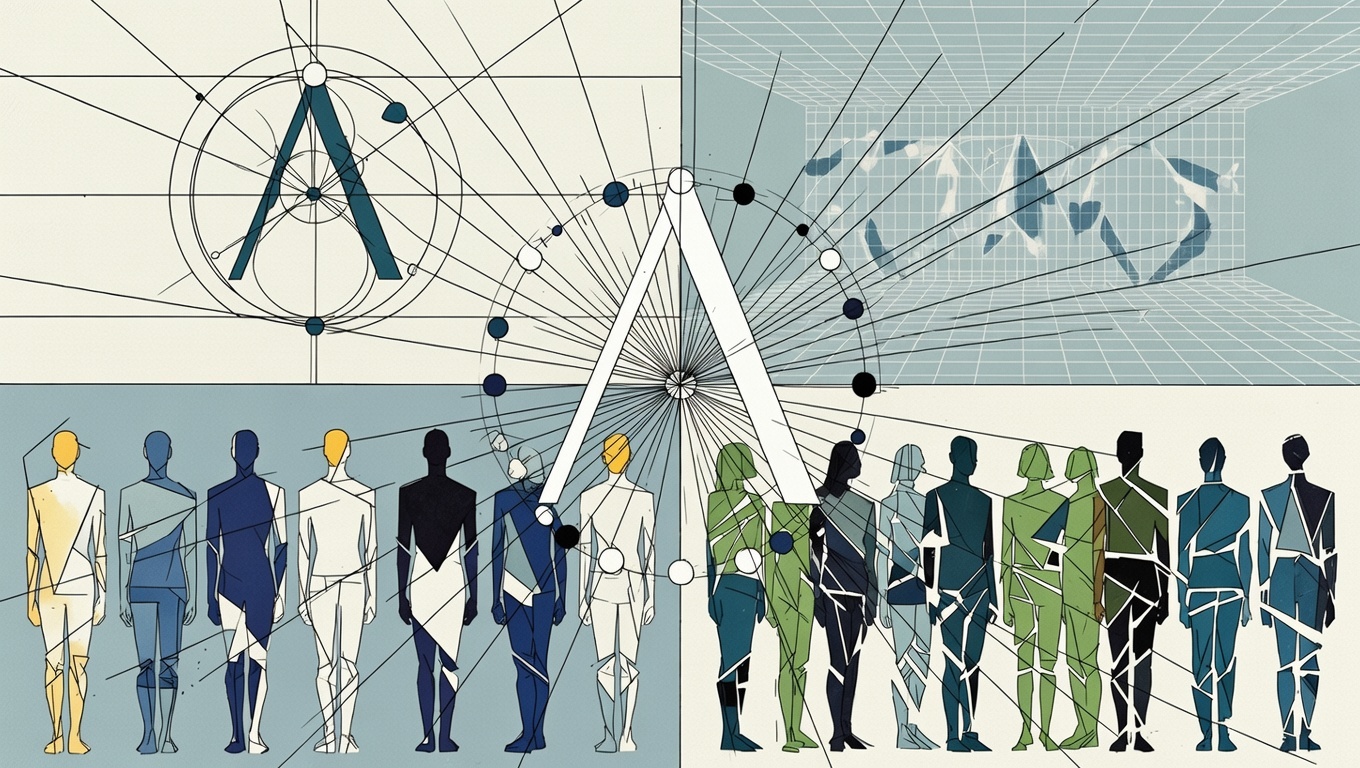Grâce à François, mon père, et à mes frères et belles-soeurs, nous avons esquissé pendant notre repas de Noël une belle discussion sur le thème de l’universalisme. C’est un sujet passionnant. Notre père avait travaillé le sujet et en avait fait un article, très intéressant, en réaction à d’autres articles. Pour pouvoir suivre la réflexion, je suis allé regardé, pendant que nous discutions, la définition sur le TLFI :
Universalisme n. m. :
Toute doctrine qui considère la réalité comme un tout unique, ce qui revient à dire universel, dans lequel les individus ne peuvent être isolés, si ce n’est par abstraction.
Elle m’a interpelé, très fortement, et m’a forcé à réfléchir un peu plus à ce sujet.
Contre-intuitif
J’avoue que spontanément, si l’on m’avait demandé si je pensais être universaliste, j’aurais répondu « oui ». Pour la raison que je crois en une forme de « nature humaine », sous-jacente aux différentes races, cultures, particularismes, et à des « droits naturels » associés à cette nature. Mais la définition philosophique (celle que j’ai recopié ci-dessus) est plus précise que cela. Je considère la réalité comme un tout unique (le Réel), mais je considère également qu’il est faux de dire que les individus ne peuvent être isolés, si ce n’est par abstraction. En tout cas, cette idée m’interpelle. Et elle me parle cependant car, oui, les frontières entre l’individu et la société dans laquelle il s’insère ne sont pas si nettes que cela. Pour préciser ma pensée, j’ai besoin d’aller chercher le sens du mot « abstraction », car j’y vois plusieurs notion distinctes allant de la montée en concept « abstraits » à la négation de la réalité « concrète ». En fait « Abstraire », car l’abstraction est le pouvoir, la capacité d’abstraire.
Abstraire v. trans :
Isoler, par l’analyse, un ou plusieurs éléments du tout dont ils font partie, de manière à les considérer en eux-mêmes et pour eux-mêmes.
L’universalisme décrit donc des doctrines dans lesquelles les « individus » n’existent comme objet de pensée que par effort d’abstraction. C’est une idée forte. Est-ce que l’existence d’une réalité unique, d’un tout, implique nécessairement que chaque « être » (que ce soit un individu ou un objet, la question est la même), ne puisse être pensé que par abstraction ? Je crois très profondément le contraire. Ce sont des éléments que je développerai dans mon essai, mais j’en partage quelques-uns ici, cela me permettra de préciser ma pensée.
essence ou ensemble d’objets ?
Il me semble que l’on peut considérer la « réalité unique » dont parle la définition d’universalisme comme un ensemble de choses plutôt que comme un tout unique indifférencié. Si l’on accepte l’idée que la réalité est « tout ce qui existe », alors on peut partir du principe, pragmatique, qu’il existe une multitude de choses, d’êtres, vivants ou non, matériels ou non, qui font, pris dans leur ensemble, la réalité. C’est une vision pluraliste de la réalité vue comme un « ensemble » de choses, plus que comme une « essence » unique dont chaque être ressortirait et ne pourrait être, par conséquent, qu’abstrait pour pouvoir être pensé. Je crois vraiment que c’est notre connaissance des différents objets qui peuplent le réel qui construit notre compréhension de celui-ci. J’accepte l’idée que des objets de nature, d’essence, différente peuplent le réel. Une idée n’est pas de même nature qu’un électron. Les deux sont des objets de la réalité.
Vu sous ce prisme, une doctrine universaliste me parait être à coup sûr un idéalisme (« Toute philosophie qui ramène l’existence à l’idée »). La vision que je développe en partant des objets est une vision pragmatique (« Qui concerne les faits réels, l’action et le comportement que leur observation et leur étude enseignent »).
Après réflexion, et grâce à ces définitions, je crois pouvoir dire très simplement que je ne suis pas universaliste.
Et les humains dans tout ça ?
Si l’on revient au sujet de départ, qui ne concernait pas les essences abstraites, ou la manière d’aborder le réel, mais bien les individus humains, et les cultures et les peuples, est-ce que ce détour par le dictionnaire permet de clarifier les termes de la discussion ? Il me que oui, en partie. Les doctrines universalistes posent comme principe de départ que l’individu n’existe pas en tant que tel, mais par un effort d’abstraction, d’isolement de son contexte, pour en décrire des caractéristiques qui seront toujours, d’une manière ou d’une autre, porteuses d’une « simplification », ou d’une perte véracité. Or, et c’est mon point de vue, que je suis en mesure d’exposer plus clairement maintenant, il me semble tout à fait légitime et justifié de partir du principe d’existence des individus (comme entités biologiques, organismes), et de chercher à comprendre ce que sont leurs caractéristiques, leurs déterminants, etc. Cela n’empêche pas de chercher à penser le collectif, ou la culture, ou la civilisation, ou la race, ou tout autre catégorie visant à généraliser. Cela interdit simplement, et c’est mon point, de sacrifier l’individu au nom de l’universel, ce que font les universalismes en prétendant que l’individu n’existe que par abstraction. S’il existe une réalité « surplombante » et que l’individu n’est toujours qu’une idée (résultat de l’effort d’abstraction) alors il ne vaut pas grand-chose. Je ne prétends pas avoir raison sur la philosophie, mais ma sensibilité et mes maigres connaissances historiques me semblent confirmer que les doctrines universalistes sont aussi celles qui, par centaines, par milliers, par millions, ont tués des pauvres gens qui n’avaient rien demandé à personne. Je comprends mieux pourquoi : ce n’était pas des personnes, des individus, mais des « abstractions » isolées du Grand Tout.