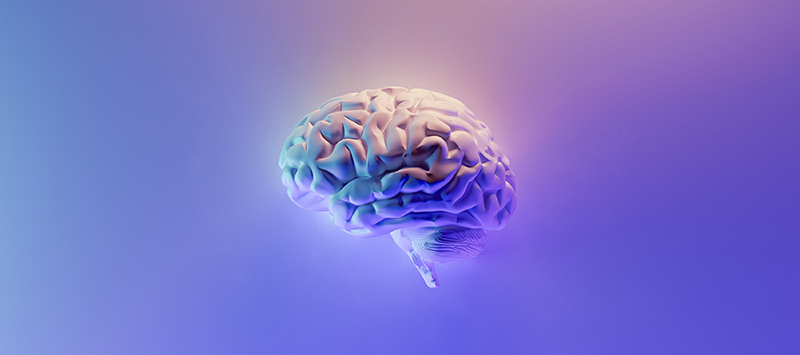Une macro-étude vient d’être partagée par Nicolas Hulscher sur son compte X (il est épidémiologiste à la McCullough Fondation) : elle reprend les chiffres de 99 millions de personnes ayant reçu l’injection contre le COVID. Les chiffres sont sans appel :
- Risque accru jusqu’à 610 % de myocardite après une injection sur plateforme ARNm.
- Risque accru de 378 % d’encéphalomyélite aiguë disséminée après une injection d’ARNm.
- Risque accru de 323 % de thrombose veineuse cérébrale après une injection de vecteur viral.
- Risque accru de 249 % de syndrome de Guillain-Barré après une injection de vecteur viral.
Je me demande pourquoi ces faits ne sont pas partagés et discutés dans les médias français, qui ont passé tant de temps à nous énumérer le nombre de morts du COVID, et à se faire les agents de la propagande gouvernementale. Ce décalage de traitement m’inspire plusieurs remarques, sur des plans différents.
Médias véreux
Ce n’est pas une nouvelle bien sûr, mais ce qui se passe depuis que la période COVID s’est terminée, dans les médias, est assez étonnant. Le sujet n’existe presque plus. Deux années complètes de folie administrative et sanitaire, de la censure avérée, des mensonges avérés, des invectives, des gens suspendus, des réputations jetées en pâture, des injections quasi-obligatoires d’un produit mal testé : et puis, plus rien. Le rôle de « chiens de garde du pouvoir » des médias est plus que jamais flagrant. Circulez, il n’y avait rien à voir, et sauf contraints et forcés, les médias vous diront qu’il n’y a toujours rien à voir.
Difficile apprentissage
Ce qui est difficile, c’est de sortir de la logique de bouc-émissaire, et réfléchir à ce qui s’est passé, et comment on pourrait éviter de refaire les mêmes erreurs. Collectivement qu’avons-nous appris ? Comment cela se traduit-il dans des règles différentes de fonctionnement ? Sans partager les faits, il n’est pas possible d’apprendre. Sans revenir, et c’est difficile, sur ce qui s’est passé, sur ce qu’on savait à quel moment, etc. il ne sera pas possible de progresser. Les confinements étaient idiots, le Covid n’était dangereux que pour certaines personnes à risque, les « vaccins » n’ont pas été testé dans les règles de l’art et ne protégeaient pas du tout. La quasi-obligation vaccinale était une hérésie sanitaire, philosophique et politique. Ce n’est pas parce que tout le monde ou presque devient fou en même temps, que c’est moins fou. Je n’arrive pas à voir comment ce travail pourrait avoir lieu, si certains n’ont pas le courage de reconnaître des torts, des mauvais choix (quelles qu’en soient les circonstances atténuantes). Faute avouée, à moitié pardonnée, dit le proverbe.
Chemins personnels
Pour finir, il me semble que la racine du problème est individuelle. Quelles qu’aient pu être nos positions, convictions, efforts d’information, pendant cette période, il est dur de faire son introspection. Par exemple, j’ai accepté que mes enfants soient vaccinés, alors même que je pensais qu’il n’y avait aucun bénéfice à le faire (et c’était même plus grave, il y a avait un risque de conséquences plus grave que la Covid. Je regrette cela ; j’étais probablement plus informé que la moyenne, et je n’ai pour autant fait les bons choix. Je comprends que certains préfèrent oublier volontairement cette période et passer à autre chose. Mais je trouve cela d’une grande tristesse : vivre sa vie en escamotant une partie du réel, de nos choix individuels et collectifs, n’est-ce pas une manière, déjà, d’accepter de vivre dans la « Matrix » de l’Etat ? Car en faisant cela, ce n’est pas seulement nos erreurs, nos choix, nos hésitations, nos disputes, que nous effaçons, mais aussi les responsabilités, à commencer par la nôtre. Qui peut prétendre être libre, sans être responsable ?