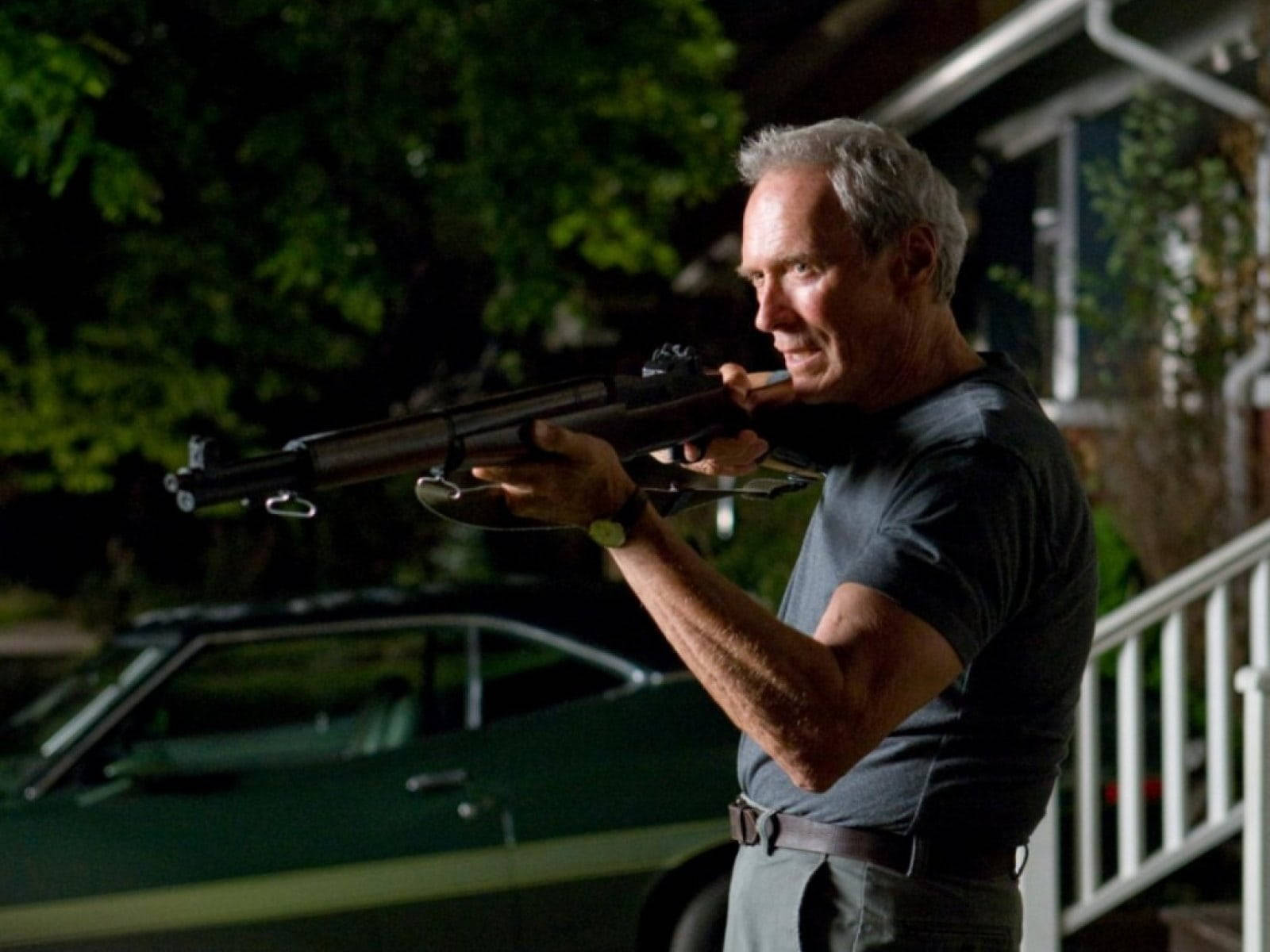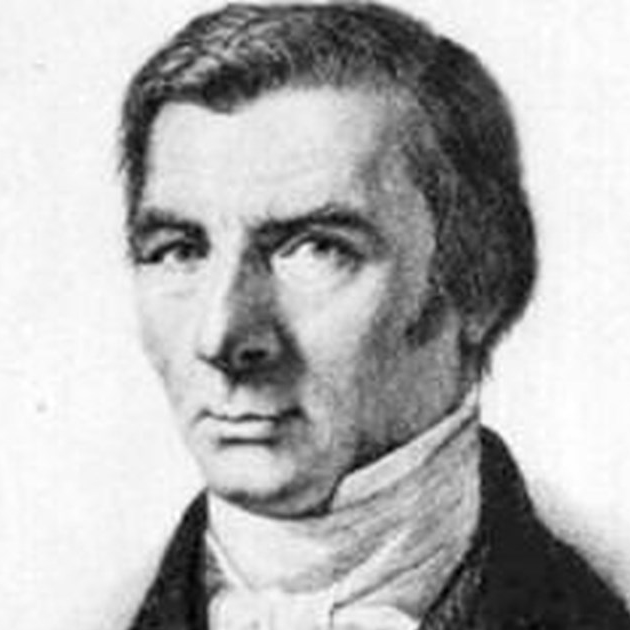Qu’est-ce qu’une monnaie ? A quoi ça sert ? Quelles sont les caractéristiques d’une bonne ou d’une mauvaise monnaie ? C’est à ces questions que Saifedean Ammous répond dans « L’étalon Bitcoin », avant de présenter le Bitcoin qui est probablement une monnaie presque parfaite.
Le titre de l’excellent livre de Saifedean Ammous, économiste de l’Ecole Autrichienne (dont je me revendique philosophiquement), est un peu trompeur : J’utilise dans mes articles des liens vers des pages Wikipedia : faites attention à la qualité des informations que vous pouvez y trouver, notamment celles ayant des résonnances politiques.c’est d’abord et avant tout un ouvrage passionnant sur la monnaie, et l’histoire des monnaies. Bien sûr, en filigrane, il y a le Bitcoin, mais c’est seulement dans les tous derniers chapitres que l’auteur le traite à part entière, et pour montrer sur quels points spécifiques le Bitcoin est une réponse à des problématiques concrètes des monnaies à l’ère du numérique et des Banques centrales. Ce livre, je le précise, sorti en 2018, est devenu un classique sur la monnaie et Bitcoin. Il était recommandé par Philippe Herlin dans son excellent « Bitcoin : comprendre et investir« , et également par Jon Black dont je suis l’excellente chaîne Youtube. Sauf mention contraire, les citations dans cet article sont tirées du livre.
Qu’est-ce qu’une monnaie ?
J’avais beaucoup apprécié la lecture de l’ouvrage de Pascal Salin « La vérité sur la monnaie », dont j’ai pu réviser, grâce à « L’étalon Bitcoin » un certain nombre d’éléments. Je trouve extrêmement important de comprendre ce qu’est une monnaie, et je synthétise ici les points clefs pour en garder trace, et les partager avec vous, chers lecteurs.
Moyen d’échange
Les échanges directs ne sont pas toujours simples entre humains : il faut pour qu’ils soient possible une quadruple coïncidence difficile à réaliser dans la pratique (de besoins, de temps, d’échelle, de lieux). Si j’ai des carottes à échanger contre du bois, il faut qu’au moment (temps) où j’ai besoin de bois, j’ai en au même endroit que moi (lieux), quelqu’un qui a du bois et besoin de carottes (besoins), et que j’ai suffisamment de carottes pour avoir du bois (échelle). Une monnaie est d’abord et avant tout un bien qui résous ce problème : un intermédiaire qui sert de moyen d’échanges. Un tel bien, s’il est suffisamment accepté comme moyen d’échanges, permet à chacun de ne plus se préoccuper de trouver ceux qui ont, au bon moment, les bons biens à échanger contre le sien. Ce premier aspect de la monnaie est essentiel, car il est consubstantiel à la possibilité de la division du travail. Sans monnaie, je suis presque obligé de moi-même disposer d’un peu de bois, sous peine de ne jamais rencontrer cette quadruple coïncidence. Avec une monnaie, je sais que je peux me concentrer sur mes carottes, les échanger contre le bien qui sert de monnaie, et que grâce à cette monnaie je pourrais facilement me procurer du bois (et toutes les autres choses dont je pourrais avoir besoin).
C’est la fonction par excellence de la monnaie que d’être un médium d’échange – en d’autres termes, c’est un bien acquis non pour être consommé (un bien de consommation), non pour être employé pour la production d’autres biens (un investissement ou un capital), mais en priorité pour être échangé contre d’autres biens.
Réserve de valeur
Tous types d’objets ou de bien peuvent servir de monnaie : il y a eu dans l’histoire de l’humanité des monnaies en coquillage, en pierre, en sel, en animaux, en métaux précieux, en papier monnaie, etc… Il est important que cette monnaie soit facilement échangeable ou vendable (liquide), et qu’elle le soit de manière durable dans le temps. Il faut donc éviter des monnaies qui pourraient pourrir dans le temps (soit parce qu’elles sont organiques, soit parce qu’elles seraient soumises à différentes formes de détérioration – corrosion, érosion, etc..). Mais cette intégrité physique ne suffit pas.
Pour qu’un bien garde sa valeur, il est aussi nécessaire que la disponibilité de ce bien ne s’accroisse pas considérablement pendant la période où il est détenu par son propriétaire. Il y a une caractéristique commune aux différentes formes de monnaie à travers l’histoire qui est l’existence d’une mécanisme restreignant la production de nouvelles unités du bien servant de monnaie afin de maintenir la valeur des unités existantes. La difficulté relative de production de nouvelles unités monétaires détermine la dureté d’une monnaie. Une monnaie dont la production est difficile à accroitre est qualifiée de monnaie dure alors que la monnaie facile est celle dont la production en grande quantité est élastique.
Cette dureté peut se mesurer assez facilement en faisant le rapport de deux choses : le stock (quantité totale existante de cette monnaie) et le flux (la production supplémentaire qui sera faite au cours de la prochaine période). Plus ce ratio stock/flux est élevé, plus nous avons affaire une monnaie dure. Saifedean Ammous insiste sur le fait que dans l’histoire des monnaies, les biens qui ont duré le plus comme monnaie, sont les plus durs, c’est-à-dire les monnaies dotées de mécanismes de protection contre la production facile. Un autre aspect : tout changement dans les conditions de production d’une monnaie particulière peut complètement renverser sa valeur. L’exemple historique des monnaies de pierre des îles Yap vaut le coup d’être découvert (l’auteur le décrit de manière détaillée sous l’angle purement monétaire).
Unité de compte
Un autre aspect fondamental de la monnaie est le fait de pouvoir servir d’unité de compte. Le fait qu’un bien soit diffusé largement et utilisé comme moyen d’échange rend possible d’exprimer les prix de tous les autres biens dans cette unité de compte. Cet élément est fondamental parce qu’il permet l’existence d’un système de prix, facilitant énormément les calculs économiques variés, et la circulation de l’information. L’existence de prix, en effet, permet à de nombreux acteurs économiques de se coordonner sans avoir besoin de communiquer entre eux. La variation d’un prix d’une matière première permet à ceux qui l’utilisent d’ajuster en conséquence leur activité sans avoir besoin d’aller se renseigner sur le détail des variations des conditions de production de cette matière première. C’est un des fondamentaux de l’efficacité d’un marché libre avec un système de prix : il permet une coordination spontanée, décentralisée, de nombreux acteurs de manière particulièrement efficace, en permettant la circulation de l’information, et l’auto-régulation des activités des acteurs entre eux sur la base de ces informations. C’est pour cette raison que la fixation arbitraire des prix, toujours, détruit la liberté et nuit à l’efficacité collective des échanges. Hayek avait expliqué tout cela dans un article fameux de 1945 « The use of knowledge in Society« .
Voilà des élément importants de connaissances sur ce qu’est une monnaie, c’est-à-dire ces billets de banques, ces euros, que nous utilisons tous les jours de multiples fois. Moyen d’échange, réserve de valeur, unité de compte, voilà les 3 caractéristiques majeures d’une monnaie, qui peut être plus ou moins dure (solide).
La place des Etats dans l’appauvrissement du monde
L’histoire des monnaies que dresse ensuite l’auteur pourrait tenir en quelques principes, illustrés par nombreux exemples concrets historiques, documentés et vérifiables :
- Toute personne qui a la capacité à créer de la monnaie ne pourra pas résister longtemps à le faire. Quand il le fait, il s’enrichit au détriment de tous ceux qui en détenaient avant (il créé de toute pièce une richesse pour lui, en faisant perdre de la valeur à la monnaie que tous les autres utilisent)
- Toutes les périodes fastes de développement économique ont coïncidée avec des monnaies dures (le Florin, le Ducat, l’étalon-or)
- La main mise par les Etats sur les monnaies, et l’uniformisation de leur gestion de l’inflation, conduit à des monnaies de mauvaise qualité, qui appauvrissent les gens à chaque nouvelle inflation de la masse monétaire, et encourage ainsi des comportements orientés sur la consommation immédiate et d’endettement plutôt que sur l’épargne et le pari sur le futur. Si je n’ai pas d’assurance que mon épargne en euro vaudra encore quelque chose dans 5 ou 10 ans, j’ai intérêt à emprunter ou à dépenser cette monnaie de mauvaise qualité rapidement. Ces emprunts et ces dépenses, contrairement à l’épargne et à l’investissement, limitent l’énergie que nous mettons à améliorer les moyens de production.
- L’utilisation d’une mauvaise monnaie permet aux politiciens d’emprunter pour financer tout un tas de projets fumeux, sans avoir à faire peser ces choix sur les citoyens directement (ce qui serait le cas s’ils passaient par l’impôt). Mais ce n’est qu’une manière de différer le poids : la dette s’accumule, les projets destructeurs de valeur aussi, les bulles d’investissements qui existent uniquement parce que de grandes quantité d’argent sont régulièrement créés de toute pièce et injectées dans l’économie. Dans tous les secteurs, on trouve des activités dont la seule raison d’être est qu’elles ont pu être créées avec cet argent facile.
Je ne reviens pas trop en détail sur les exemples historiques que cite l’auteur. Il y a en de nombreux. Selon lui, l’abandon de l’étalon or à peu près au moment de la première guerre mondiale a été une des causes des problèmes rencontrés par l’Occident depuis cette époque. Et toujours pas résolu, car l’inflation de la masse monétaire est devenue une sorte de règle de fonctionnement des monnaies étatiques, que nous sommes obligés d’utiliser. Von Mises avait résumé cela (cité dans le livre) :
Les gouvernements pensent que … quand il y a le choix entre un impôt impopulaire et une dépense très populaire, ils ont une solution – la voie vers l’inflation. Ceci illustre le problème né de l’abandon de l’étalon-or.
Ludwig Von Mises, extrait d’une conférence
Le cas de Keynes
On peut se demander pourquoi, sachant tout cela, nous continuons à accepter ce genre de politique. Un des éléments de réponse, passionnant, est qu’une partie des économistes, politiciens, élites, sont biberonné avec la pensée de Keynes, chantre de l’intervention étatique dans l’économie, enseigné dans toutes les universités. Cette pensée économique, Saifedean Ammour le montre citations et raisonnements à l’appui, est complètement fausse sur pleins de points (mais continue pourtant à être enseignée). Elle repose sur l’idée, jamais démontrée ou argumentée par Keynes, que l’activité économique est d’autant meilleure que les Etats s’endettent. Et donc, il est légitime qu’ils aient la main sur la monnaie et en créent beaucoup pour s’endetter. C’est bien sûr le contraire que l’on constate. Mais, c’est ce qu’une partie des gens apprennent en cours. Par ailleurs, l’auteur montre qui était Keynes, fils d’une famille richissime famille, né avec une cuillère en or dans la bouche, pédophile, partisan d’un eugénisme et d’un totalitarisme soft assumé.
Le Bitcoin comme monnaie parfaite ?
Le Bitcoin s’inscrit très exactement dans cette histoire des monnaies, à l’ère du numérique. C’était la question de son génial inventeur dont seul le pseudonyme est connu (Satoshi Nakamoto) : « comment créer une monnaie numérique liquide pair-à-pair ? ». Il a construit, avec d’autres, et depuis avec une armée de développeurs, une réponse aux vœux exprimés par Hayek en 1984 (cité dans le livre):
Je ne crois pas que nous aurons à nouveau une bonne monnaie avant que nous ne reprenions la chose des mains du gouvernement. Autrement dit, nous ne pouvons pas le reprendre d’une manière violente des mains du gouvernement, tout ce que nous pouvons faire, c’est introduire d’une façon rusée et par un moyen détourné quelque chose qu’ils ne peuvent pas arrêter.
J’ai passé déjà quelques dizaines d’heures à étudier le Bitcoin, et il faut reconnaître que c’est une invention géniale. En voici quelques éléments clefs, bien sûr beaucoup plus approfondis dans le livre, dont je ne peux que recommander chaudement la lecture (que vous ayez envie ou non d’investir dans du Bitcoin, car c’est un excellent ouvrage d’économie monétaire et d’histoire de la monnaie).
- Stock limité : le code mis en place pour le bitcoin a posé cela dès le début : il n’y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin (chaque bitcoin est divisé en 100 millions de satoshis). Depuis l’apparition du bitcoin, en 2009, le nombre de bitcoin en circulation augmente, de moins en moins vite, et se terminera vers 2140. Cela fait du bitcoin la monnaie la plus dure qui soit : un accroissement de sa valeur ne peut pas entraîner un accroissement de son offre.
- Sans intermédiaire : le fonctionnement du Bitcoin est basé sur un réseau de nœuds (logiciel installé sur un ordinateur pour faire vite) qui détiennent tous une copie, mise à jour en temps réel, de toutes les transactions bitcoin depuis le début. Ce registre particulier, crypté (reposant sur une blockchain, dont c’est selon l’auteur la seule application concrète), sert à vérifier à chaque transaction la possibilité de celle ci. Celui qui envoie des bitcoins à un autre a-t-il réellement en sa possession ces bitcoins ? Le fonctionnement du bitcoin est génial sur ce point : il est très coûteux pour les mineurs (des nœuds particuliers du réseau) de générer de nouveaux bitcoins, ou de générer une transaction dans le registre, et il est très facile pour le réseau de vérifier la validité des transactions et des nouveaux bitcoins. Du coup, il y a un mécanisme économique génial qui rend très difficile – impossible – la fraude. Pas besoin d’une autorité centrale, ou d’un tiers, pour valider les opérations : le réseau de nœuds sert à cela.
- Premier vrai transfert numérique : comme l’explique très bien l’auteur, « Bitcoin est le premier exemple d’objet numérique dont le transfert met fin à sa détention par l’expéditeur. Nakamoto a inventé la rareté numérique
- Ultra-robuste : depuis son apparition, il y a eu pas mal de tentatives de hackers, ou simplement de gens qui pensaient pouvoir améliorer le bitcoin, pour modifier le code bitcoin. Toutes ces tentatives, décrites dans le livre, ont échouées car le fonctionnement en réseau rend quasi-impossible le fait de faire évoluer le code, et par ailleurs très peu rentable économiquement. Il faudrait des moyens colossaux pour réussir à contrôler la moitié des nœuds du réseau, et l’opération, si elle réussissait, conduirait à une perte importante de la valeur du Bitcoin, donc rendrait cette opération encore moins rentable.
Le bitcoin, pour finir, est tout à fait fascinant. C’est le fruit d’une idée de génie, puis d’une communauté de développeurs qui ont amélioré le code, patiemment, de manière très conservative (c’est très bien décrit dans l’ouvrage). La valeur du bitcoin, qui n’est plus à prouver, repose sur ses caractéristiques de conception, et sur ces nombreuses petites évolutions faites par la suite. Il évolue selon des règles catallactiques désormais. C’est un exemple de ce que le philosophe Ferguson appelle « le produit de l’action humaine et non une conception humaine ».
Un dernier point qui est surprenant, pour illustrer les propos précédents, est la Loi de puissance que semble suivre le cours du bitcoin. Sur six ou sept ordres de grandeur de prix, l’évolution temporelle du bitcoin suit (avec bien sûr beaucoup de fluctuations et de volatilité) une loi de progression simple qui semble traduire, de mon point de vue, la dureté de cette monnaie. A date 25 juillet 2024, voici la photo du bitcoin :
- Nombre de bitcoins en circulation : 19 730 450
- Valeur d’un bitcoin en Euros : 59 000
Je ferai prochainement un billet pratico-pratique sur la manière d’acheter et sécuriser des bitcoins.