Faire du pop-corn avec des téléphones portables, c’est possible ? Bien sûr que non. Un rapide tour des connaissances sur les effets des ondes des portables sur la santé montrent qu’ils sont sans effets connus. Ni sur les grains de maïs, ni sur nous. Pourtant des scientifiques de renom s’associent pour recommander de prendre des précautions. Recommandations bienveillantes, ou opération de communication intéressée ? Je penche pour la deuxième explication. La peur est un levier puissant.
(suite…)
Étiquette : Politique
-
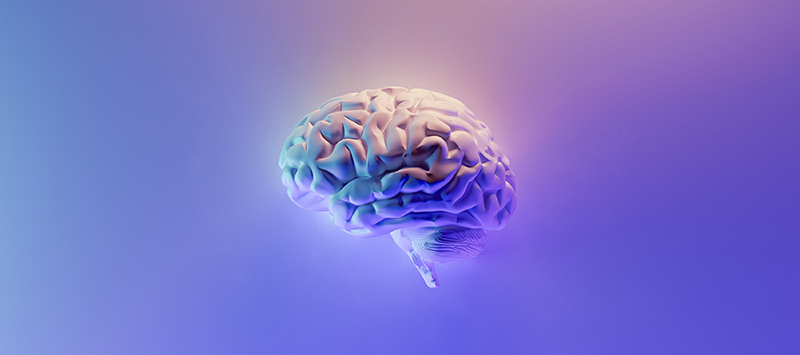
De la bouillie de cerveaux !
-
Etats d’âme à cause d’un Etat sans âme
J’allais consacrer un peu de temps pour écrire un petit billet sur les dangers pour la santé des téléphones portables. J’ai vu passer une vidéo chez Digiboy, et je voulais faire un petit dossier pour expliquer ce qu’on sait à propos des téléphones portables, des rayonnements. Utiliser un peu mes compétences scientifiques, et un peu le « Kit de détection d’idioties » pour démêler le vrai du faux, et montrer comment, en l’état actuel de nos connaissances, les portables ne présentent aucun danger pour l’être humain. Je le ferai plus tard.
En effet, j’ai lu un billet de René Foulon consacré aux réactions du monde politique à propos de l’augmentation du prix du pétrole : il qualifie à juste titre de scandale cette manie de vouloir taxer de manière arbitraire les acteurs de l’économie pour caresser le « peuple » dans le sens du poil. Et je ne peux pas ne pas réagir : j’ai envie de dormir ce soir, et ne pas ruminer.
Je suis quelqu’un d’ouvert, de tolérant. Je suis optimiste, et j’aime la vie : en ce moment plus que jamais. J’ai la chance d’avoir une vie sentimentale bien remplie, un travail épanouissant, une famille, des amis. Et je ne voudrais pas donner l’image de quelqu’un d’aigri, ou qui passe son temps à pester contre tout. Mais je ne comprends pas cette « culture » anti-fric, anti-réussite, qui pense que toute solution ne peut venir que de l’État, qui pense que l’on peut prendre dans la poche de l’un pour donner aux autres, qui ne supporte pas l’utilisation de la force par certains, mais qui légitime son utilisation par l’État quand elle est dirigée vers des sociétés privées (ouh! capitalistes, horribles profiteurs qui sucent le sang des pauvres en se vautrant dans le cynisme) !
En commentaire de ce billet de René, quelqu’un (Mathieu L.) expliquait très proprement son désaccord. La fin de son commentaire m’a permis de bien cerner ce qui me hérisse :Par contre, je reste totalement persuadé que l’État, à travers son parlement qui représente le peuple, peut très bien, s’il le décide, se saisir de biens ne lui appartenant pas, comme il le fait d’ailleurs tous les jours par la taxation. La légitimité de la décision sera ensuite jugée par le peuple aux élections suivantes…
Je lui ai répondu, sans agressivité, que la justice est une chose plus importante à mes yeux que la légitimité démocratique. Comme le disait Ludwig Von Mises :
Croire en la démocratie implique que l’on croie d’abord à des choses plus hautes que la démocratie.
Quel sens peut bien avoir une démocratie où les décisions légitimes sont sanctionnées par le peuple aux prochaines élections, si entre deux élections l’État s’autorise, pour des raisons fluctuantes, non partagées, et toujours arbitraires, de confisquer des biens à certains pour les donner à d’autres. Quelle justice dans cette démocratie ?
Sur la forme, c’est stupide : c’est le meilleur moyen de faire fuir Total à l’étranger, et de s’assurer qu’au lieu de participer à la logique de redistribution des richesses, les propriétaires du groupe décident d’installer leur lucrative activité ailleurs. Bien joué ! Très fin : cela s’appelle couper la branche sur laquelle on est assis.
Mais ce n’est pas pour cette raison bassement utilitariste qu’il faut critiquer ce genre d’attitude. C’est au nom du respect de la propriété privée : les actionnaires de Total ont acquis leurs titres de propriété de manière légitime, lors d’un échange libre. De quel droit un individu, un groupe d’individu, ou à plus forte raison l’État, vient-il confisquer une partie de cette propriété ? Cela s’appelle de la spoliation. C’est du vol. Appelons les choses par leurs noms, puisque les apprentis sorciers pensent pouvoir saupoudrer par-ci, ce qu’ils ont subtilisé par-là . J’enrage de ces réactions médiatiques, opportunistes, sans états d’âmes. Moi, ça m’en donne, des états d’âmes. Comme une envie de se casser de ce pays gouverné par des ignares suffisants, égoïstes, et repus de leur incroyable prétention à vouloir tout contrôler, tout diriger, et faire semblant d’avoir réponse à tout.
On observe la qualité du résultat produit depuis 30 ans par ces politiques. C’est le propre des idiots de ne pas reconnaitre leurs erreurs.
Edit : Certains, comme le Chafouin ou Authueil, vont même jusqu’à nous expliquer que c’est dans l’intérêt de Total que le gouvernement a créé cette « prime à la cuve ». On croit rêver…Je cite Authueil :[…] En créant cette « prime d’aide à la cuve », le gouvernement aide Total, en lui offrant le moyen de maximiser l’effet symbolique des versements qu’il est obligé, politiquement, de faire. […]
-
Libéralisme économique et libéralisme politique
 Retour sur la distinction entre libéralisme économique et libéralisme politique. Quelles sont les différences ? Une rapide recherche fait tomber sur un article très intéressant et précis de François Guillaumat. Qui définit le libéralisme économique, et montre ses liens forts avec la philosophie politique libérale.
Retour sur la distinction entre libéralisme économique et libéralisme politique. Quelles sont les différences ? Une rapide recherche fait tomber sur un article très intéressant et précis de François Guillaumat. Qui définit le libéralisme économique, et montre ses liens forts avec la philosophie politique libérale.
(suite…) -

Le chaud et le froid
La chaire de santé de sciences Po organise les « Tribunes de la santé« . Le Dr. Martin Winckler, médecin généraliste à temps partiel au centre de planification de l’hôpital du Mans, et écrivain, a été l’invité de cette tribune pour y décrire les obstacles et les enjeux relatifs à son métier (13 février 2008, « La crise de la médecine générale »). Bon nombre de ses constats de base trouvent un écho en odontologie : « les études de médecine sont trop élitistes, technicistes et autoritaires » ; ou encore : « les facultés de médecine françaises apprennent aux généralistes à penser en spécialistes alors qu’elles devraient enseigner aux spécialistes à penser en généralistes ».
Attention chaud devant !
Malheureusement notre confrère médecin se prend les pieds dans le tapis en affirmant : « L’idéal du médecin n’est pas de diagnostiquer les maladies mais de faire en sorte que la santé en général de la population soit la meilleure possible ». Quelle confusion ! N’est ce pas au politique de faire en sorte que la santé générale de la population soit la meilleure possible ? Et qui doit se charger de « diagnostiquer les maladies » si ce n’est pas au médecin ? Un tel dérapage ne fait-il pas froid dans le dos ? Martin Winckler n’est qu’un politique déguisé en médecin. Il n’y a pas de honte à ce que tout citoyen donne son avis politique. Mais il ne faut pas le faire comme médecin ès qualité. A vouloir jouer à contre sens (Sciences Po invite un médecin), on décrédibilise, et le médecin, et le politique. Si Winckler ne veut pas diagnostiquer les maladies, qu’il évite de parler au nom des professionnels de santé.
Zorro -
Ouvrir l'assurance maladie a la concurrence européenne
 Dans le très bon dossier du Figaro Magazine de ce week-end consacré aux réformes, figure une liste de 12 idées pour réformer la France. 12 intervenants prestigieux proposent chacun, dans un format très court, une idée forte pour réformer la France. Aujourd’hui je vous livre celle de Pascal Salin : « Ouvrir l’assurance maladie à la concurrence européenne ». Tout un programme, politiquement incorrect !
Dans le très bon dossier du Figaro Magazine de ce week-end consacré aux réformes, figure une liste de 12 idées pour réformer la France. 12 intervenants prestigieux proposent chacun, dans un format très court, une idée forte pour réformer la France. Aujourd’hui je vous livre celle de Pascal Salin : « Ouvrir l’assurance maladie à la concurrence européenne ». Tout un programme, politiquement incorrect !
(suite…) -
La propagande du Monde Diplomatique
Le hors-série du Monde Diplomatique consacré à l’environnement est un sommet de désinformation. Escamotage du débat scientifique encore à l’oeuvre sur ces sujets, présentation des enjeux selon une grille de lecture d’extrême-gauche, choix des sujets particulièrement orientés…C’est un vrai monument, et je le garde chez moi bien précieusement. Décryptage de l’édito et de la grille de lecture…Mensonge et idéologie au programme !
(suite…)