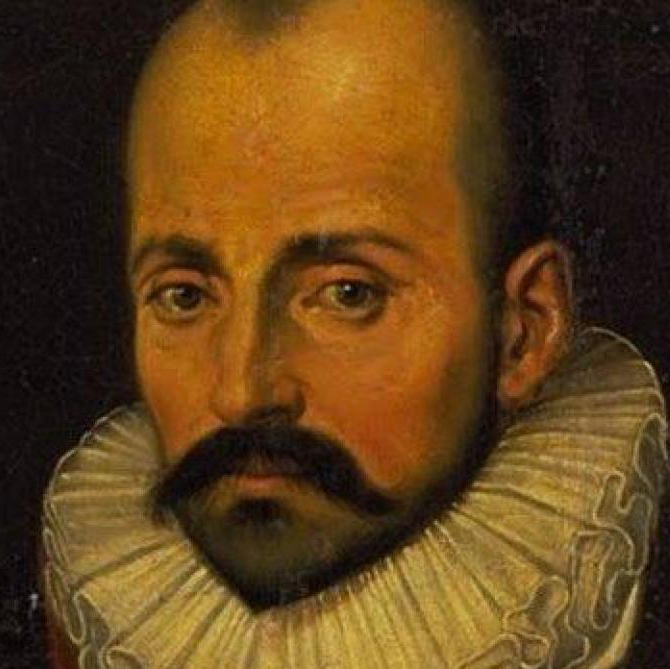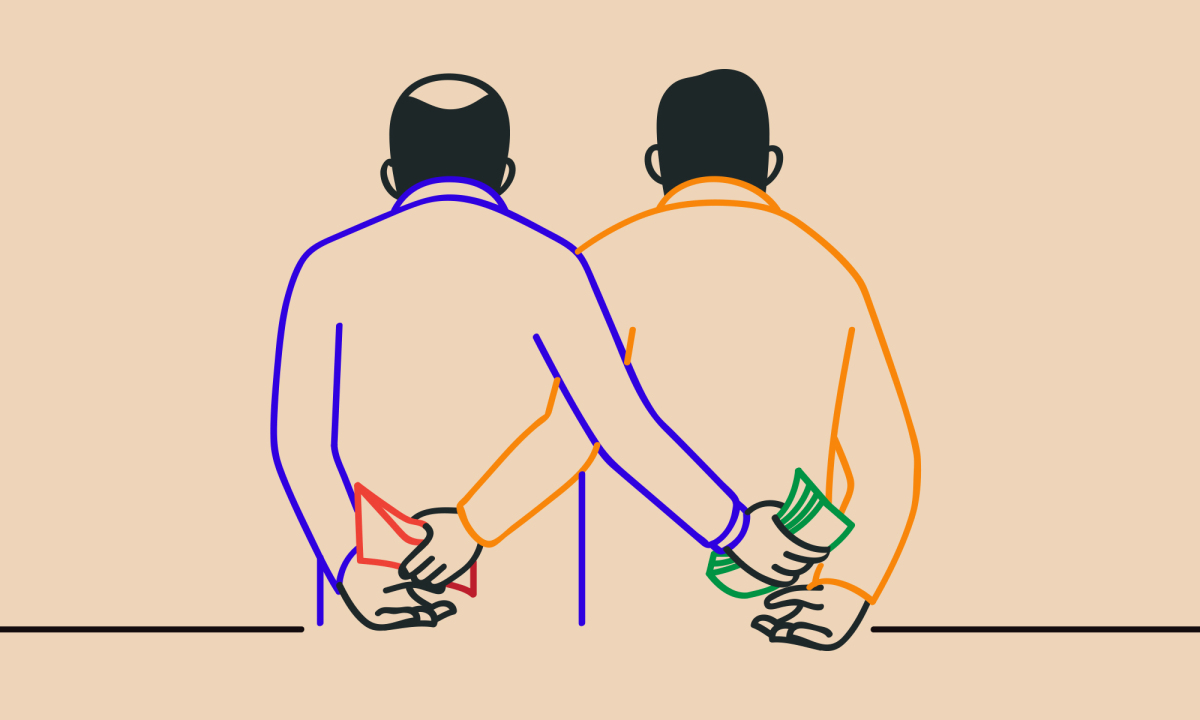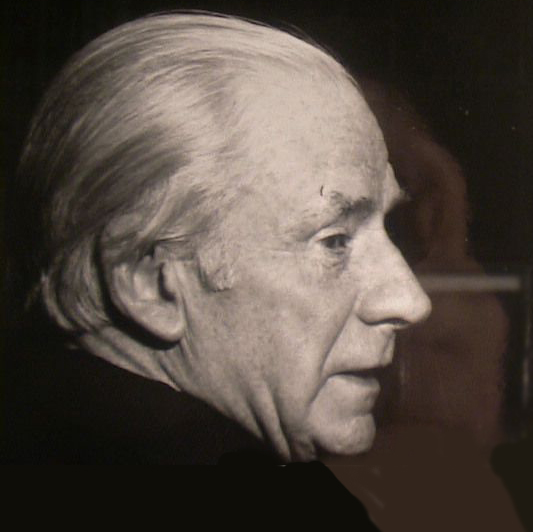Notre liberté est fragile, et menacée. En ces temps troublés, il nous faut la défendre. Deux axes – ce ne sont pas les seuls – : liberté absolue d’expression pour lutter contre l’idéologisation et la pauvreté des débats, et réformes institutionnelles limitant les abus de pouvoir.
Elites pourries
Pierre Mari avait malheureusement raison : une partie de nos élites est pourrie. Pourrie, dans le sens du dictionnaire : « corrompue moralement ». Sur la scène internationale, comme dans la gestion des affaires intérieures, tout semble être en roue libre, sans aucune dignité, sans aucun sens. On parle de « lâcher la bride » à des citoyens, de décrets pour « autoriser » (!) la vente de sapin de Noël, on décide à notre place ce qui est nécessaire ou non, on libère les islamistes au lieu de les laisser croupir en prison, on connait la fraude sociale monstrueuse sans rien y changer. Comment le peuple pourrait-il ne pas être en colère, lui qu’on laisse crever économiquement, socialement, pour protéger (très mal) les plus fragiles ? Depuis quand la mort des plus anciens et des plus malades conduit-elle à bloquer tout le reste du pays ? Depuis quand accepte-t-on de sacrifier la liberté des plus jeunes pour les plus vieux ?
Car le coeur du sujet, Sylvain Tesson le dit magnifiquement, est bien notre attachement à la liberté : « sommes-nous véritablement passionnés par la liberté ? ». Je suis profondément attristé par l’abandon somme toute assez facile de notre liberté. Pour quelle raison acceptons-nous cela ? Pour sauver des vies. Les plus optimistes y verront la marque de notre solidarité. Sauf qu’il n’y a pas de preuves de l’efficacité du confinement, alors qu’il y a par contre des preuves de sa nuisance. Mais cette acceptation n’est que la conséquence logique des multiples atteintes à la liberté qui ont été faites, depuis de nombreuses années. Plus le sens de la liberté est réduit, plus est facile de faire l’entorse suivante. Je ne vais pas faire ici une liste complète, mais il suffit de voir les atteintes à la propriété privée, la perversion fiscale, la gabegie généralisée, l’instrumentalisation idéologique permanente de la justice, le non-respect du vote démocratique, on comprend que nous avons laissé, collectivement et depuis trop longtemps filer notre liberté. Il est temps de se ressaisir. Cela passe par plusieurs choses, mais je partage ici les deux piliers qui me semblent majeurs : liberté d’expression, et réformes institutionnelles.
Liberté d’expression
Pas de liberté, sans liberté d’expression. Tout commence par la description du réel, et par le débat d’idées. Toutes les opinions doivent pouvoir s’exprimer, même les plus délirantes.
Nous avons maintenant affirmé la nécessité — pour le bien-être intellectuel de l’humanité (dont dépend son bien-être général) — de la liberté de pensée et d’expression à l’aide de quatre raisons distinctes que nous allons récapituler ici :
1° Premièrement, une opinion qu’on réduirait au silence peut très bien être vraie : le nier, c’est affirmer sa propre infaillibilité.
2° Deuxièmement, même si l’opinion réduite au silence est fausse, elle peut contenir — ce qui arrive très souvent — une part de vérité ; et puisque l’opinion générale ou dominante sur n’importe quel sujet n’est que rarement ou jamais toute la vérité, ce n’est que par la confrontation des opinions adverses qu’on a une chance de découvrir le reste de la vérité.
3° Troisièmement, si l’opinion reçue est non seulement vraie, mais toute la vérité, on la professera comme une sorte de préjugé, sans comprendre ou sentir ses principes rationnels, si elle ne peut être discutée vigoureusement et loyalement.
4° Et cela n’est pas tout car, quatrièmement, le sens de la doctrine elle-même sera en danger d’être perdu, affaibli ou privé de son effet vital sur le caractère ou la conduite : le dogme deviendra une simple profession formelle, inefficace au bien, mais encombrant le terrain et empêchant la naissance de toute conviction authentique et sincère fondée sur la raison ou l’expérience personnelle. John Stuart Mill
Il faut mettre fin à toute possibilité de pénaliser la parole publique, et arrêter la censure soft obtenue par une scandaleuse promiscuité entre les médias et le pouvoir. Toutes les subventions, quelles qu’elles soient, vers des médias, doivent être supprimées. Libre à chacun de publier des opinions et de faire de la propagande, mais ce n’est pas au contribuable de payer cela. Trouvez des lecteurs/auditeurs. Si vous avez besoin d’un exemple pour vous convaincre de cette urgence, regardez simplement la couverture médiatique des élections aux USA.
Réformes institutionnelles
Je viens de commander le livre de Jean-Frédéric Poisson, car il a raison : nous avons besoin de réformes institutionnelles. Pourquoi les suédois n’ont pas confiné la population ? Non pas que leurs dirigeants soient plus intelligents, ou la pression populaire moins forte pour paniquer et décider n’importe quoi sous le coup de l’émotion ; non : simplement il n’est pas possible en Suède d’interdire aux gens de circuler car la constitution protège ce droit fondamental. Et en France aussi, me direz-vous ! Que fait le Conseil Constitutionnel ? Il est clair dans la Constitution et la Déclaration des droits de l’homme à laquelle elle fait référence, qu’il n’est possible d’entraver la libre circulation d’un individu que s’il nuit à autrui. Peut-on prouver que l’on nuit à autrui en se promenant simplement dans la rue ? Peut-on prouver que le confinement a permis de sauver des vies ? Non, et non. Cette absurdité est donc non-constitutionnelle. Deux grands plans me paraissent à travailler sur les institutions : sortir de l’étatisme bureaucratique, et remettre de l’ordre dans la limitation des pouvoirs.
Sortir de l’étatisme bureaucratique
Pour l’absurdité bureaucratique, je n’y reviens pas : David Lisnard a signé une excellente tribune sur le sujet, et j’avais abordé dans un article les dérives réglementaires.
(..) il existe des procédures de protection du domaine réglementaire contre les empiètements du pouvoir législatif. Il n’existe pas, par contre, de procédures de protection du domaine législatif contre l’empiètement du pouvoir réglementaire. En d’autres termes : le gouvernement peut prendre des décisions, et mettre en place des réglementations qui ne sont pas fidèles à l’esprit des lois.
Il faut par ailleurs préciser que cette inflation réglementaire et bureaucratique, étatiste, est encouragée par une forme d’hybris, de démesure, liée à l’exercice du pouvoir conçu comme nécessairement centralisé et meilleur décisionnaire que les individus.
Limitation du pouvoir
Ce n’est pas la source mais la limitation du pouvoir qui l’empêche d’être arbitraire. F. Hayek
Sur le plan de la limitation du pouvoir, il y aurait besoin de spécialistes du sujet (droit constitutionnel), mais on peut déjà lister quelques pistes : rééquilibrer les rôles respectifs du gouvernement et du parlement, redonner la décision finale au Conseil constitutionnel, réintroduire l’usage régulier (et respectueux du vote) du référendum, modifier les modes de scrutin (passer au suffrage par Jugement majoritaire), supprimer les strates de pouvoir multiples en donnant la préférence aux niveaux inférieurs.
Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir. Monstequieu
La liberté est une noble institution, faite des limites mêmes qui la rendent possible (au niveau individuel comme collectif). C’est le socle moral de nos sociétés. Cessons donc de la laisser filer, sans sourciller : elle est fragile. J’ose espérer qu’il existe encore un certain nombre de voix, en France, prêtes à porter un discours de vérité et de liberté. Il est plus que temps.