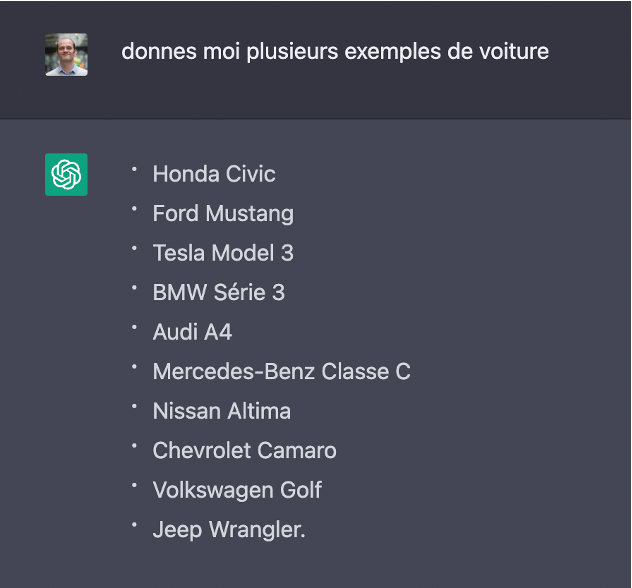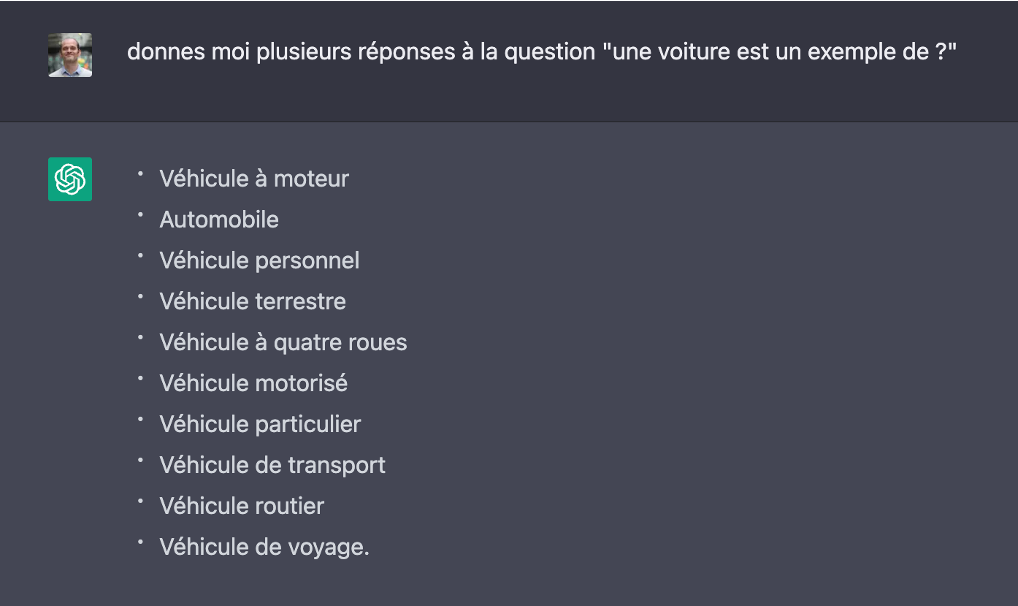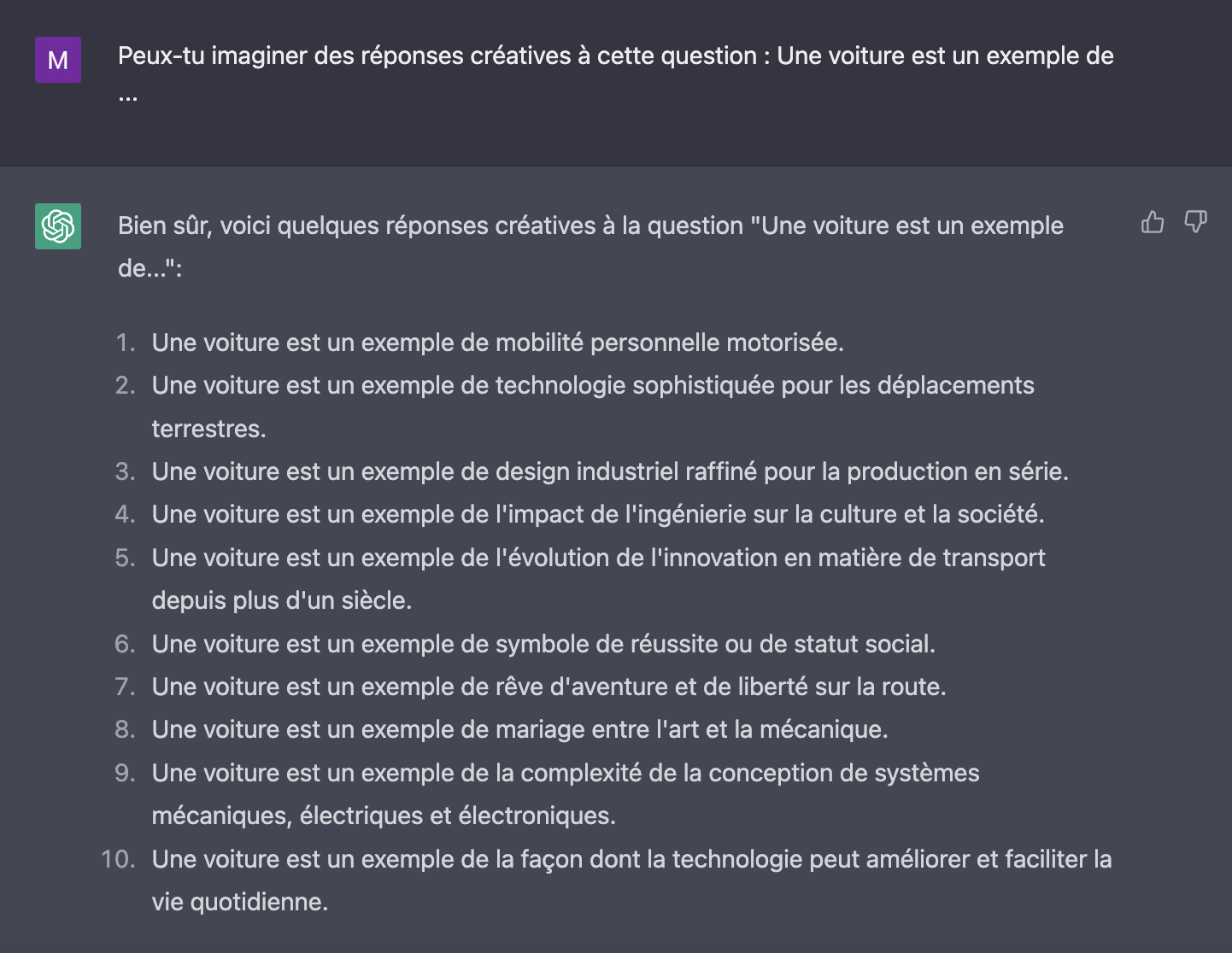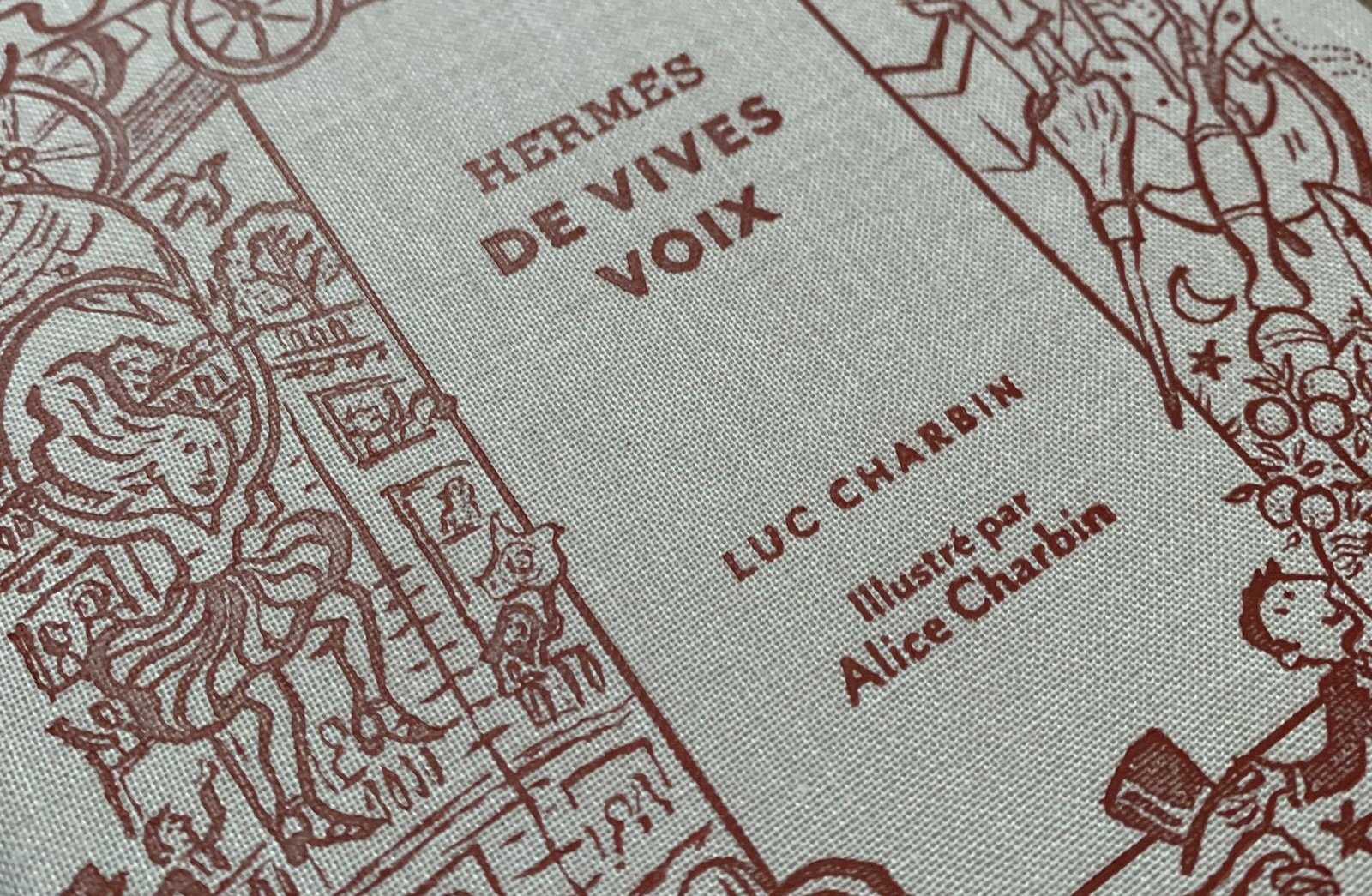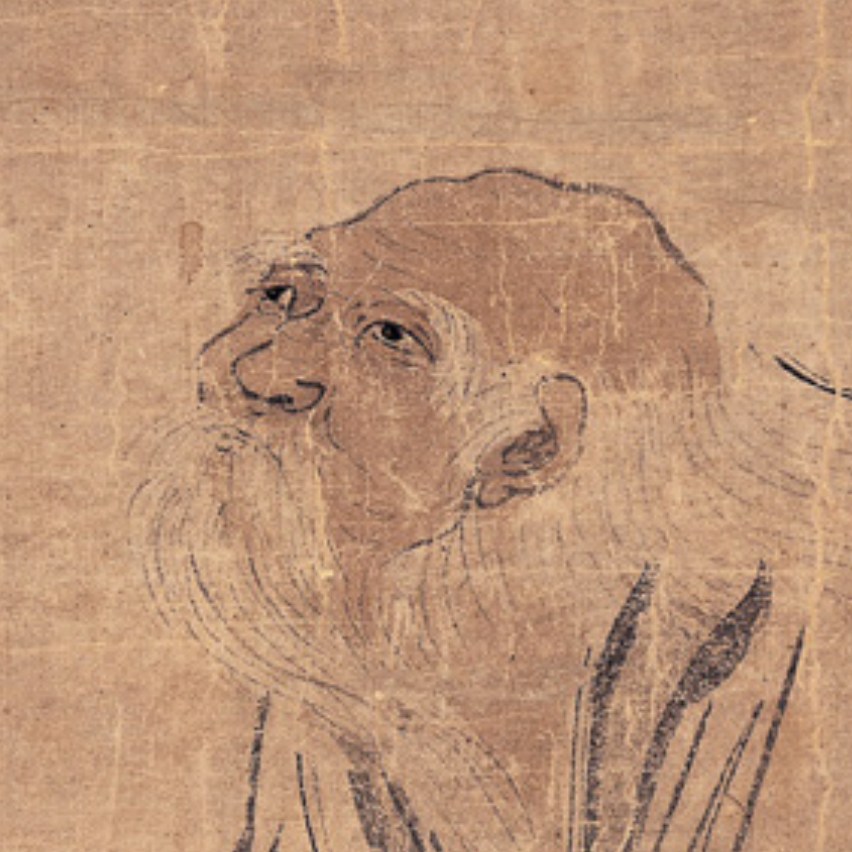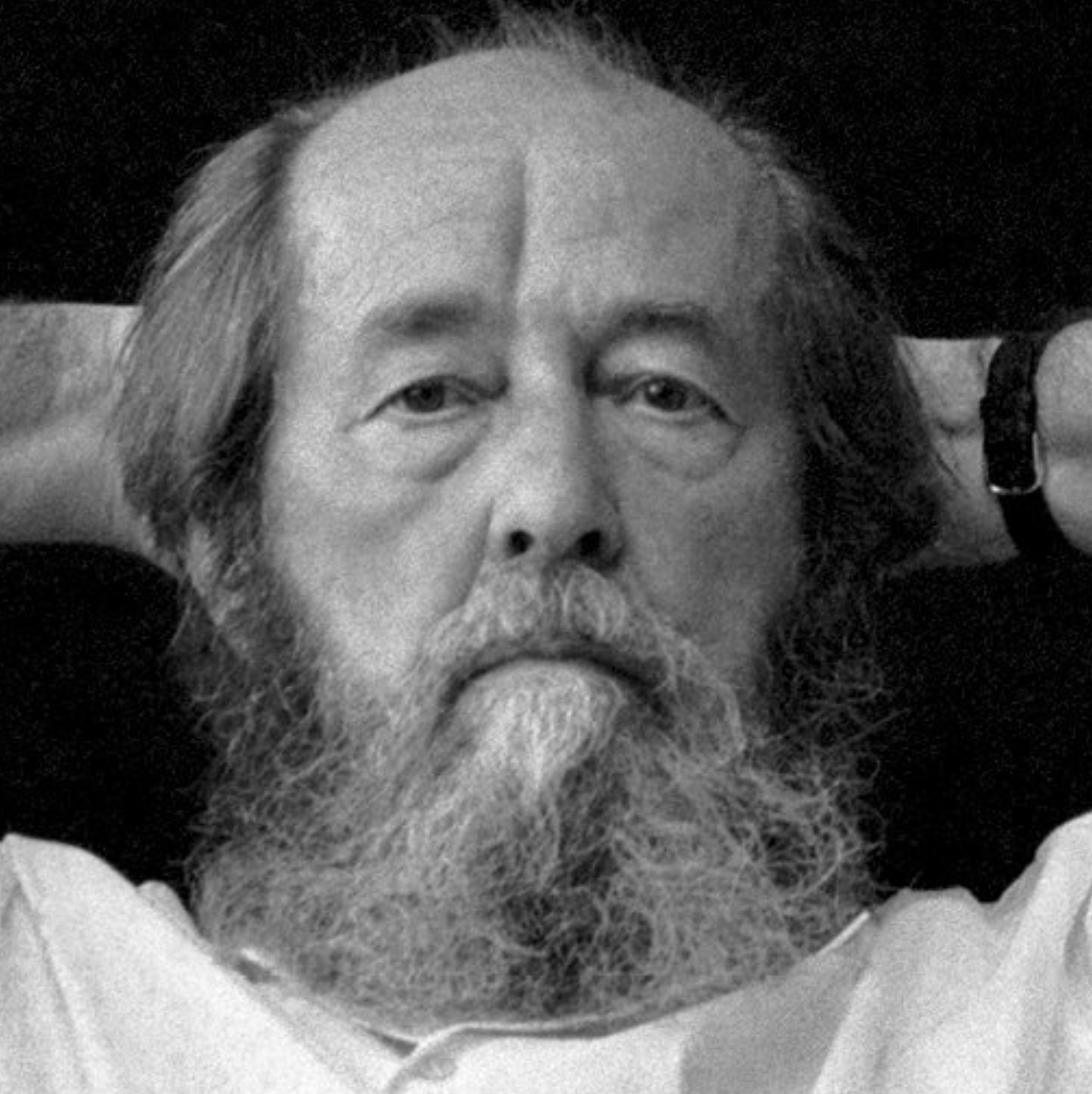Chantal Delsol a publié il y a quelques mois « La fin de la chrétienté ». Comment se constate la fin de la Chrétienté ? Quels en sont les ressorts moraux et philosophiques ? Quelles perspectives ? C’est à ces questions que Chantal Delsol répond dans ce court essai, stimulant, sobre mais érudit, qui force à prendre de la hauteur.
Inversion normative
Considérant les 16 siècles de la Chrétienté (du IVè siècle jusqu’à nos jours), l’auteur y soutient la thèse que nous sommes arrivé un moment d’inversion normative pour notre civilisation. Tout comme le christianisme a fait son essor en inversant certaines normes morales (passage du paganisme au christianisme), nous sommes en train de vivre une autre inversion morale. En partie parce que la religion chrétienne n’a plus l’envie de régner (c’est cela la fin de la Chrétienté : la fin de l’ère où les institutions politiques sont organisées autour, et appuyées sur, des valeurs morales chrétiennes et en lien avec les institutions religieuses), et en partie par le jeu de forces externes à la religion.
Quelle est cette inversion normative que nous sommes en train de vivre et que Chantal Delsol voit comme le marqueur de la fin de la chrétienté ? Elle concerne les normes de conduites : les différentes « lois sociétales » montrent un univers moral où la liberté est devenue folle et considérant que tout ce que la technique peut, nous pouvons le faire au nom de libre détermination de chacun. Une sorte d’auto-nomie désincarnée, sans limites. Mais tout cela n’est que le fruit, et le signe, de « l’inversion ontologique » plus large et profonde que Delsol décrit : nous sortons du monothéisme pour aller vers une forme paganisme, polythéisme, ou cosmothéisme. Moïse avait fait passer son peuple du polythéisme au monothéisme, et nous vivons, depuis plus d’un siècle, une autre inversion qui nous fait sortir du monothéisme. On pourrait se demander s’il s’agit d’une « inversion », ou d’une « évolution » ? Comme le rappelait Larmore :
Dieu est si grand qu’il n’a pas besoin d’exister. Cela est l’essence du processus de sécularisation qui a si profondément influencé la société moderne. Le reniement des idoles, le respect pour la transcendance de Dieu sont ce qui a conduit à relever Dieu de la fonction d’expliquer l’ordre de la nature et le cours de l’histoire. Expliquer quelque chose par l’action divine ou la Providence revient toujours à mettre Dieu parmi les causes finies que nous avons déjà découvertes ou que nous pouvons imaginer. Dès lors que nous nous résolvons à laisser Dieu être Dieu, nous ne pouvons plus utiliser Dieu à nos fins cognitives.
Rapport contemporain à la Vérité
Chantal Delsol décrit comment le régime de vérité n’est plus le même. En quittant la chrétienté, et l’exclusivisme judéo-chrétien du rapport à la vérité, le rapport religieux à la transcendance, nous n’abandonnons pas la vérité, nous sommes simplement dans un autre régime de vérité. La vérité « révélée » n’a plus de sens, mais la vérité a toujours un sens, qui vient en partie du paradigme scientifique : est vrai ce qui est correspond au réel. Elle ajoute à juste titre que nous avons maintenant un rapport syncrétique à la vérité, pluraliste, agnostique et plus humble :
Autrement dit : ce qui peut nous permettre de renouer le lien entre l’histoire et la vérité, ce n’est ni la dogmatique du vrai (théories du Progrès ou des Droits de l’homme rigidifiés), ni l’oubli du vrai (mythes postmodernes), mais plutôt la clandestinité du vrai, qui fait de sa recherche une quête humble et spirituelle, jamais définitive.
Honnêteté et sagesse
Elle se présente comme catholique traditionaliste, mais sait prendre le point de vue d’autres qu’elle. Elle décrit bien, par exemple, en quoi les humains rejettent les « autres » mondes des religions :
Sous le cosmothéisme, l’homme se sent chez lui dans le monde, qui représente la seule réalité et qui contient à la fois le sacré et le profane. Sous le monothéisme, l’homme se sent étranger dans ce monde immanent et aspire à l’autre monde – c’est bien par exemple ce que Nietzsche reprochait aux chrétiens. Pour le monothéisme, ce monde n’est qu’un séjour. Pour le cosmothéiste, il est une demeure. L’esprit postmoderne est fatigué de vivre dans un séjour ! Il lui faut une demeure bien à lui, entière dans ses significations. Il redevient cosmothéiste parce qu’il veut réintégrer ce monde comme citoyen à part entière, et non plus comme cet « étranger domicilié », ce chrétien décrit par l’anonyme de la Lettre à Diognète. Il veut à présent se trouver à son aise dans le monde immanent dont il fait partie intégrante, sans avoir besoin de rêver ou de tisser ou d’espérer un autre monde, qui le laisse séparé de lui-même. Il veut vivre dans un monde autosuffisant qui contienne son sens en lui-même – autrement dit : un monde enchanté, dont l’enchantement se trouve à l’intérieur et non dans un au-delà angoissant et hypothétique.
Le terme cosmothéisme n’est pas tout à fait juste, car l’esprit de cette « anthropologie moniste » n’est ni une négation de la transcendance, ni un refuge dans une ridicule divinisation de la nature. C’est, à nouveau, une approche, qui est la mienne, qui sait se contenter du chemin vers la vérité sans vouloir sauter des étapes et prétendre connaître ce qu’on ne connait pas. Le seul « monisme » là-dedans, c’est une affirmation qu’il n’existe qu’une réalité, et que l’on peut en avoir une approche pluraliste sans devenir superstitieux. La complexité du réel est suffisamment incroyable pour nous éviter d’avoir besoin de saupoudrer notre rapport au monde de croyances absurdes.
Il me semble qu’elle met le doigt sur un élément essentiel aussi en montrant que nos contemporains rejettent également l’esprit de conquête.
Mais surtout : loin de vouloir conquérir le monde, dorénavant, comme les juifs, nous allons nous préoccuper de vivre et survivre – et ce sera déjà bien assez. Fouillez partout, et vous ne trouverez plus nulle part de rêve de mission et de conquête – et même si parfois ils existent dans le secret de certains coeurs, ils n’osent pas se dire. Au fond, beaucoup de chrétiens sont soulagés de voir s’éteindre la Chrétienté avec tout ce qu’elle supposait de force et d’hypocrisie. Nous sommes tous, chrétiens ou non, les enfants de cette époque : préférant la douceur à la domination, l’imperfection assumée à la fanfaronnade.
Chantal Delsol est d’une grande sagesse, car elle montre le réel, et ce qui arrive, sans le regarder ni avec crainte ni avec nostalgie, mais en souligant ce que cela rend possible, d’un point de vue spirituel. Elle pose dans ce magistral essai le début de la réflexion sur le christianisme sans la chrétienté.
Vous pouvez aller l’écouter sur l’excellente chaîne TV libertés : Chantal Delsol interviewée.