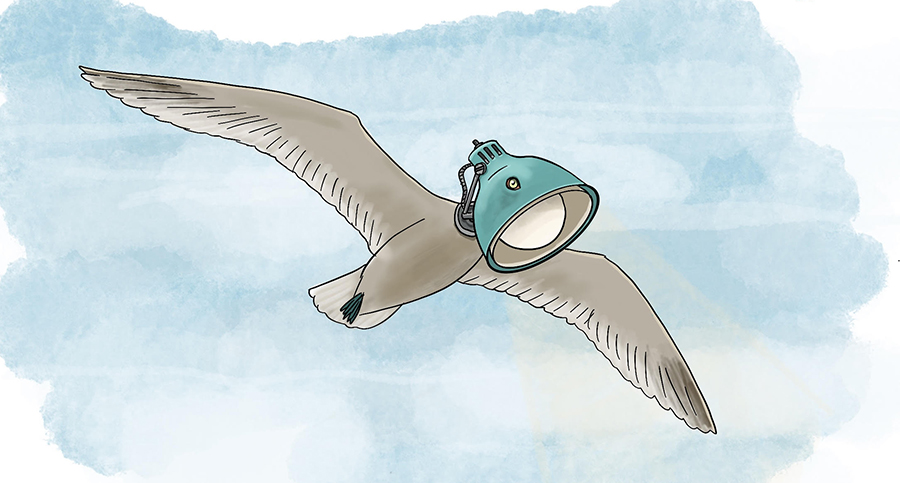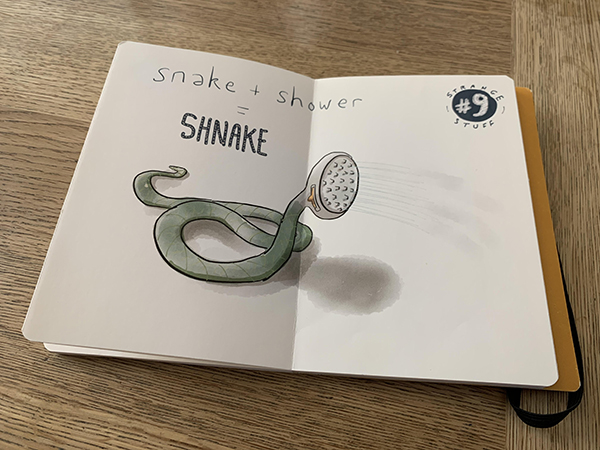J’ai décidé de lire ce livre parce que plusieurs citations de La Bruyère m’avaient frappées par la qualité de la langue que l’on pouvait y lire. Et en découvrant l’histoire de ce livre, on ne peut qu’avoir envie de s’y plonger : La Bruyère, après avoir traduit l’ouvrage « Caractères » du grec Théophraste, y ajoute pas moins de 420 maximes (il a mis 17 ans à les écrire), et puis passe le reste de sa vie à faire des mises à jour. Pour la dernière édition (la neuvième), qui est publiée de manière posthume, il n’y a pas moins de 1200 éléments (maximes, réflexions, portraits) qui prennent place dans 16 chapitres. C’est le seul ouvrage de La Bruyère. Et c’est un livre incontournable pour découvrir à la fois l’esprit et le style du XVIIème en France.
Etudes de moeurs
Le sous-titre du livre, à juste titre, est « Les Moeurs de ce siècle ». La Bruyère en effet, discute, dissèque, analyse, critique, loue, admire une seule chose, qui est sa matière : les comportements de ses semblables. Et il les regarde en moraliste. Son programme est explicite :
Je rends au public ce qu’il m’a prêté ; j’ai emprunté de lui la matière de cet ouvrage : il est juste que, l’ayant achevé avec toute l’attention pour la vérité dont je suis capable, et qu’il mérite de moi, je lui en fasse la restitution. Il peut regarder avec loisir ce portrait que j’ai fait de lui d’après nature, et s’il se connaît quelques-uns des défauts que je touche, s’en corriger. C’est l’unique fin que l’on doit se proposer en écrivant, et le succès aussi que l’on doit moins se promettre ; mais comme les hommes ne se dégoûtent point du vice, il ne faut pas aussi se lasser de leur reprocher : ils seraient peut-être pires, s’ils venaient à manquer de censeurs ou de critiques ; c’est ce qui fait que l’on prêche et que l’on écrit. L’orateur et l’écrivain ne sauraient vaincre la joie qu’ils ont d’être applaudis ; mais ils devraient rougir d’eux-mêmes s’ils n’avaient cherché par leurs discours ou par leurs écrits que des éloges ; outre que l’approbation la plus sûre et la moins équivoque est le changement de moeurs et la réformation de ceux qui les lisent ou qui les écoutent. On ne doit parler, on ne doit écrire que pour l’instruction ; et s’il arrive que l’on plaise, il ne faut pas néanmoins s’en repentir, si cela sert à insinuer et à faire recevoir les vérités qui doivent instruire.
Brillant et … moderne
La lecture des Caractères est facile, car le style est brillant. Certaines pensées surprennent par leur modernité, d’autres paraissent plus datées. Toutes méritent lecture, par le témoignage qu’elles représentent d’une époque. J’en suis à la moitié des Caractères. C’est un livre de chevet parfait : on peut aisément le prendre, lire quelques passages, puis le refermer le temps de lire un autre ouvrage.
On pourrait dire, s’il fallait faire une légère critique, que La Bruyère peut parfois, c’est probablement un trait de l’époque, se laisser emporter, par amour de la forme et du style, dans des pensées dont l’esthétique formelle indéniable masque à peine la faiblesse logique.
Mais il reste, la plupart du temps, d’une grande intelligence des rapports humains, et un très fin observateur des comportements. La Bruyère, sociologue avant l’heure, porte un regard réflexif sur toute chose, autant sur les faits qu’il observe que sur son propre travail, et il est à ce titre un auteur moderne: le fait même de mêler style et propos, langage et raisonnement, a été analysé par Roland Barthes comme une marque de prise de recul critique par rapport aux idées, aux intrications de la forme et du fond, propre à la modernité.
Pour La Bruyère, être écrivain, c’est croire qu’en un certain sens le fond dépend de la forme, et qu’en travaillant et modifiant les structures de la forme, on finit par produire une intelligibilité particulière des choses, une découpe originale du réel, bref un sens nouveau : le langage est à lui tout seul une idéologie.(Roland Barthes)