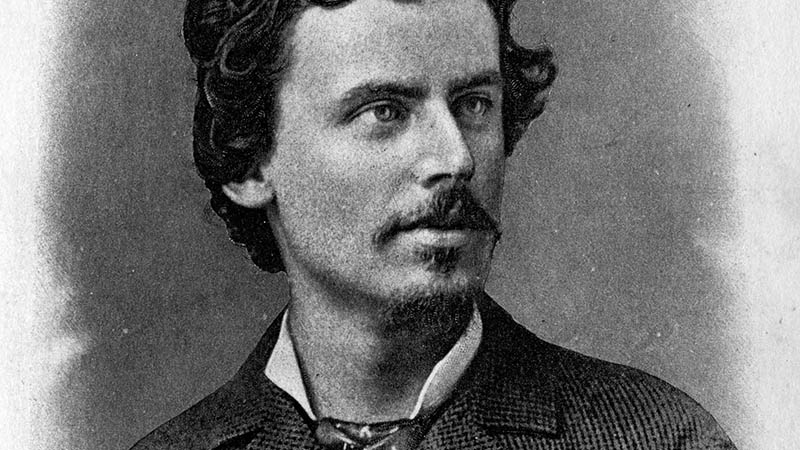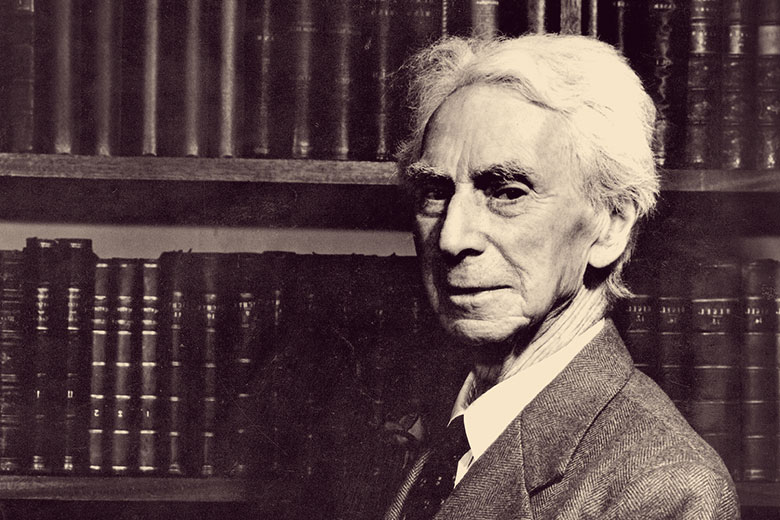Pendant un an, Michel Lallement, chercheur au CNAM, est allé s’immerger dans les hackerspaces de la Silicon Valley. Impressionnante plongée dans un monde « middleground » (voire underground), et dans l’univers d’idéalistes (?) qui veulent changer le rapport au travail, le rapport à la technique, et y remettre de la passion, du Faire, et de la liberté. Le sous-titre du livre L’âge du Faire: hacking, travail, anarchie.
C’est quoi un hackerspace ?
C’est quoi un hackerspace, ou un makerspace, ou encore un hacklab ? C’est un lieu de travail, opéré par une communauté qui se retrouve autour d’un intérêt commun pour l’informatique, la science, la technologie, le prototypage, les arts digitaux. Et pour la fabrication (au sens large : faire des choses), le « Faire« . Le hacking est à distinguer du cracking. Le hacker est un bidouilleur qui cherche à créer des choses, à détourner des objets de leurs usages initiaux, là où le craker est un pirate – informatique le plus souvent-, qui cherche à voler des données, à casser, et au final à agir hors-la-loi. Le livre s’intéresse à ceux qui peuplent les hackerspaces, majoritairement des hackers.
Passionnante immersion chez les makers
Michel Lallement signe un ouvrage très facile à lire, passionnant et très immersif. Nous sommes vraiment plongés, grâce à son talent de narrateur, dans ces lieux étonnants et bigarrés. Il a choisi de se concentrer sur Noisebridge, et aussi fricoté un peu avec des membres de BioCurious et HackerDojo. Tout un vocabulaire, un jargon presque, et qui peut être très nouveau, arrive avec cette immersion. Les hackers construisent ce que les crakers détruisent. Le Hacker bidouille pour construire.
A Noisebridge, on découvre la manière de fonctionner très particulière de ces « communautés », et les problèmes qu’ils ont à gérer au quotidien. Leur règle d’or ? « Be excellent to each other ». Leur manière de gérer ? Une réunion hebdomadaire ouverte à tous, animée et structurée, qui permet de décider par consensus collectif, des orientations/décisions à prendre. Exigeant, complexe inutilement parfois, mais très socialisant.
La plongée historique dans les racines de ces hackerspaces est passionnante aussi. Le fondateur de Noisebridge, Mitch Altman, a été notamment très influencé par le Chaos Computeur Club allemand.
Ce livre est à lire, à mon sens, par tous ceux qui de près ou de loin sont intéressés par l’essor de ce type de lieux, que ce soit à l’intérieur des entreprises, ou dans la société civile sous des formes associatives ou commerciales (comme les Techshop, le FabClub ou Usine.io par exemple). C’est pour ça que le livre s’est retrouvé sur le sommet de la pile : nous sommes en train, avec Mickaël Desmoulins, mon binôme/compagnon d’aventure, – et avec toute une communauté ! – d’accompagner/penser la mise en place d’un lieu de ce type à l’intérieur de l’entreprise dans laquelle nous travaillons. C’est passionnant, et aussi inconfortable, puisque nous devons en permanence apporter des éléments de compréhension de la valeur d’un tel dispositif, tout en étant en train de le découvrir nous-mêmes, et de maintenir dans ses gènes une forte capacité à l’adaptation permanente, à l’apprentissage.
Réflexions et critiques
Je voudrais livrer ici quelques réflexions que le livre a pu provoquer/susciter/prolonger. J’ai une conscience très nette du peu de structuration de ces réflexions, comparées aux apports de Michel Lallement dans son bouquin. Disons que je voudrais éclairer son travail de chercheur par un apport de praticien expérimentateur. Et partager quelques doutes aussi (c’est pas marrant sinon).
Une chose frappante dans la comparaison implicite entre NoiseBridge et le Creative People Lab que nous animons, c’est la similitude. C’est normal, puisque nous nous sommes inspirés en partie des FabLab et des hackerspaces pour imaginer notre lieu/communauté, et ses modes de fonctionnement. Nous avons également eu la chance de croiser la route de Nicolas Bard et d’ICI Montreuil, pour des échanges et pour des formations. Et il y a aussi, c’est naturel, des différences, puisque les contraintes et le contexte d’un hackerspace ne sont pas exactement ceux d’un « fablab/hackerspace interne ».
Rapport au travail
Le fondement des tiers-lieux de type hackerspace ou FabLab, c’est d’abord et avant tout le volontariat, la libre participation. C’est une excellente et très frugale manière de s’assurer que les membres sont a minima engagés et curieux. Et qu’ils trouvent dans le travail un peu de plaisir. Cette libre participation garantie au même titre une forme assez solide d’ouverture, et de brassage permanent des personnes, des compétences.
Il y a ensuite une volonté commune d’apprendre et de faire. D’apprendre pour soi, d’apprendre aux autres, de partager. Et de faire : ne pas rester dans le monde des idées, mais se confronter au réel, toucher du doigt certaines technos, apprendre par des projets concrets.
Tout cela dessine un rapport au travail particulier, très bien analysé par Michel Lallement, qui se déplace du travail « hétéronome » vers le travail « autonome ». La manière d’en discuter de Michel Lallement, citant André Gorz, puis Habermas, me laisse plus dubitatif. Je ne pense pas, et ne crois pas vraiment, au travail « qui trouve en lui-même sa propre finalité ». C’est une vue d’intellectuel, très belle sur le papier, mais qui me semble manquer un certain nombre de motivations humaines, de nécessités humaines.
La reconnaissance par les pairs, également, tient une place plus importante que les médailles décernées par les chefs comme « rétribution sociale ». Ces simples mécanismes de reconnaissance par les pairs suffisent il me semble à prouver que le travail n’est jamais uniquement une fin en soi.
Mode d’organisations
Horizontal, communautaire et consensuel, le mode d’organisation privilégie le consensus et la doOcratieEn terme d’organisation, les hackerspaces secouent les puces de la manière de faire des entreprises « classiques ». Très horizontal, communautaire et consensuel, le mode d’organisation privilégie le consensus (intense) et la do-ocratie (soumise à la régle du « Be excellent to each other ») : la doocracy, qu’est-ce que c’est ? Une structure organisationnelle dans laquelle les individus choisissent librement leurs rôles et leurs tâches et les exécutent. Est légitime et responsable celui qui fait, pas celui qui a un titre ou une fonction.
Il nous reste à inventer le mode de fonctionnement durable de ce genre de choses dans une entreprise, mais on voit bien que ça fait sens dans toutes fonctions connexes à l’innovation. Logique d’agilité, de créativité et de connexion entre les gens, et les entités, porosité entre l’interne et l’externe, logique de test&learn.

Critiques … constructives
Je redis tout le bien que je pense de l’ouvrage de Michel Lallement ; agréable à lire, riche, éclairant, documenté, c’est vraiment pour le lecteur une belle immersion dans un univers nouveau à plein d’égards. J’ai deux petites critiques à formuler. L’une concerne la grille d’analyse des motivations des membres, l’autre le choix du terrain.
Sur la lecture des motivations des membres, il me semble que l’analyse de Michel Lallement se retrouve à certains moments en pleine contradiction, ce qu’il note très honnêtement, mais sans prendre conscience que la contradiction n’est que le fruit d’un cadre d’analyse relativement teinté d’anti-capitalisme. En effet, il n’y a pas de contradiction à vouloir travailler autrement, y compris sur les modalités de rétribution, à vouloir faire évoluer l’existant, à y réinjecter des valeurs un peu différentes, ET le fait de s’insérer dans une logique d’économie libérale.
Vouloir faire croire que le fait de créer une communauté d’intérêt serait déjà en soi un acte de « contre-culture » vis-à -vis du capitalisme est un contre sens absolu.Le libéralisme et le capitalisme n’excluent en aucune manière des actions désintéressées économiquement, et ne sont pas des pensées qui font la promotion d’une sorte d’individualisme exacerbé, obsédé par les gains financiers. Si des dérives ont eu lieux, elles ne sont pas à mon sens des raisons de jeter le bébé avec l’eau du bain. Les libéraux historiques ont toujours défendu la libre association, les syndicats, et liberté des humains de s’organiser comme bon leur semble. Après, les humains restent des humains, et il leur faut bien être responsables de leurs actes. Si je veux travailler librement sur des sujets qui me plaisent, et orientés uniquement par moi, il faudra bien quand même je trouve de quoi manger. Et donc inventer un business model (mécénat, dons, participations, création d’entreprise lucrative, etc…) qui me permettra de concilier toutes mes exigences. Les hackers sont à la même enseigne que les autres humains.
Vouloir faire croire que le fait de créer une communauté d’intérêt serait déjà en soi un acte de « contre-culture » vis-à -vis du capitalisme est un contre sens absolu. Mais nous avons tellement pris l’habitude que tout le monde parle du libéralisme et du capitalisme (sans savoir ce que c’est) comme s’il s’agissait de monstreuses idéologies que nous ne prenons plus la peine de le noter. Je dois être un peu rigide pour ne pas vouloir tomber dans le mainstream « anticapitaliste » et « antilibéral » (antilibéral=totalitaire?). Pour le dire plus directement, on peut très bien s’épanouir dans un lieu de type hackerspace, sans pour autant rejeter la société capitaliste/libérale. Pourquoi le faudrait-il ?
Nous arrivons à la deuxième « critique ». Je comprends pourquoi Michel Lallement a choisi Noisebridge comme terrain d’étude. C’est un des plus emblématiques des hackerspaces, porté par des gens vraiment charismatiques, très idéalistes, et cela permet d’aller toucher certaines racines des motivations, et du système alternatif qui est proposé. Mais il y a une logique de « pureté » qui me dérange un peu là -dedans : un hackerspace dont l’objectif serait d’avoir un business model viable, ne reposant pas forcément sur le mécénat et les dons, et ne visant pas forcément à transformer de manière radicale la société, n’est-il pas aussi un hackerspace ? Ma réponse, clairement, est oui. Et je dirais même plus : Noisebridge tourne presque en vase clos dans l’under/middle ground, là où d’autres sont plus riches en termes de croisement hétéroclites (ce qui est un gage de richesse en termes de créativité, il me semble). Faire le pont, la traduction entre des univers différents, me semble être aussi un des éléments apportés par de tels lieux/communautés. Ce qui se passe aux interstices entre les différents éco-systèmes est toujours utile à penser et à observer.
Ce ne sont là que des critiques – mineures – de quelqu’un qui a vraiment aimé le bouquin : le livre est tellement bien, que je suis frustré de ne pas pouvoir lire une autre immersion dans un autre espace et une autre communauté. Vite : la suite !
Quelques doutes et questions ouvertes
Tout cette plongée dans Noisebridge m’a passionné. Les valeurs portées par les membres me touchent. La charte de Noisebridge est à ce titre exemplaire et tape très fort : Vision.
Je suis en phase avec ces idéalistes qui veulent avoir de la joie au travail. Comment penser autrement une activité dans laquelle on investit du temps et de l’énergie ? J’ai souvent le sentiment de porter cette manière de vivre son travail au sein de notre Lab interne, et qu’elle trouve un écho chez les membres de notre communauté. Et même temps, je mesure la chance que j’ai, et le décalage avec le reste du mode de fonctionnement de l’entreprise. Il nous reste à réussir à faire le pont entre deux mondes, celui de l’exploration, de la créativité, du « potentiel » mis en place sans garantie de succès, et le monde de l’exploitation, des KPI, des résultats qui doivent tomber à date fixe, des comptes à rendre. Comment faire ce pont sans perdre ce qui fait la force d’un lieu très ouvert comme celui-là ? A-t-il à terme une chance d’exister à l’intérieur de l’entreprise, et transformer sa culture, ou serait-il plus pertinent en dehors des contraintes habituelles ? L’ambidextrie organisationnelle est-elle possible ? Certaines entreprises ont imaginé des structures de ce type à l’extérieur, pour de bonnes raisons aussi (Ilab d’AirLiquide, Big de Pernod-Ricard). Questions passionnantes, et ouvertes. Comme tout ce qui est passionnant. Nous avons choisi de faire exister ce hackerspace, ce « garage » – le Creative People Lab – DANS l’entreprise, et avec les mêmes visées de formation, et de partage créatif que les hackerspaces. C’est en rupture, c’est plutôt nouveau ; et c’est aussi ce qui est passionnant.