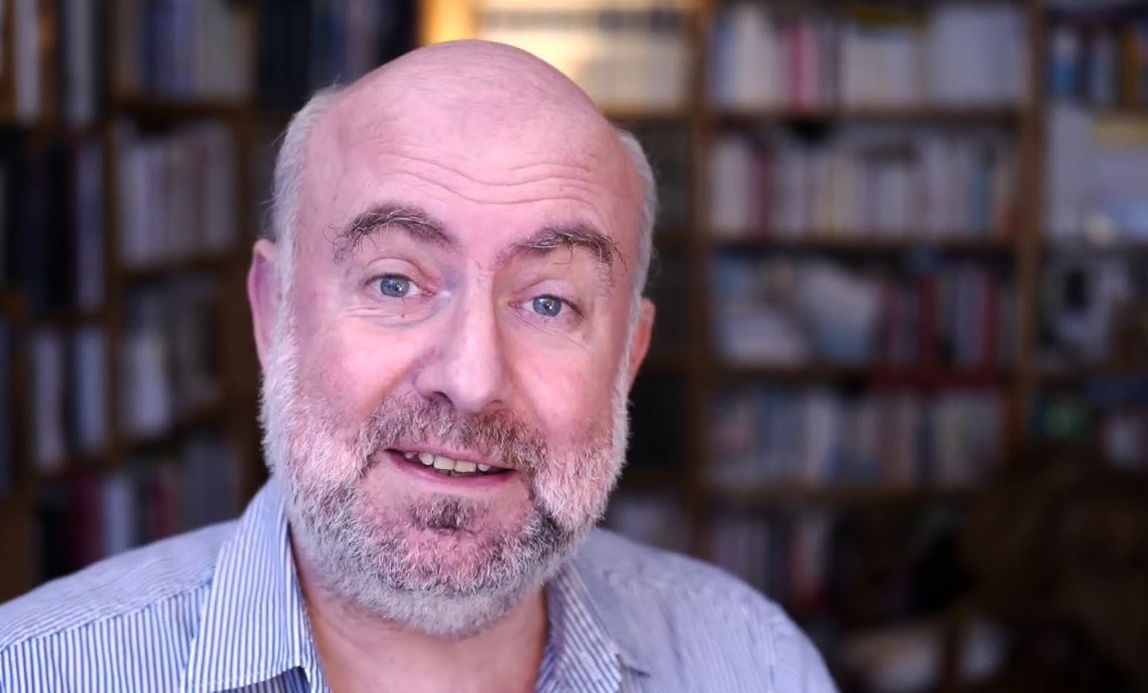J’ai lu « L’empire du moindre mal » de Jean-Claude Michéa, parce que des amis à moi, tendance « catho-conservateurs », me l’avaient conseillé. Ils y ont trouvé une critique juste et pertinente du libéralisme. En tant que libéral, il me paraissait utile de prendre connaissance de cette pensée ; en tant qu’ami, il me paraissait indispensable de mieux comprendre les arguments avancés dans les discussions.
Brillant et structuré
Il faut préciser tout d’abord que cet ouvrage est brillant, dans son style – érudit, clair, documenté – et dans son ambition : s’attaquer au « libéralisme », c’est tout de même ambitieux, parce que le corpus philosophique associé est assez robuste, et ancré dans un certain nombre d’institutions, de règles, et même dans notre morale. Michéa, contrairement à d’autres détracteurs du libéralisme, présente par ailleurs, saluons son honnêteté sur ce point-là, des arguments des libéraux eux-mêmes (qu’il semble avoir lu) : Bastiat, Smith, et quelques autres.
Et l’ouvrage est fort car il présente des arguments en cours chapitres, dont le détail de l’argumentation, des exemples, est renvoyé en annexe de chaque chapitre. Cela facilite la compréhension, et ménage deux niveaux de lecture. Le propos commence très bien avec une mise en perspective historique de l’essor du libéralisme comme un moyen de sortir des conflits et des guerres civiles en sortant d’une société « morale » (qui porte un contenu moral positif), et en entrant dans des sociétés libérales s’appuyant uniquement sur des mécanismes de régulation des actions humaines (en gros, le Droit et le Marché).
oui, mais …
Le problème, c’est que c’est le même argumentaire que celui de Comte-Sponville, réfuté par Pascal Salin (et par d’autres, par exemple le brillant Philippe Silberzahn) : le capitalisme n’est pas amoral, car il repose sur le respect d’un certain nombre de choses qui sont des affirmations morales fortes. Respect des droits individuels, respect de la parole donnée et des contrats, refus de l’arbitraire, etc. Il faut être très idéologue pour ne voir dans le libéralisme qu’une non-morale.
De même, cette neutralité axiologique supposée des sociétés libérales est une simplification extrême de la réalité. Certes l’Occident a fait émerger les sociétés démocratiques et libérales sur la base d’une socle plus restreint de valeurs, mais ce socle n’est pas nul. Larmore y a consacré quelques très belles pages.
Jean-Claude Michéa déplore l’absence de limites consubstantielle au libéralisme (position conservatrice que je partage) : comment peut-on caricaturer ainsi la pensée libérale ? On se demande s’il les a lu, au final. Il n’a visiblement lu ni Von Mises, ni Hayek qui sont les penseurs majeurs du libéralisme au XXème. C’est une critique justifiée du libéralisme, sous certaines de ses formes, mais le manque de nuance fait perdre de la force à son argument. Quand on commence par caricaturer, pour pouvoir mieux attaquer ensuite, c’est de la mauvaise rhétorique, du sophisme (l’Epouvantail pour être précis). C’est de bonne guerre mais peu rigoureux…
Il me semble, enfin, que dans l’esprit de Michéa il y a une confusion entre progressisme et libéralisme : une simple considération du Modèle d’Arnold Kling11. Il s’agit d’un découpage en trois pôles : progressiste, conservateur et libéral. Chacun portant une part des idées et valeurs politiques suffit à le montrer. En fait, Michéa est un vrai conservateur, et il simplifie en mettant tous ses « adversaires » dans le même panier. Logique de conflit, pas de philosophie.
Où sont les propositions ?
Que met-il en avant ? Ses critiques de la société actuelles, même si je n’en partage pas les causes, sont justifiées. Mais quelles sont les pistes de solutions qu’il met en avant ? Aucune, au sens propre du terme. Et je pense que c’est en partie lié à son analyse incomplète des causes. Sa posture anarcho-conservatrice (oui ça existe) me semble un peu rigide, et j’aurais voulu qu’au moins il mette en avant les valeurs positives (païennes?) de son point de vue (pour reprendre la description de Berlin : « les valeurs essentielles [païennes ]sont le courage, l’énergie, la force d’âme devant l’adversité, la réussite dans les affaires publiques, l’ordre, la discipline, le bonheur, la force, la justice. ») et en tire les conséquences sociales. Un livre fort, donc, mais à mon sens, un peu trop à charge contre des adversaires pas tout à fait bien définis.