On devrait toujours relire les excellents ouvrages : c’est bien d’ailleurs ce que désigne l’expression « livre de chevet ». C’est ce que je suis en train de faire avec deux d’entre eux en ce moment, dont l’extraordinaire « L’action humaine », de Ludwig Von Mises11. Lien wikipedia : faites attention à la qualité des informations que vous pouvez y trouver, notamment celles ayant des résonnances politiques.. Il est extraordinaire tant par l’ampleur du propos (fonder la science économique / praxéologie, ou science de l’action humaine), que par le style incroyablement clair, synthétique tout en étant d’une grande précision conceptuelle. C’est la deuxième fois que je le lis, et je suis déjà à peu près sûr que je le relirai un jour (j’en avais déjà parlé ici : Pas d’excuses : deux grands livres gratuits)
Mon propos ici n’est pas de vous en donner une synthèse, mais plutôt de vous demander de me faire aveuglement confiance : achetez le livre, ou téléchargez-le, lisez les 50 ou 100 premières pages et dites moi si vous pouvez arrêter la lecture. Sachez simplement qu’il y est question de l’action humaine, et de la science qui étudie cette action. Von Mises pose au début du livre les bases épistémologiques et conceptuelles permettant de distinguer la praxéologie des autres sciences (sciences naturelles, psychologie, histoire). C’est-à-dire qu’il précise des éléments de méthode et des caractéristiques propres à l’économie ou praxéologie. Individualisme méthodologique, caractère formel et aprioriste, notions de valeur, de catallaxie (notion reprise par son élève Hayek). C’est absolument passionnant.
Pour donner une idée de son style, je recopie ici un long passage où il explique le caractère aprioristique de la praxéologie.
Les relations logiques fondamentales ne sont pas susceptibles de preuve ou de réfutation. Tout essai pour les prouver doit s’appuyer implicitement sur leur validité. Il est impossible de les expliquer à un être qui ne les posséderait pas pour son propre compte. Les efforts pour les définir en se conformant aux règles de définition ne peuvent qu’échouer. Ce sont des propositions premières, antécédentes à toute définition nominale ou réelle. Ce sont des catégories ultimes, non analysables. L’esprit humain est totalement incapable d’imaginer des catégories logiques autres que celles-là. Sous quelque forme qu’elles puissent apparaître à d’hypothétiques êtres surhumains, elles sont pour l’homme inéluctables et absolument nécessaires. Elles sont la condition première et indispensable de la perception, de l’aperception, et de l’expérience. (…)
L’esprit humain n’est pas une table rase sur laquelle les événements extérieurs écrivent leur propre histoire. Il est équipé d’un jeu d’outils pour saisir la réalité. L’homme a acquis ces outils, c’est-à-dire la structure logique de son esprit, au cours de son évolution depuis l’amibe jusqu’à son état actuel. Mais ces outils sont logiquement antérieurs à toute expérience quelconque. L’homme n’est pas simplement un animal, entièrement soumis aux stimuli déterminant inéluctablement les circonstances de sa vie. Il est aussi un être qui agit. Et la catégorie de l’agir est logiquement antécédente à tout acte concret.
Le fait que l’homme n’ait pas le pouvoir créateur d’imaginer des catégories en désaccord avec les relations logiques fondamentales et avec les principes de causalité et de téléologie nous impose ce que l’on peut appeler l’apriorisme méthodologique.
Tout un chacun dans sa conduite quotidienne porte témoignage sans cesse de l’immutabilité et de l’universalité des catégories de pensée et d’action. Celui qui adresse la parole à ses semblables, qui désire les informer et les convaincre, qui interroge et répond aux questions d’autrui, peut se comporter de la sorte uniquement parce qu’il peut faire appel à quelque chose qui est commun à tous — à savoir la structure logique de l’esprit humain. L’idée que A puisse être en même temps non-A, ou que préférer A et B puisse être en même temps préférer B à A, est simplement inconcevable et absurde pour un esprit humain. Nous ne sommes pas en mesure de comprendre une sorte quelconque de pensée prélogique ou métalogique. Nous ne pouvons penser un monde sans causalité ni téléologie. Il n’importe pas à l’homme qu’il y ait ou non, au-delà de la sphère accessible à l’esprit humain, d’autres sphères où existe quelque chose qui diffère, par ses catégories, du penser et de l’agir humains. Nulle connaissance ne parvient de ces sphères à un esprit humain. Il est oiseux de demander si les choses-en-soi sont différentes de ce qu’elles nous apparaissent, et s’il y a des mondes que nous ne pouvons comprendre et des idées que nous ne pouvons saisir. Ce sont des problèmes hors du champ de la cognition humaine. Le savoir humain est conditionné par la structure de l’esprit humain. S’il choisit l’agir humain comme objet de ses études, il ne peut avoir en vue que les catégories de l’action qui sont propres à l’esprit humain et sont la projection de cet esprit sur le monde extérieur en changement et devenir. Tous les théorèmes de la praxéologie se réfèrent uniquement à ces catégories de l’action et sont valides seulement dans l’orbite où elles règnent. Ils ne prétendent fournir aucune information sur des mondes et des relations dont nul n’a jamais rêvé et que nul ne peut imaginer.
(….)
Le raisonnement aprioristique est purement conceptuel et déductif. Il ne peut rien produire d’autre que des tautologies et des jugements analytiques. Toutes ses implications sont logiquement dérivées des prémisses et y étaient déjà contenues. Donc, à en croire une objection populaire, il ne peut rien ajouter à notre savoir.
(…)
Tous les théorèmes géométriques sont déjà impliqués dans les axiomes. Le concept d’un triangle rectangle implique déjà le théorème de Pythagore. Ce théorème est une tautologie, sa déduction aboutit à un jugement analytique. Néanmoins, personne ne soutiendrait que la géométrie en général et le théorème de Pythagore en particulier n’élargissent nullement notre savoir. La connaissance tirée de raisonnements purement déductifs est elle aussi créatrice, et ouvre à notre esprit des sphères jusqu’alors inabordables. La fonction signifiante du raisonnement aprioristique est d’une part de mettre en relief tout ce qui est impliqué dans les catégories, les concepts et les prémisses ; d’autre part, de montrer ce qui n’y est pas impliqué. Sa vocation est de rendre manifeste et évident ce qui était caché et inconnu avant. Dans le concept de monnaie, tous les théorèmes de la théorie monétaire sont déjà impliqués. La théorie quantitative n’ajoute rien à notre savoir qui ne soit contenu virtuellement dans le concept de monnaie. Elle transforme, développe, ouvre à la vue ; elle ne fait qu’analyser et, par là, elle est tautologique comme l’est le théorème de Pythagore par rapport au concept de triangle rectangle. Néanmoins, personne ne dénierait sa valeur cognitive à la théorie quantitative. A un esprit qui n’est pas éclairé par le raisonnement économique, elle reste inconnue.
Et vous, quels sont vos livres de chevet ? Ceux que vous avez déjà relu, et que probablement vous relirez encore ?
Résultats de recherche pour « hayek »
-

L’action humaine
-

L’empire du moindre mal
J’ai lu « L’empire du moindre mal » de Jean-Claude Michéa, parce que des amis à moi, tendance « catho-conservateurs », me l’avaient conseillé. Ils y ont trouvé une critique juste et pertinente du libéralisme. En tant que libéral, il me paraissait utile de prendre connaissance de cette pensée ; en tant qu’ami, il me paraissait indispensable de mieux comprendre les arguments avancés dans les discussions.
Brillant et structuré
Il faut préciser tout d’abord que cet ouvrage est brillant, dans son style – érudit, clair, documenté – et dans son ambition : s’attaquer au « libéralisme », c’est tout de même ambitieux, parce que le corpus philosophique associé est assez robuste, et ancré dans un certain nombre d’institutions, de règles, et même dans notre morale. Michéa, contrairement à d’autres détracteurs du libéralisme, présente par ailleurs, saluons son honnêteté sur ce point-là, des arguments des libéraux eux-mêmes (qu’il semble avoir lu) : Bastiat, Smith, et quelques autres.
Et l’ouvrage est fort car il présente des arguments en cours chapitres, dont le détail de l’argumentation, des exemples, est renvoyé en annexe de chaque chapitre. Cela facilite la compréhension, et ménage deux niveaux de lecture. Le propos commence très bien avec une mise en perspective historique de l’essor du libéralisme comme un moyen de sortir des conflits et des guerres civiles en sortant d’une société « morale » (qui porte un contenu moral positif), et en entrant dans des sociétés libérales s’appuyant uniquement sur des mécanismes de régulation des actions humaines (en gros, le Droit et le Marché).oui, mais …
Le problème, c’est que c’est le même argumentaire que celui de Comte-Sponville, réfuté par Pascal Salin (et par d’autres, par exemple le brillant Philippe Silberzahn) : le capitalisme n’est pas amoral, car il repose sur le respect d’un certain nombre de choses qui sont des affirmations morales fortes. Respect des droits individuels, respect de la parole donnée et des contrats, refus de l’arbitraire, etc. Il faut être très idéologue pour ne voir dans le libéralisme qu’une non-morale.
De même, cette neutralité axiologique supposée des sociétés libérales est une simplification extrême de la réalité. Certes l’Occident a fait émerger les sociétés démocratiques et libérales sur la base d’une socle plus restreint de valeurs, mais ce socle n’est pas nul. Larmore y a consacré quelques très belles pages.C’est un acquis irrévocable du libéralisme politique que le sens de la vie est un sujet sur lequel on a une tendance naturelle et raisonnable, non pas à s’accorder, mais à différer et à s’opposer les unes aux autres. De là , l’effort libéral pour déterminer une morale universelle, mais forcément minimale, que l’on puisse partager aussi largement que possible en dépit de ses désaccords.Jean-Claude Michéa déplore l’absence de limites consubstantielle au libéralisme (position conservatrice que je partage) : comment peut-on caricaturer ainsi la pensée libérale ? On se demande s’il les a lu, au final. Il n’a visiblement lu ni Von Mises, ni Hayek qui sont les penseurs majeurs du libéralisme au XXème. C’est une critique justifiée du libéralisme, sous certaines de ses formes, mais le manque de nuance fait perdre de la force à son argument. Quand on commence par caricaturer, pour pouvoir mieux attaquer ensuite, c’est de la mauvaise rhétorique, du sophisme (l’Epouvantail pour être précis). C’est de bonne guerre mais peu rigoureux…
Il me semble, enfin, que dans l’esprit de Michéa il y a une confusion entre progressisme et libéralisme : une simple considération du Modèle d’Arnold Kling11. Il s’agit d’un découpage en trois pôles : progressiste, conservateur et libéral. Chacun portant une part des idées et valeurs politiques suffit à le montrer. En fait, Michéa est un vrai conservateur, et il simplifie en mettant tous ses « adversaires » dans le même panier. Logique de conflit, pas de philosophie.Où sont les propositions ?
Que met-il en avant ? Ses critiques de la société actuelles, même si je n’en partage pas les causes, sont justifiées. Mais quelles sont les pistes de solutions qu’il met en avant ? Aucune, au sens propre du terme. Et je pense que c’est en partie lié à son analyse incomplète des causes. Sa posture anarcho-conservatrice (oui ça existe) me semble un peu rigide, et j’aurais voulu qu’au moins il mette en avant les valeurs positives (païennes?) de son point de vue (pour reprendre la description de Berlin : « les valeurs essentielles [païennes ]sont le courage, l’énergie, la force d’âme devant l’adversité, la réussite dans les affaires publiques, l’ordre, la discipline, le bonheur, la force, la justice. ») et en tire les conséquences sociales. Un livre fort, donc, mais à mon sens, un peu trop à charge contre des adversaires pas tout à fait bien définis.
-
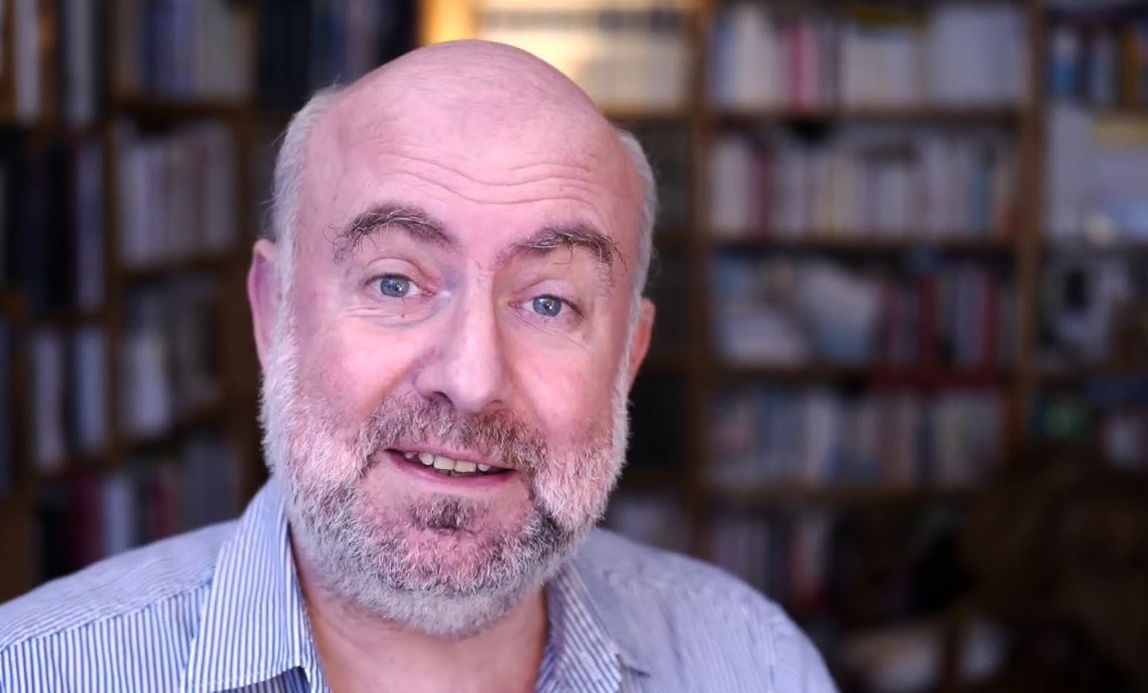
Sécession
Le dernier ouvrage d’Eric Verhaeghe, « Sécession », est sous-titré « Manuel d’auto-défense contre la caste ». Eric Verhaeghe est – entre autres – animateur du site Le Courrier des Stratèges, et fin analyste du monde contemporain. J’ai découvert Eric Verhaeghe au moment de la « crise Covid » car c’est une des rares personnes à avoir gardé la tête froide, à s’opposer au matraquage systématique opéré par la dite « caste », et à continuer à vouloir regarder les faits, à rester exigeant sur notre conception – humaniste, libérale – de la société. C’est un sujet qui m’a pas mal (pré)-occupé, et qui continue de le faire par ce qu’il a révélé de fragilités dans ce qu’on appelle l’état de droit.
Un livre passionnant
C’est un bel ouvrage, passionnant, très direct et pédagogique que ce « Sécession ». Capable à la fois d’embrasser très large, et ensuite de redescendre au plus près des détails opérationnels concrets, il est à ce titre tout à fait typique des livres de penseurs attachés à la réalité (j’avais eu la même sensation, dans un tout autre registre, en lisant le dernier Finkielkraut « L’après littérature »). Eric Verhaeghe y décrit donc, de manière précise, sans rechigner à prendre de la hauteur, ce qu’est la sécession. Mais avant cela, il précise dans l’introduction les raisons de sa nécessité.
Pourquoi faire sécession ?
Partant du constat que les sociétés occidentales ont dérivé vers une situation de très forte dépendance à la consommation, comme un drogue, il expose en quoi une « caste » (dirigeants des états, certains grands patrons, les médias) voit une convergence d’intérêt assez nette pour garder le pouvoir en encourageant cette dépendance. Cela rejoint la théorie du Great Reset de Klaus Schwab, conduisant à un « capitalisme » de surveillance généralisée, adossé une gouvernance mondiale étatiste brimant ce qui fait la beauté de notre civilisation : la liberté. J’ai mis des guillemets à « capitalisme », car ce projet d’essence socialiste et totalisant (sinon totalitaire) n’a pas grand-chose à voire, à mon sens, avec le capitalisme.
Face à cette poussée étatiste, qui est d’essence autoritaire et même totalitaire, seule la sécession permet de recouvrer des marges de liberté et d’éviter le naufrage collectif qui se profile (p. 30)
Qu’est ce que la sécession ?
Je copie ici un long extrait car il dit bien et le style et l’esprit du livre.
Il faut toutefois préciser ici ce qu’il faut entendre par sécession. Littéralement, la sécession est un acte de séparation entre deux entités « morales ». Ce mot a été utilisé dans des contextes différents, qui expriment tous la volonté de ne plus vivre dans un même pays. Par exemple, la République Tchèque et la Slovaquie ont fait sécession en 1993.
Mais nous n’utilisons pas la sécession dans ce sens-là. Nous préferons lui accorder un sens social et spirituel, sur le modèle de la « secessio plebis », la sécession de la plèbe sur l’Aventin, au Ve siècle avant Jésus-Christ, à Rome. À cette époque, et par deux fois en quelques décennies, le petit peuple de Rome s’était retiré sur la colline de l’Aventin pour ne plus frayer avec l’aristocratie.
Les prolétaires, pourrait-on dire, les premiers de corvée en quelque sorte, n’avaient pas trouvé de meilleur moyen pour faire progresser leurs revendications. En l’espèce, ils réclamaient un allègement du fardeau fiscal, notamment foncier, qui pesait sur eux. C’était la condition qu’ils mirent à leur enrôlement dans l’armée pour aider les chevaliers dans la guerre contre les tribus voisines.[…]
D’une certain façon, notre ambition est d’exposer ici les principaux moyens de réaliser une sécession à l’heure de la civilisation numérique. On ne peut plus, comme dans la Rome antique (et a fortiori comme dans la Rome naissante, qui était une bourgade) penser la sécession comme une concentration du peuple sur une colline, défiant l’aristocratie. Géographiquement, cette séparation n’aurait pas de sens, ni aucune possibilité de réussir. En revanche, il est possible d’entamer une sécession sociétale, en refusant d’adopter les codes, les usages, les principes, les valeurs, véhiculés par la caste mondialisée, ou instrumentalisés par elle, et en adoptant des codes et des valeurs alternatives. C’est ce processus global que nous entreprenons de décrire ici, non de façon exhaustive, mais en donnant des pistes que chacun pourra approfondir et adapter selon ses besoins.Il la décline de manière très concrète sur les plans fiscaux, politiques, sociaux, éducatifs, etc. Les conseils de sécession de Verhaege sont très pratiques, sur tous les registres. Le livre sonne très juste à beaucoup d’endroits, un brin parano à d’autres (mais c’est probablement moi qui suis naïf, c’est un trait de mon caractère).
Difficile vérité
J’ai été sensible au fait que l’auteur mentionne l’école autrichienne d’économie et les penseurs qui peuvent y être associés (Bastiat, Von Mises, Hayek) : c’est probablement l’école philosophique et politique dont je me sens le plus proche.
La fin du livre me semble la plus intéressante, quand il traite des différents degrés de sécession, de la résistance passive, jusqu’à la sédition si les circonstances l’imposent. Les dernières phases que nous avons vécus pendant ces dernières années résonnent avec ces réflexions : quand les dirigeants ne défendent plus nos intérêts, quand la gabegie est généralisée (donc le vol et la corruption officiels), il convient d’avoir en tête l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :Art. 2. – Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.
Le livre sonne si juste, et pose des questions si dérangeantes (parce qu’engageant notre manière de vivre), que je ne trouve pas mieux pour décrire mon sentiment à la lecture que cette citation de Churchill :

Les hommes trébuchent parfois sur la vérité, mais la plupart se redressent et passent vite leur chemin comme si rien ne leur était arrivé.
Winston Churchill (1874-1975) homme d’Etat britannique.
Suite…
Pour finir, en soulignant à nouveau, à mon sens, l’importance de ce livre passionnant, je vous invite à regarder l’interview d’Eric Verhaeghe sur l’excellente chaîne d’info TVLibertés :
-

John Stuart Mill, libéral utopique
Camille Dejardin, docteur en science politique et professeur agrégée de philosophie, vient de publier aux Editions Gallimard « John Stuart Mill, libéral utopique » (sous-titré Actualité d’une pensée visionnaire (coll. Bibliothèque des idées, 2022), essai qui prolonge sa thèse de doctorat dévolue à la redécouverte de la théorie politique millienne. C’est un livre remarquablement bien écrit, d’une grande clarté conceptuelle, et – bien sûr – on ne peut plus expert sur la pensée de John Stuart Mill.
Biographie intellectuelle
Car Camille Dejardin s’intéresse uniquement aux idées, et dresse dans cet ouvrage un panorama très complet de la pensée de Mill. Elle n’y glisse que les éléments biographiques qui éclairent le parcours intellectuel de Mill. Il est à souligner que son enfance et sa formation, et sa vie, sont tout à fait hors du commun. L’auteur commence l’ouvrage avec un thèse simple mais tout à fait juste : Mill, souvent associé à l’utilitarisme parce son père était un adepte de Bentham, penseur central du libéralisme, est un auteur qui dépasse largement ces étiquettes tant son génie a embrassé largement tous les sujets, avec une honnêteté et une exigence impressionnante, en gardant toujours à l’esprit la vue d’ensemble sans jamais perdre ni le goût des détails, ni le sens de la nuance. Un vrai penseur du réel, en quelque sorte.
La démarche de John Stuart Mill (1806-1873), pourtant communément connu comme « utilitariste » et « libéral » canonique, en est on ne peut plus éloignée. Et son génie est d’avoir su allier la modernité d’une conception globalement matérialiste, agnostique et pragmatique, s’émancipant des traditions tout en demeurant ouverte à une pluralité de métaphysiques, avec une exigence de transcendance et même, pourrait-on dire, une exigence d’exigence qui anticipe et préempte à bien des égards les écueils sur lesquels l’utilitarisme, l’économicisme et le libéralisme des deux derniers siècles nous ont jetés.Camille Dejardin illustre fort à propos l’ouverture d’esprit et le goût de l’échange de Mill par une liste incroyable :
Il faut (…) saluer la prouesse, tant linguistique et intellectuelle et que proprement humaine, que constituent la relation et l’abondante correspondance qu’il réussit à entretenir avec des interlocuteurs aussi hétéroclites que Thomas Carlyle, Edwin Chadwick, Alexander Bain (qui devint l’un de ses biographes), John Austin, Thomas Hare, Herbert Spencer, Florence Nightingale, Gustave d’Eichthal, Alexis de Tocqueville, Auguste Comte et jusqu’à Jules Michelet et Louis Blanc (pour ces quatre derniers, dans un français parfait), aux côtés de nombreux autres parlementaires, juristes et publicistes britanniques ou étrangers.Penseur complet de la démocratie moderne, et de la vie bonne
L’ouvrage dans sa première partie revient sur la pensée riche et complexe de Mill, qui prend à la fois le meilleur du socialisme, du conservatisme et du libéralisme (en donnant une primauté à ce dernier). La deuxième partie explicite le titre « Utopie libérale », en montrant comment Mill a toujours réfléchi, à partir du réel, à proposer une meilleure organisation sociale, une meilleure société, en insistant toujours sur les ressorts individuels. C’est une sorte d’ »aristo-démocratie » qu’il définit ainsi, tout en réfléchissant aux conditions d’existence de celle-ci (notamment l’éducation), et aux limites qu’il convient de fixer à l’action humaine. Sur certains de ces points, je me trouve moins en accord avec Mill, mais cela reste incroyable de voir qu’il a, comme Tocqueville, prévu une grande partie des problématiques que le développement des sociétés libérales allaient provoquer, et auxquelles nous sommes confrontés.
Religion de l’humanité
Il a également réfléchi sur le besoin de spiritualité et a proposé une sorte de « religion de l’humanité » qui assumerait la nécessité de formes de transcendance et de sacré, sans sortir pour autant du champ de la rationnalité. Passionnant. Je ne résiste pas, comme Camille Dejardin, à citer ce passage de Mill, tiré de Utility of Religion :
[il s’agit d’instaurer] une moralité fondée sur une appréhension large et avisée du bien du tout, ne sacrifiant ni l’individu au collectif ni le collectif à l’individu, mais reconnaissant leur juste place respectivement au devoir et à la liberté et la spontanéité. Elle s’enracinerait dans les natures supérieures grâce à la sympathie, à la bienveillance et à la passion pour l’idéal d’excellence, et dans les autres grâce aux mêmes sentiments, cultivés et encouragés à la hauteur de leurs capacités, ainsi qu’à la force supplémentaire de la honte. Cette moralité exaltée ne tirerait pas son autorité de quelque espoir de récompense ; au contraire, la récompense qui serait ainsi recherchée, et la pensée qui constituerait une consolation dans les épreuves et un soutien dans les moments de faiblesse, ce ne serait pas la perspective problématique de l’existence future, mais l’approbation, dans tout cela, de ceux que nous respectons et idéalement de tous ceux, vivants ou morts, que nous admirons et révérons. […] Appeler ces sentiments du nom de « moralité », à l’exclusion de tout autre titre, est leur faire trop peu d’honneur. Ils sont véritablement une religion, de laquelle, comme pour toute autre, les bonnes oeuvres manifestes (habituellement entendues sous le nom de moralité) ne représentent qu’une partie, et constituent plutôt les fruits que la religion elle-même. L’essence de la religion est la direction forte et sincère des émotions et des désirs vers un objet idéal, reconnu comme excellence suprême devant légitimement primer sur tous les objets de désirs plus égoïstes. Cette condition est remplie par la Religion de l’Humanité à un degré équivalent et dans un sens aussi profond quand les religions surnaturelles dans ce qu’elles ont de meilleur, et même d’avantage à d’autres égards.Cela rejoint une autre piste de lecture qui m’attend dans ma pile (Hermann Cohen).
Excellent ouvrage
J’ai tout de même eues quelques petites frustrations à la lecture. L’auteur montre, par quelques petites références à des discussions actuelles en s’appuyant sur des auteurs contestables, son appartenance à la gauche politique, et sort de son rôle de passeur. Rien de grave – c’est son droit le plus strict, surtout dans le cadre d’un essai – mais cela montre ses limites. Voir les noms de Piketty, Stiglitz ou Pierre Rabhi est surprenant dans le cadre de cet essai (quid de Bastiat, et Hayek – qui est celui qui a oeuvré pour regrouper et faire connaitre l’oeuvre de Mill?). Tout comme de voir quelques approximations sur les relations de cause à effet concernant la fécondité (que l’on retrouvait d’ailleurs aussi dans Le monde sans fin), ou une confusion entre régulation et réglementation. Tout cela n’est pas bien grave : il est logique que l’auteur fasse résonner la pensée de Mill avec ses propres aspirations et positions, c’est le propos de son livre. Mill est un penseur très actuel. Et je partage son avis. Je la remercie d’avoir, avec autant de clarté, proposé un voyage assez complet dans l’oeuvre foisonnante de Mill. Le livre est bourré de citations de Mill que je vais ajouter à ma collection personnelle. Un très bon ouvrage, rigoureux, citant toujours les sources, et apportant un regard passionnant sur un auteur non moins passionnant ! Sa conclusion personnelle est magnifique, je trouve, et j’en utilise un extrait pour lui laisser le mot de la fin :
Mais contre le repli sur soi pouvant mener à la soumission conformiste et court-termiste au monde comme il va, Mill nous rappelle que se donner sa propre loi revient toujours à se mettre en rapport avec une loi supérieure – politique ou morale. Dans cette perspective, l’individu « souverain de lui-même » ne l’est donc jamais sans référentiel, sans repères, sans bornes. Ce sont eux, au contraire, qui donnent sens et donnent chair à sa souveraineté. S’il veut oeuvrer pour lui-même, tout un chacun doit apprendre à se penser comme partie prenante d’une « chose commune » qui garantit sa liberté et qui vit en retour de l’exercice constructif de celle-ci.Je vais aller maintenant écouter cette conférence de Camille Dejardin, que j’ai tenu à ne pas découvrir avant d’écrire cette recension.
Cet article a été publié dans le magazine L’incorrect de novembre 2022, et sur le site : Purgatoire terrestre -

Platon a rendez-vous avec Darwin
Dans Platon a rendez-vous avec Darwin, le haut fonctionnaire Vincent Le Biez signe un bel essai en forme de cabinet de curiosités : stimulant, riche, et varié, mais manquant de structure et de profondeur.
Rencontre(s) entre les sciences et la politique
La thèse du livre, exposée explicitement dans le dernier chapitre, est claire et puissante :
Si les méthodes utilisées pour étudier les systèmes physiques et sociaux diffèrent largement et ne sont pas facilement transposables, les systèmes eux-mêmes partagent certaines caractéristiques communes du fait de leur complexité, par conséquent, la connaissance des systèmes naturels complexes offre des intuitions intéressantes concernant l’organisation des systèmes politiques et sociaux.Mobilisant des connaissances très variées, tant scientifiques que philosophiques, Vincent Le Biez, jeune haut fonctionnaire, se livre à un brillant exercice de style, structuré autour de couples de penseurs. Chaque chapitre rapproche les pensées d’un scientifique et d’un philosophe ou penseur politique : Sadi Carnot se retrouve ainsi apparié avec Hannah Arendt, Ernst Ising avec Alexis de Tocqueville, ou encore Platon avec Darwin. Sur ce dernier exemple, la théorie de l’évolution du scientifique anglais, qui montre que les êtres vivants évoluent, et que cette évolution n’est pas le fruit d’un dessein, est mise en opposition avec la pensée de Platon où, au contraire, l’ordre des choses, statique, répond à un dessein et à volonté de perfection. Riche discussion, seulement esquissée dans l’essai, sur la téléonomie, le finalisme, et les différentes conceptions du monde. Ce livre est d’autant plus stimulant qu’il expose avec clarté et maîtrise la pensée d’auteurs nombreux, tant en sciences qu’en philosophie politique.
Manque de rigueur et d’audace
Il se dégage pourtant de la lecture une sensation de papillonnage, et d’une pensée qui part dans tous les sens. Sous la brillance intellectuelle, on se retrouve avec des idées somme toute assez peu originales, ce qui n’est du reste pas anormal, car les hybridations intellectuelles aux interstices des disciplines n’ont pas attendues Vincent Le Biez pour être faites. Il y a par ailleurs quelques raccourcis dans la manière dont la pensée des auteurs est retranscrite. Hayek, par exemple, n’a jamais pris « l’ordre spontané » pour la « valeur suprême ». Hayek plaçait la liberté au-dessus de tout, et l’ordre spontané est simplement un phénomène qu’il a grandement contribué à caractériser, notamment ses conditions d’existences. La méthode analogique utilisée a les défauts de ses qualités : riche en intuition, stimulante, mais conduisant souvent à des choses peu rigoureuses. Et si les théories scientifiques sont bien exposées, les idées des philosophes ou penseurs politiques le sont de manière un peu plus légère.
Par ailleurs, pourquoi l’auteur éprouve-t-il le besoin de se cacher derrière ces analogies scientifiques pour livrer son point de vue politique ? Il n’y a pas besoin de passer par la théorie des membranes pour redire, en le citant, ce que Claude Lévi-Strauss avait déjà analysé à propos des limites au mélange entre des cultures différentes. L’approche alternative proposée par l’auteur, à la suite de Prigogine et Bertalanffy, montre ses limites. Une approche visant à pouvoir tout marier, une sorte d’en même temps philosophique. Une synthèse dont la « neutralité » serait garantie par son origine scientifique. Vincent Le Biez explique que cette approche partage des choses avec tous les courants de pensée, du socialisme au conservatisme en passant par le libéralisme, l’écologie politique ou le progressisme.Une pensée politique qui fait l’impasse sur le conflit
C’est oublier un peu vite que les humains ne sont pas des molécules, et les sociétés sont des systèmes complexes pas comme les autres. Les humains attachent dans leur réflexion, et dans leur appréhension de l’ordre politique et social, une importance cruciale à la notion de vérité. Une composante qui semble avoir été un peu vite écartée par l’auteur, dans son mouvement d’équilibriste centriste (compréhensible pour un haut-fonctionnaire en poste) : Les vérités, en politique, s’affrontent la politique est aussi le lieu du conflit, et de choses, d’idées, qui s’excluent mutuellement. Les vérités, en politique, s’affrontent. Le socialisme n’est pas compatible avec libéralisme, pas plus que le progressisme avec le conservatisme. Faire coexister dans la société ces approches et pensées divergentes, avec tolérance, en assumant d’avoir des adversaires politiques, c’est le génie de la démocratie occidentale. Mais cette coexistence ne fait pas disparaître les différents et les conflits profonds entre ces courants de pensée. Sans conflit d’idées, sans désaccords, la pensée politique n’est qu’une soupe tiède politiquement correcte.
Cette recension a d’abord été publiée sur le site du magazine L’incorrect (lien). Je les remercie d’avoir bien voulu publier ce modeste article, et de leur confiance.
-

Eloge de la discrimination
La provocation du titre n’est qu’apparente, et j’espère qu’à la fin de ce billet, vous serez d’accord pour dire que nous devons faire l’éloge de la discrimination.
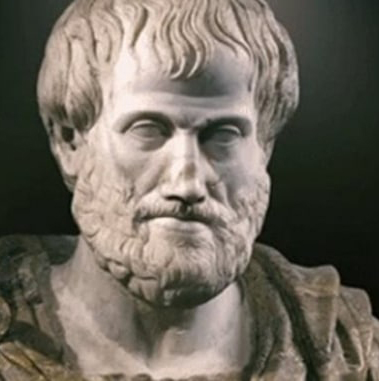
La plus grande injustice est de traiter également les choses inégales.
Aristote (384 – 322) philosophe grec
Ce billet, un peu long, progressera en 4 temps :
- le mot ”discrimination », en français comporte deux sens très différents. Nous reviendrons sur chacuns de ces acceptions
- la confusion entre les deux sens, entretenue par une pensée Égalitariste, conduit à confondre égalité de fait et égalité devant la loi, et à voir des actes injustes là où il n’y en a pas.
- pour illustrer ces confusions, nous regarderons en détail un cas pratique : la discrimination à l’embauche
- il existe un moyen simple de trier entre le légitime et l’illégitime : il consiste à allier respect strict de la liberté d’action individuelle, et tolérance.
Discrimination, un mot ambivalent
Le terme discrimination recouvre deux sens très différents.
Discriminer c’est distinguer
Le premier historiquement et étymologiquement, et probablement le seul légitime, est synonyme de distinction. Discriminer, c’est distinguer ce qui est différent, en vue ou non d’un traitement séparé. Discriminer, dans ce premier sens, est donc l’acte de séparer, de distinguer, de différencier. C’est donc un acte normal de l’intelligence qui observe le réel et s’y confronte : telle essence de bois n’a pas les mêmes caractéristiques que telle autre, telle personne m’est agréable et telle autre non, etc..
Discriminer c’est porter atteinte à l’égalité devant la loi
Le second sens, apparu avec cette connotation dans les années 1950, est péjoratif : il désigne la discrimination appliquée à des humains que l’on va, en fonction de tel ou tel critère, traiter différemment. Ce deuxième sens fait partie des choses que nous devons combattre, quand il s’agit de discriminations instituées (par une coutume ou par la loi). Nous sommes donc confrontés à un mot qui dans un cas décrit un acte moralement juste, et dans l’autre cas un acte moralement condamnableCe second sens désigne donc une pratique humaine jugée moralement répréhensible, en tout cas par toute personne attachée à l’égalité devant la loi. En gros, les démocraties libérales ont depuis un certain temps déjà mis en place des règles qui sont les mêmes pour tous. C’est le sens de la déclaration universelle des droits de l’homme, et des systèmes juridiques des Etats de droit.
Ces deux sens du mot ”discrimination » sont donc très différents. Si l’un est une activité naturelle de l’esprit humain qui analyse, sépare, différencie, l’autre est une pratique collective choquante, qui refuse aux citoyens l’égalité devant la loi (qu’elle soit la loi coutumière ou le droit positif).
Ce n’est pas par hasard que la symbolique judiciaire utilise depuis le XIIIe siècle une figure de la mythologie grecque, Thémis, sous les traits d’une femme aux yeux bandés, symbolisant l’impartialité. Le meilleur moyen de juger justement, c’est de ne pas savoir qui je juge. C’est un beau symbole des lois identiques pour tous.
Nous sommes donc confrontés à un mot qui dans un cas décrit un acte moralement juste, et dans l’autre cas un acte moralement condamnable. Voyons donc les types de confusions que cela peut induire.Confusion entre égalité de fait et égalité devant la loi
Conséquence : voir partout des discriminations
Il y a plusieurs risques avec ces deux sens compris dans le même mot. Le premier consiste à faire déborder le premier sens, l’acte de distinguer, sur le second et à ”justifier » des injustices. Le second qui est à mon avis beaucoup plus présent, et qui est l’objet de ce billet, consiste à faire déborder le second sens, traitement différent devant la loi, vers le premier et à systématiquement voir dans l’acte de ”séparer ce qui est différent » une injuste discrimination. Parce que le deuxième sens est évidemment négatif, quand il conduit à des inégalités devant la loi, nous avons peu à peu perdu l’usage positif du premier sens du mot (synonyme de distinction, et simplement un des modes de fonctionnement de la pensée humaine). Ce qui signifie que dans un certain nombre de cas nous ne pensons plus, et nous réagissons de manière réflexe en condamnant des discriminations qui n’en sont pas, ou qui sont des discriminations légitimes (celles correspondant au premier sens c’est-à -dire à un humain exerçant sa rationalité critique).
Il me semble que cette manie de voir d’injustes discriminations partout est le fruit d’un parti pris idéologique que l’on pourrait appeler l’égalitarisme. C’est-à -dire une confusion entre l’égalité devant la loi, et l’égalité de fait.Que signifie l’égalité dans notre devise ?
L’égalité devant la loi me semble tout à fait souhaitable et en accord avec l’idée de justice. L’égalité de fait – une situation identique pour tous – , si l’on y réfléchit bien, est une forme de totalitarisme. Ce totalitarisme égalitariste trouve ses racines dans le communisme. Pour atteindre une égalité de fait entre les gens, qui sont inégaux par leur naissance, leurs qualités, leur environnement, leur éducation, leur parcours, il faudrait mettre en place un système qui traite, devant la loi, inégalement les gens. Ce qui revient à brider certains et à aider d’autres. Il me semble que cette manie de voir d’injustes discriminations partout est le fruit d’un parti pris idéologique que l’on pourrait appeler l’égalitarisme.C’est le meilleur moyen de construire une société totalitaire : pour atteindre un objectif idéologique (tout le monde doit être dans les mêmes conditions de fait), il faudrait sciemment empêcher certains de se réaliser pleinement, tout en aidant d’autres à le faire. Prenons un cas simple : Albert est plus intelligent que Rémi. Allons-nous empêcher Albert d’apprendre et de s’instruire pour faire en sorte que Rémi puisse être à peu près au même niveau ? Allons-nous sortir Albert de sa famille dès son jeune âge pour éviter que ses parents, plus instruits, ne lui transmettent d’injustes connaissances ? Bien sûr que non ! Ce serait une négation directe de la liberté individuelle, et de la dignité des personnes. Cette voie ne conduit qu’à une horrible dictature évaluant – comment ? – les capacités de uns et des autres, et brimant la majeure partie de l’humanité pour construire une sorte d’homme imaginaire, toujours identique prétendument, mais jamais dans les faits car chaque personne humaine a sa singularité. C’est le domaine de l’absurde, de l’arbitraire, et c’est un monde sans liberté. Hayek l’avait exprimé de manière très claire :

Il y a toute les différences du monde entre traiter les gens de manière égale et tenter de les rendre égaux. La première est une condition pour une société libre alors que la seconde n’est qu’une nouvelle forme de servitude.
Friedrich Hayek (1899 – 1992) économiste et philosophe britannique originaire d’Autriche.
Il convient donc de préciser quelles sont les règles permettant de distinguer le légitime de l’illégitime, afin d’éviter cette confusion entre les deux sens du mot. Mais avant cela, regardons un cas concret qui aide à dessiner cette limite.
Cas pratique : la discrimination à l’embauche
Un exemple typique : recruter quelqu’un pour un travail est un acte de discrimination légitime. Il s’agit bien de choisir, de distinguer entre les candidats, celui ou celle qui sera le plus adapté pour le poste. Il appartient à celui qui recrute de décider les critères de choix pour ce candidat. Il peut avoir à en rendre compte aux propriétaires de l’entreprise, mais ce n’est certainement pas à des acteurs extérieurs au processus de venir lui dicter d’autres critères. Le cas de l’entretien d’embauche permet d’introduire toute la thématique : qui est légitime pour décider ? Avec quels critères ? Dans quels cas faudrait-il, s’il le faut, imposer des critères de choix différents ?
Affirmative action ou discrimination positive
La confusion entre discrimination au sens de choix, et discrimination au sens d’inégalité devant la loi a conduit beaucoup de pays, à commencer par les USA, à adopter des politiques d’affirmative action, ou discrimination positive. La discrimination positive est le fait de « favoriser certains groupes de personnes victimes de discriminations systématiques » de façon temporaire, en vue de rétablir l’égalité des chances.
J’aimerais vous montrer à quelle point cette démarche, bien que motivée par une louable intention (?), est erronée intellectuellement, et que ses effets concrets ont déjà permis de montrer à quel point elle était inutile, inefficace, et toxique.L’enfer est pavé de bonnes intentions
Intellectuellement, cette démarche est en contradiction directe avec l’égalité devant la loi, ce qui devrait presque suffire à faire douter de son bien-fondé. Un deuxième point devrait alerter : qui décide des groupes à favoriser ? Comment empêcher qu’une telle politique conduise à ce que d’autres groupes réclament les mêmes faveurs ? A nouveau, l’arbitraire règne. Et il est sans fin. Si on favorise les noirs, les femmes, ou les handicapés, pourquoi ne favoriserait-on pas les gros, ou les nains ? Les particularités humaines sont d’une telle étendue, que la liste ne peut que s’allonger à l’infini. Par ailleurs, pour ”favoriser » telle ou telle catégorie, il est nécessaire de la montrer du doigt, de la stigmatiser, ce qui est une contradiction interne à cette démarche. Pour éviter les discriminations, créons-en ! Drôle de manière d’assurer la cohérence des règles.
Il existe une liste longue comme le bras des inconvénients de la discrimination positive à l’embauche, j’en cite quelques uns :- le soupçon sur les qualifications (si je suis embauché parce que noir, qui pourra me considérer comme compétent ?)
- l’encouragement du communautarisme (si ma communauté est favorisée par la réglementation, pourquoi ferais-je des efforts?)
- la tension entre les communautés (si on discrimine positivement une communauté ou un groupe, cela veut dire que l’on discrimine négativement les autres)
Se renseigner
Pour en terminer sur cette idéologie, il importe de la confronter aux faits, et à la réalité. Là où elle a été mise en oeuvre, quels sont les résultats ? Un excellent livre sur le sujet, « Le Puzzle de l’intégration », par Malika Sorel-Sutter permet de se rendre compte des dégâts causés par la discrimination positive. Partout les résultats vont à l’inverse des buts visés, ce qui devrait heurter toute personne qui considère que l’on doit avoir en politique une éthique de responsabilité. Les exemples fourmillent dans son livre (aux USA, mais aussi en France, puisqu’en France et sans le dire ouvertement, les responsables politiques ont mis en oeuvre des politiques de discrimination positive sociales, territoriales – avec les ZEP-, sexuelles – avec la parité hommes/femmes – et communautaires). Je vous renvoie au livre de Malika Sorel pour découvrir la liste des personnalités politiques, de gauche comme de droite, citations à l’appui, qui sont favorables ou défavorables à la discrimination positive.
Que ce soit pour sélectionner des candidats à l’embauche, ou pour sélectionner des étudiants dans une filière, la sélection au mérite et sur les compétences est une bien meilleur rempart contre les inégalités : il permet à chacun, quelque soit ses chances de départ, d’avoir l’opportunité de travailler pour s’en sortir. Cela n’exclut pas d’aider, de soutenir ceux qui en ont besoin, par solidarité. Mais il convient de rester exigeant sur des règles identiques pour tous.
Citons une expérience intéressante rapportée par Jacqueline Costa-Lascoux, directrice de recherches au C.N.R.S. mais surtout, pour le sujet qui nous intéresse ici, membre du Haut Conseil à l’Intégration :Pourquoi analyser le refus d’embauche ou de stage sous le seul angle de la discrimination raciste ou ethnique ? L’expérience a été faite de tourner ces entretiens en vidéo pour ensuite en présenter les images aux candidats, aux employeurs, aux enseignants. Les résultats sont éloquents. Nombre de jeunes, par crainte ou par un sentiment de fatalité, arrivent en retard, habillés en jogging la casquette sur la tête, poussant la porte sans frapper, s’asseyant sans saluer sur le bord de la chaise le corps renversé comme pour regarder la télé, ne posant aucune question sur le travail mais en en rajoutant sur le salaire et les vacances… En face, la personne en costume pose des questions du type tests psychologiques ou psychotechniques, s’obligeant à rester dans une attitude raide de neutralité. Lorsque la scène est rediffusée aux protagonistes, les jeunes sont étonnés de leur ”look » et sont les premiers à dire que s’ils étaient employeurs ”ils ne se prendraient pas » ; quant à celui-ci, il comprend très vite l’inadaptation de son attitude à l’égard de jeunes qui n’ont jamais connu l’univers du travail salarié […] L’ignorance des codes sociaux et culturels au travail est l’obstacle le plus évident à l’embauche. Au lieu de crier immédiatement au racisme, il serait préférable non pas de raisonner en termes de catégories de populations mais en termes d’analyse de situations […]Quand je vois passer des messages – très idéologiques – exhortant les entreprises à « recruter sans discriminer », les bras m’en tombent ! Recruter, c’est discriminer.
Critères de choix entre discrimination légitimes et illégitimes : la liberté
Un dernier point, pour souligner ce qu’est l’attitude opposée à la discrimination positive. Dans chacun des exemples ci-dessus, il convient de distinguer ce qui est de l’ordre du choix personnel, et ce qui est de l’ordre de l’égalité des citoyens devant la loi. Dès que l’on se trouve dans le champ du choix personnel, de la liberté et de la responsabilité, la seule voie est de laisser celui qui est responsable d’un choix le faire en toute liberté ET responsabilité. Le meilleur moyen pour forcer une entreprise, une école ou une administration à ne pas procéder à d’injustes discriminations, c’est de la forcer à assumer ses responsabilités. Si telle ou telle entreprise choisit de discriminer les noirs à l’embauche, par exemple, faisons le savoir et dénonçons cette attitude si cela nous choque : boycottons ses produits, refusons d’aller y travailler, utilisons les médias pour faire pression sur ses dirigeants. C’est une méthode préférable à celle consistant à la forcer, par la loi, à embaucher des noirs. Si notre ennemi est le racisme (sous toutes ses formes), la seule arme est l’éducation. Forcer un dirigeant à embaucher des noirs ne le rendra pas moins raciste, s’il l’est. Il est fort probable que d’injustes discriminations soient à l’oeuvre dans tout recrutement, mais également des discriminations tout à fait légitimes. Mais que chacun se pose la question : lorsque nous sommes en situation de discriminer pour une embauche (une nounou, un salarié, un artisan, etc…), sommes-nous bien sûr de ne fonctionner que d’une manière parfaitement objective ? Non, bien sûr. Et il est essentiel que ce choix, qui est notre liberté et notre responsabilité, reste dans nos mains. Chacun a ses critères de choix.Le critère qui permet de distinguer entre les discriminations illégitimes, et celles qui sont légitimes, c’est la liberté.
Car enfin soyons raisonnables : il existe des gens qui n’aiment pas les gros, d’autres ceux qui ont des boutons, d’autres encore les noirs, ou les jaunes, ou ceux qui ont une barbe, ou les femmes voilées. Si nous devons pouvoir rendre des comptes, devant la loi, de n’avoir utilisé aucun critère arbitraire pour choisir, aucun choix ne sera plus possible. Tout choix est arbitraire, car c’est un acte de liberté d’une personne particulière, avec son histoire, ses envies, ses aspirations, ses goûts, ses préférences. Heureusement que nous sommes libres de faire nos choix comme nous le voulons. Cela veut dire qu’il faut accepter que certains utilisent des critères de choix qui ne sont pas les nôtres.
Vous l’avez compris : le critère qui permet de distinguer entre les discriminations illégitimes, et celles qui sont légitimes, c’est la liberté. La liberté est indissociable de la responsabilité. La discrimination légitime, c’est celle qui est de ma responsabilité. Si je suis responsable d’une embauche, c’est à moi et à personne d’autre de choisir. C’est ma responsabilité, et ma liberté.Conclusion : Au nom de la tolérance
Un dernier mot pour conclure : Gilbert Durand, qui a fait un travail formidable sur les imaginaires, a bien expliqué comment l’Occident est une civilisation dont le régime imaginaire est diurne, c’est-à -dire dans un registre de ”lumière ». Lumière, donc séparation : dans l’obscurité rien n’est distinct. Dans la lumière les formes se dessinent, et permettent de distinguer les objets, leurs frontières.
Alors dans cette logique, et pour rester une société d’hommes libres, je voulais faire l’éloge de la discrimination. Faisons le tri entre, d’une part, les discriminations devant la Loi et les institutions, injustes et à condamner, et toutes les autres d’autre part qui sont légitimes, car le fruit de décisions libres et personnelles, même si elles ne nous plaisent pas. C’est ce qu’on appelle aussi la tolérance. La tolérance est précisément cette souplesse sociale que l’occident a vu émerger pour permettre la coexistence pacifique des êtres, quelles que soient leurs convictions, leurs dogmes spirituels ou religieux. Chacun est appelé à la tolérance vis-à -vis des autres. La tolérance est un appel à respecter la liberté des autres. Vouloir interdire la liberté dans les critères de choix individuels, c’est inscrire dans la Loi une forme d’intolérance. Il convient donc, comme je le précisais plus haut, d’expliciter et de montrer du doigt l’idéologie qui, sous couvert de non-discrimination, la provoque, et dresse les uns contre les autres. L’Égalitarisme est son nom. Ce n’est pas une utopie, c’est une dystopie en construction, car ses partisans sont des ennemis de la liberté.