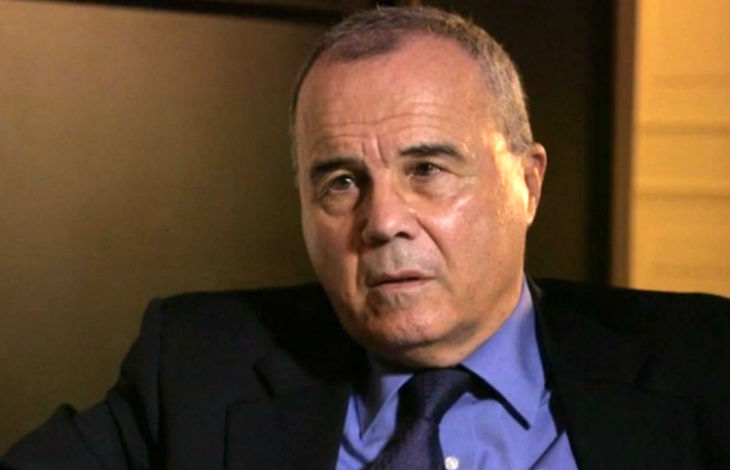Depuis presque 2 mois, l’épidémie est terminée. Pourquoi continuons-nous donc à porter des masques, et à compter anxieusement le nombre de cas ? Le plus simple pour le comprendre est de regarder la réalité, et les données disponibles : une remarquable vidéo d’Ivor Cummins donne beaucoup d’éléments factuels et d’arguments.
Folie sanitaire ?
Depuis le début de l’épidémie, j’avoue que je regarde régulièrement (j’avais arrêté, et j’ai repris) le nombre de morts en France lié à la COVID. Depuis fin mai, il est tombé presque à zéro. Tout l’été, j’ai entendu des gens dans les médias prédire une « seconde vague », sans que jamais cela soit confirmé. L’augmentation du nombre de cas actuelle ne m’a pas inquiété : il parait logique lorsque l’on teste beaucoup, et que la population s’est « déconfinée », que le nombre de cas explose. Cela ne fait pas plus de morts pour autant, et c’est tant mieux ! Mais l’hystérie collective est très fatiguante, pesante même. Je me sens comme isolé de ne pas céder à la folie. Je suis persuadé que les masques ne servent à rien, et je trouve excessive les mesures sanitaires actuelles. Cela peut même devenir un sujet de conflit avec des proches, ou des collègues, en tout cas de désaccord. J’ai eu sur Twitter des désaccords avec des gens que j’apprécie par ailleurs, et dont je ne mets absolument pas en cause l’honnêteté intellectuelle. J’ai donc cherché un peu, et je suis vite tombé sur une vidéo qui regroupe plein de données, d’arguments, et qui les expose de manière simple et directe. Comme elle est en anglais, j’ai repris ici quelques éléments clés.
Des faits, des faits, des faits !
Vous le savez si vous lisez ce blog, je préfère réfléchir à partir d’énoncés sur le réel, en tout cas en acceptant que mes idées et théories puissent être contredites par le réel.
Voilà une liste non-exhaustive de constats et d’arguments, basé sur des chiffres. Je suis prêt à remettre en cause telle ou telle affirmation, mais c’est une bonne base pour échanger de manière rationnelle. Les chiffres entre parenthèses renvoient à l’endroit de la vidéo concerné.
- Dans les pays européens, l’épidémie est terminée depuis juin. Le nombre de morts liés à la COVID est tombé presque à zéro (2:03)
- Il est très important de ne pas regarder uniquement le nombre de morts liés à la COVID, mais également le nombre de morts total par rapport au nombre de morts « habituels ». Il apparait que pour pas mal de pays, l’hiver avait été plutôt clément en termes de victimes de la grippe saisonnière, et la COVID a donc eu un impact « de rattrapage » : les populations les plus faibles qui n’étaient pas mortes en hiver ont été les premières emportées par l’épidémie. (4:31 et 8:44)
- Toutes les prévisions faites par les « experts » sur la base de modèles au début de la pandémie étaient outrageusement exagérées (au moins un facteur par rapport à ce qui s’est passé) (5:45)
- Il faut remettre en perspective l’épidémie de COVID par rapport aux nombres de morts des autres épidémies, ou des fluctuations habituelles saisonnières. Le pic de la COVID est à peine distinguable sur la courbe de temps long : oui, on peut maintenant dire qu’il s’agit d’une épidémie de type « grippe sévère » (je ne prétends que l’on pouvait le dire en mars) (8:03)
- Il est fort peu probable que les mesures de confinement et de port de masque dans l’espace public aient un quelconque impact sur la COVID (13:21, 15:35 pour le tableau récap des arguments, 19:50 pour la comparaison de pays qui ont confiné et d’autres non)
- Il y a des différences d’allure des courbes d’épidémie en fonction de la latitude. La courbe pour les régions tropicales est plus étalée. Cela permet de très bien décrire les courbes des pays d’Amérique du sud, et même d’analyser la courbe des USA, qui comporte deux bosses : c’est la superposition de la courbe habituelle (nord des USA) et celle plus étalée typique du sud (Sud des USA) (21:00)
- Dans tous les pays, nous assistons maintenant à une « épidémie de cas » (casedemic) : le nombre de cas explose, mais sans aucune mortalité associée.
L’épidémie est finie, et le virus continue de circuler, sans faire de victimes (France : 28:00)
- Sur un exemple, l’auteur montre comment la seconde vague tant « attendue » est probablement le fait de revenir sur les nombres normaux de morts à cette époque de l’année (31:52). Il est possible que ces mesures jamais vues auparavant (confinement, masque, etc.) aient également, une fois l’hiver arrivé, des effets négatifs : en empêchant la circulation habituelle des virus dans la population, nous avons peut-être aussi diminué la production de défense immunitaire habituelle par brassage. Si cette hypothèse est vraie, les pays les moins observants devraient être moins touchés cet hiver…
Tous ces éléments conduisent à penser qu’il faut garder la tête froide, et revenir à une vie normale. Pourtant, ce n’est pas le cas, et il semble même, au vu des mesures sanitaires actuelles, que c’est l’inverse.
Pourquoi ?
J’ai regardé pas mal de choses à droite à gauche. Je dois reconnaître que les médias ont plutôt fait leur job. Les contradicteurs ont eu la parole, et on trouve beaucoup de propos de bon sens sur les réseaux sociaux, repris des médias main-stream. Je crois que nous sommes plutôt en face d’une forme de prophétie auto-réalisatrice : j’oblige le port du masque pour une supposée épidémie en train de repartir, et comme il y a des masques partout il parait évident à tous que l’épidémie n’est pas terminée. Pourquoi porter des masques sinon ? Voici quelques causes possibles à cette manière de fonctionner :
- Le principe de précaution n’a pas de limite : on peut toujours faire plus pour se protéger. Ce qui compte, c’est la balance bénéfice/risque. La vertu de prudence, je le rappelais ici, devrait pourtant nous inciter à agir de manière raisonnée
- La peur est un puissant levier ; personne n’a envie de mourir, ou de mettre en danger ses proches, ou les plus fragiles. Il est donc facile d’adopter des comportements peu contraignants dans cet objectif louable (ce n’est pas si grave de porter un masque). Il me semble que c’est, à nouveau, oublier de prendre en compte les impacts négatifs sur l’économie et le moral de toutes ces mesures de confinement, port de masques, interdiction de ceci et de cela, qui n’ont aucune assise rationnelle…Elles avaient un sens en mars, car nous ne savions pas à quoi nous avions affaire, elles n’en ont plus aucun désormais.
- Je me rends compte, en discutant à droite à gauche, que la plupart des gens ne prennent pas la peine de s’informer, de lire, de comprendre, de douter. Il y a pourtant pleins de gens qui déploient des trésors d’intelligence, et d’esprit critique, dans leur travail quotidien, et qui pour la marche du monde prennent sans discuter ce que leur sert le 20h.
- Le noeud du problème réside à mon sens dans une forme de soumission du politique à des experts politisés. Ce qui est vrai pour l’environnement l’est tout autant pour la santé : il suffit pour s’en convaincre de lire la tribune de 35 chercheurs, médecins, universitaires qui demandent la dissolution du fameux Conseil Scientifique COVID Nous appelons également le gouvernement à ne pas instrumentaliser la science. La science a pour condition sine qua non la transparence, le pluralisme, le débat contradictoire, la connaissance précise des données et l’absence de conflits d’intérêts. Le Conseil scientifique du Covid-19 ne respectant pas l’ensemble de ces critères, il devrait être refondé ou supprimé.
J’espère que ces réflexions vous donneront matière à relativiser ce qui nous arrive. Une épidémie de COVID nous est tombé sur la tronche en mars. Depuis juin-juillet cette épidémie, en France, est terminée. Les faits le montrent. Si vous avez des faits montrant le contraire, je suis preneur.