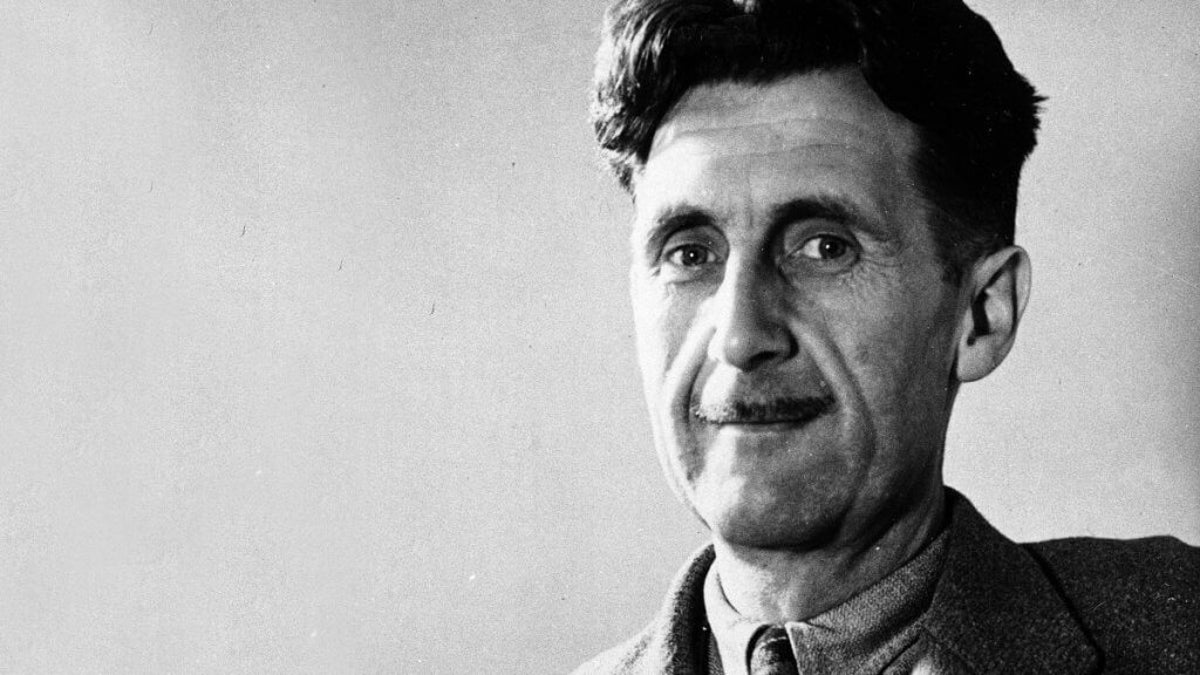Nettoyer les rues
Je suis souvent choqué, presque quotidiennement, par l’état dans lequel nous acceptons, collectivement, de laisser les rues. Les rues à certains endroits sont sales, à d’autres remplies de mendiants, ou de familles de migrants illégaux. Les rues sont par ailleurs, dans certains quartiers, laissés aux mains des racailles islamisées. Et parfois, temporairement, aux mains des gauchistes violents. Toutes ces situations sont inacceptables, moralement et juridiquement. Et pourtant nous nous y sommes presque habitués. Il faut nettoyer les rues. Je ne comprends pas pourquoi cette mesure populiste, ou de bon sens, consistant à « nettoyer les rues » n’est pas mise en avant par les différents candidats et partis politiques. Nettoyons les rues de la misère qui s’y amoncelle. Rendons l’espace publique à son usage habituel : un lieu collectif, impliquant respect des autres, politesse, propreté, application stricte des règles communes. Désolé de faire mon Suisse.
Il ne s’agit pas de kà¤rcher, les humains n’étant pas des moisissures, ni des scories que l’on peut balayer avec un jet d’eau. Non : il s’agit de dignité, et de solidarité. Les propos de Sarkozy, à l’époque, n’étaient pas choquants : c’est de ne pas les avoir mis en oeuvre qui a choqué les français.
La rue, l’espace public, sont par définition du domaine collectif. Il est donc de notre responsabilité collective de changer les choses, c’est-à -dire que cela est dans le champ du politique (sauf à revenir à des « milices » de quartier qui seraient en charge de gérer une rue, ou un bloc de maisons). Il est anormal de ”laisser » des gens ”vivre » dans la rue. Au-delà des émotions, et de la compassion, que chacun peut ressentir devant un tel spectacle, il y a là un phénomène que nous devons rejeter, de toutes nos forces, à titre individuel comme de manière collective.
Miroir d’une société malade
Cet espace public est aussi un miroir de ce qu’est notre société. Ce miroir qui est nous est tendu renvoie une image terrible. Il nous renvoie à notre propre incapacité à traiter le problème, il nous donne une image particulièrement sordide (qu’est ce qu’une société où des enfants trainent dans la rue à mendier au lieu d’être à l’école ?). Et il nous montre l’impéritie crasse de nos dirigeants à simplement faire appliquer la Loi (allons-nous nous faire croire que nous ne savons pas loger, et forcer l’intégration de ce mélange de SDF et de migrants plus ou moins légaux ?). Il faut refuser l’image de ce miroir, et la réalité qu’il montre. Les français sont solidaires, le niveau de prélèvement obligatoire consenti suffit presque à le montrer. Personne ne se satisfait par ailleurs de cette situation : ni les mendiants, ni les citoyens, ni les bénévoles, ni les responsables d’associations, ni les responsables politiques.
Pas de traitement de faveur pour les fragiles ?
Mais le politiquement correct est ainsi fait : on ne doit forcer personne, surtout pas des catégories fragiles. Ce serait discriminant ? Soutenons l’inverse : il faut aider les plus démunis, même malgré eux. Il faut réintégrer de force ces enfants des rues dans des écoles, apprendre à parler à leur parents (ou les foutre en taule), forcer les sans-emplois et les laissés-pour-compte à être pris en charge pour se re-socialiser. Coûte que coûte. Ce n’est pas une question de moyens, ni de capacité, c’est une question de dignité et de volonté politique. Je suis convaincu qu’un homme politique qui proposerait de nettoyer les rues marquerait des points auprès de nombreux citoyens. Parce que les français sont solidaires, amoureux de la dignité des personnes, et fier de leur pays, qu’ils ne supportent plus de le voir peu à peu se transformer en pays du tiers monde.
Vivons heureux, vivons confinés ?
J’ai une petite théorie sur le confinement, qui permet d’expliquer pourquoi un peuple aussi rebelle que les français se sont si facilement laissé enfermer chez eux. Je crois que cela a permis a beaucoup de monde de ne plus « voir » cette affreux chemin que nous avons pris, en n’allant plus dans la rue. Les médias tournant en boucle sur le COVID, ça a permis de ne pas trop voir les assauts de « migrants » contre la Grèce, la situation pré-insurrectionnelle dans les « banlieues ». Il est temps de retourner dans la rue, et d’accepter cette réalité que l’on ne veut plus nommer, ou voir. Cela nous empêche de nous attaquer aux problèmes.
Il faut toujours dire ce que l’on voit ; surtout il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l’on voit.Charles Péguy